Recension par Jean-Christophe Barbato, Professeur à l’École de Droit de la Sorbonne, Chaire Jean Monnet en droit de l’Union européenne, IREDIES
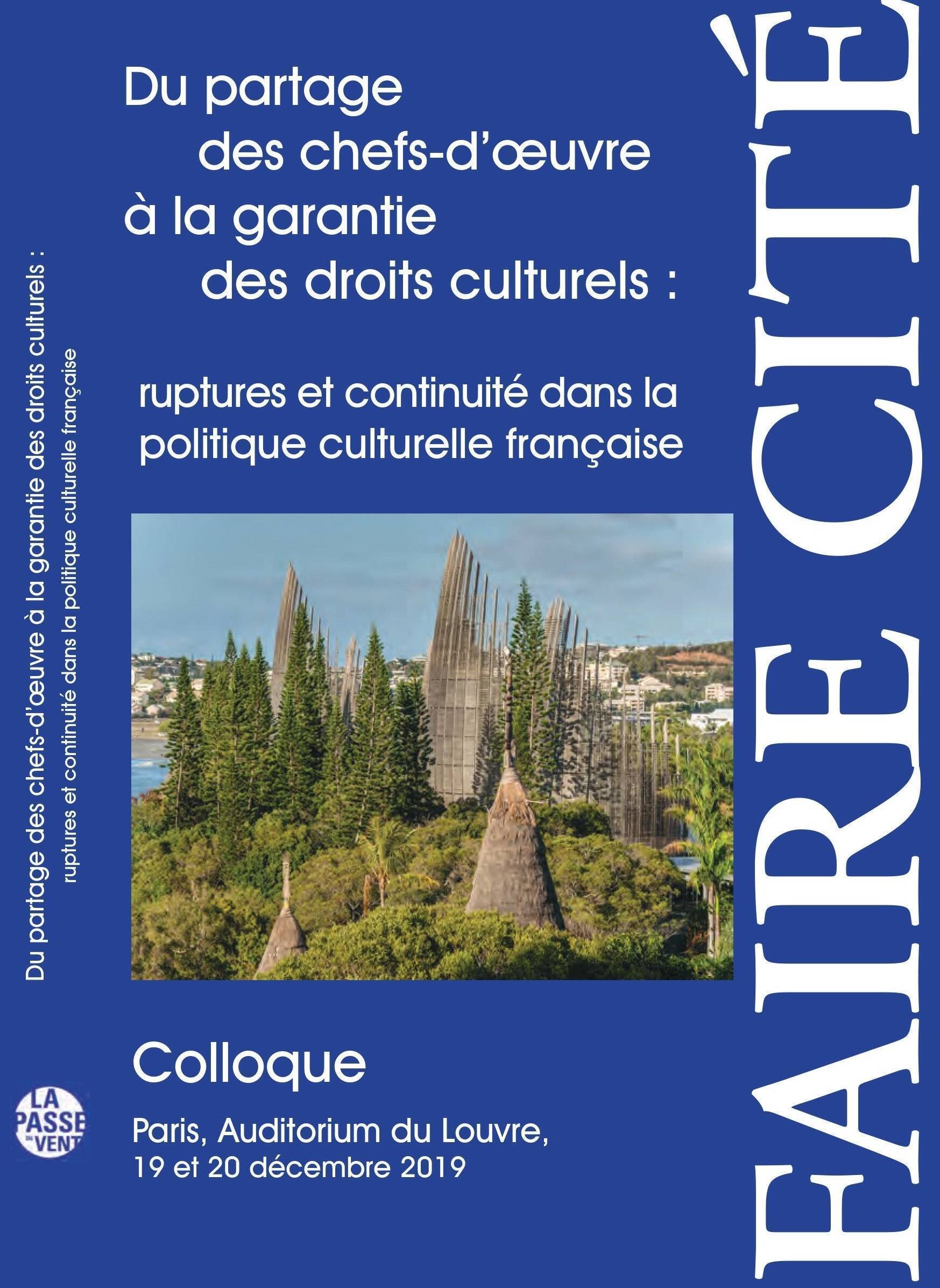 Cet ouvrage est le fruit d’un colloque organisé pour célébrer le soixantième anniversaire de la création du ministère de la culture grâce au décret du 24 juillet 1959. Loin de se limiter à la commémoration, cette publication propose un contenu scientifique centré, comme l’indique le sous-titre choisi, sur les évolutions de la politique culturelle française. Encore est-il nécessaire de préciser que cette focalisation hexagonale présente dans l’intitulé ne rend pas exactement justice au texte qui se centre plutôt sur les évolutions générales des politiques culturelles. Le livre est ambitieux mais autant le dire d’emblée : il relève largement le pari de son sujet.
Cet ouvrage est le fruit d’un colloque organisé pour célébrer le soixantième anniversaire de la création du ministère de la culture grâce au décret du 24 juillet 1959. Loin de se limiter à la commémoration, cette publication propose un contenu scientifique centré, comme l’indique le sous-titre choisi, sur les évolutions de la politique culturelle française. Encore est-il nécessaire de préciser que cette focalisation hexagonale présente dans l’intitulé ne rend pas exactement justice au texte qui se centre plutôt sur les évolutions générales des politiques culturelles. Le livre est ambitieux mais autant le dire d’emblée : il relève largement le pari de son sujet.
Avant d’évoquer le fond, il convient de s’arrêter quelque peu sur la variété des auteurs et des discours. C’est là une spécificité de l’ouvrage. Loin de se limiter aux regards provenant d’un unique champ et se déployant dans une forme identique, la publication multiplie les discursivités afin d’embrasser au mieux son objet tout en évitant habilement les pièges d’une hétérogénéité trop affirmée. Les contributeurs sont à la fois des universitaires, des responsables politiques ou de hauts responsables administratifs du secteur de la culture, des praticiens et des acteurs de terrain. Les contributions quant à elles prennent la forme d’articles au sens académique du terme, de restitutions de tables rondes ainsi que de brefs témoignages accompagnés de photos sur des actions.
Soulignée par de nombreux auteurs, l’ajout d’une logique de démocratie culturelle à celle originelle de la démocratisation culturelle constitue le point de bascule des missions imparties au ministère et, plus largement, aux politiques culturelles. Dans un premier temps, l’objectif consistait à opérer un partage des chefs d’œuvres en permettant au plus grand nombre d’accéder à des réalisations artistiques considérés comme légitimes. Le ministère André Malraux incarne par excellence cette conception. Elle s’est toutefois retrouvée en butte à de nombreuses critiques lui reprochant son élitisme et considérant qu’elle constituait un vecteur de domination symbolique de la bourgeoisie pour reprendre la terminologie d’une des plumes les plus marquantes parmi ses contempteurs,. Cette démocratisation culturelle a également rapidement montré ses limites en termes d’efficacité. Le renforcement de l’accessibilité matérielle n’a pas produit tous les fruits espérés et n’a jamais été en mesure de combattre significativement les obstacles sociologiques suscités par le rapport à l’art au sens classique du terme.
Comme le montrent plusieurs contributions, dès la fin des années soixante, le paradigme de la démocratie culturelle commence à apparaître dans les discours et à se concrétiser dans l’action publique. Il s’épanouit pleinement avec le ministère Jack Lang qui est emblématique de cette nouvelle approche. Il s’agit en quelque sorte de convier tout le monde à la fête et surtout de permettre à chacun d’exprimer sa créativité et de choisir sa vie culturelle. Au lieu de partir du haut, les politiques culturelles offrent à chacune et chacun des possibilités de développements culturels susceptibles de répondre à leurs aspirations et ce grâce à de multiples structures et activités. Cette nouvelle approche a impliqué une redéfinition de la notion de culture qui ne pouvait plus rester cantonnée aux réalisations les plus légitimes. Des expressions culturelles plus populaires, plus traditionnelles ou encore urbaines ainsi que d’autres modes d’expression (clips, jeux vidéos, etc) ont été intégrées dans l’action culturelle. Cette transformation majeure de l’action culturelle n’est pas restée sans générer de critiques dont l’une des plus connues est certainement celle rédigée par Marc Fumaroli dans l’État culturel. Le lecteur curieux de ces débats devra aller chercher des ressources ailleurs que dans le livre recensé qui reste trop laconique sur ce point.
Si la démocratie culturelle constitue depuis les années quatre-vingt, un pan extrêmement significatif des politiques publiques, il importe cependant de préciser que les efforts en faveur de l’accès aux œuvres n’ont pas disparu et que c’est bien plutôt à une coexistence entre deux axes différents mais complémentaires à laquelle on assiste.
Cette transformation des discours et des politiques s’est accompagnée de deux autres grandes évolutions parfaitement mises en exergue par l’ouvrage. : l’affirmation des droits culturels fondamentaux, d’une part, et celle de la diversité culturelle, d’autre part.
La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 apparaît comme l’acte officiel de naissance des droits culturels. Son article 27 reconnaît à chacun le droit de « prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent ». Il sera complété par plusieurs articles du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturel de 1966. Par la suite, en 2007, la Déclaration de Fribourg qui émane de la société civile proposera une liste de droits culturels fondamentaux. Sur un plan européen, la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme ainsi que plusieurs dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne protègent ces droits. Il en va de même dans les ordres juridiques internes, notamment avec de nombreuses dispositions d’ordre constitutionnel. Comme le montre cette brève généalogie des droits culturels qui est aussi une histoire d’une progression : ceux-ci occupent désormais une place importante et plutôt bien identifiée dans la galaxie des droits fondamentaux
Il n’est pas aisé de cerner avec précision l’étendu des droits culturels mais pour le dire schématiquement, ils recouvrent le droit de participer à la vie culturelle qui se décline lui-même en une série d’aspects parfaitement expliqués par Céline Romainville, une spécialiste de la question : droit de créer et de diffuser et de recevoir une protection pour ses œuvres, droit au maintien et à la promotion de la diversité culturelle, droit d’accès à cette diversité (accès qui impliquent de travailler à la réduction des obstacles qu’ils soient matériels ou sociologiques notamment), droit de prendre part activement aux activités culturelles, droit au libre choix de ses activités ou droit de ne pas participer, droit de contribuer à l’élaboration des politiques culturelles et droit à l’égalité et à la non-discrimination dans l’accès.
Comme le montre cette même auteure, la notion de droit culturels imprègne désormais fortement les politiques culturelles soulignant ainsi la fondamentalité de ces dernières. De plus, si, à l’exception des aspects liés à la liberté d’expression, la densité juridique de ces droits est généralement assez réduite, elle se traduit cependant en principe par une obligation de mise en œuvre politique accompagnée d’un effet cliquet qui constitue deux formes de garanties, certes plutôt faibles mais pas pour autant négligeables.
Les discours relatifs à la diversité culturelle trouvent principalement leur origine dans la construction européenne (au sens large) dont l’articulation entre unité et diversité constitue une des ontologies. Cet aspect est laissé de côté par l’ouvrage qui, à quelques exceptions près, ne s’intéresse d’ailleurs pas vraiment aux questions européennes, ce qui est regrettable dans la mesure où l’action culturelle émanant du Conseil de l’Europe et, surtout, de l’Union européenne n’ont cessé de gagner en importance à la fois comme cadre structurant des actions nationales et comme complément à ces dernières qu’elles ont également contribué à fortement influencer. C’est d’autant plus regrettable que ces actions européennes proposent un modèle plutôt original. Pour le dire simplement et si l’on se cantonne au cas de l’Union européenne, il s’agit de promouvoir dans un même mouvement à la fois la diversité des créations et l’unité culturelle européenne en instant particulièrement sur la circulation des œuvres et des acteurs ainsi que sur la création de réseaux. L’évolution des conceptions culturelle européennes, la comparaison avec les paradigmes nationaux et les interactions entre les deux méritaient des développements que le lecteur intéressé devra aller chercher dans d’autres écrits.
Il faut attendre le début des années 2000 pour que la diversité culturelle déborde véritablement du cadre européen, fasse son apparition dans de nombreux textes et émerge comme un élément majeur des politiques culturelles. La convention de l’UNESCO du 20 octobre 2005 sur la protection et la promotion de la diversité culturelle constitue de ce point de vue l’instrument le plus symbolique de cette consécration. Il fait entrer de plein pied la notion dans la légalité internationale et contribue à sa diffusion dans les ordres juridiques nationaux.
La diversité culturelle est devenue depuis une forme de mention incontournable des politiques culturelles. Le sens et les implications de la notion sont généralement assez flous. La défense et la promotion de la diversité culturelle doivent être au cœur de l’action mais quelle diversité et selon quelle modalité : il n’y a aucun consensus à cet égard. Cette plasticité est sans doute l’un des clefs expliquant le succès de la notion à la fois sur un plan juridique mais aussi, plus largement, politique.
Existe-t-il des liens entre ces trois éléments – le passage à la démocratie culturelle et la montée en puissance des droits culturels et de la diversité culturelle- et si oui quels sont-ils ? L’ouvrage n’apporte pas de réponse claire sur ce point et ne s’intéresse que peu à cette problématique. C’est sans doute parce qu’il apparaît difficile d’adopter une position définitive en la matière. A titre d’esquisse de réponse, les éléments suivants peuvent être avancés. Selon nous, il n’existe aucun lien de causalité directe entre ces différents phénomènes mais ils participent cependant d’un même discours global consistant à offrir une place centrale aux individus, et éventuellement, aux communautés, ce qui implique à la fois une valorisation des singularités propres à chacun et un phénomène de subjectivisation qui s’incarne notamment sur un plan juridique. Autrement dit, dans la mesure où il ne s’agit plus de diffuser du haut vers le bas une culture considérée comme légitime mais de laisser à chacun le soin de développer sa vie culturelle comme il l’entend, cela induit, non pas de manière automatique mais plus tôt selon une logique de cohérence générale, que les choix des individus ou des groupes, ou encore le choix des individus de s’impliquer dans tel ou tel groupe soit valorisé, et protégé. Ce phénomène s’avère évidemment favorable à l’émergence d’une notion telle que la diversité culturelle. Dans le même ordre d’idée et compte tenu de la prégnance du discours des droits fondamentaux depuis la seconde guerre mondiale et de l’importance de la question des identités culturelle qui en découle, l’affirmation et la valorisation des droits culturels fondamentaux coulaient aussi d’une source qui leur était favorable.
Dans leur contribution, Mme Marie Cornu et le Professeur Noé Wagner traitent de la déclaration des droits de la culture de 1987 qui fait suite aux États généraux de la culture animés notamment par Jack Ralite. Cette déclaration se centre sur la protection de la culture elle-même et non sur les droits culturels ou à la culture des individus. Malgré son intérêt, cette déclaration n’a pas rencontré le succès des discours relatifs aux droits subjectifs. A titre d’hypothèse, il est permis de penser que c’est sans doute un signe de l’époque qui atteste de la centralité de l’individu et de la baisse subséquente de l’efficace des discours relatifs à la culture lorsqu’ils sont perçus comme relevant d’une logique de démocratisation culturelle et donc d’imposition de ce qui présente ou non de l’intérêt.
Enfin, de nombreux contributeurs s’interrogent sur les possibles risques que les droits culturels et la diversité culturelle pourraient faire peser sur l’universalisme au profit des particularismes et de logiques communautaristes excluantes et enfermantes. Droits culturels et diversité pourraient être instrumentalisés afin de défendre des pratiques problématiques au nom du respect des spécificités. Dans le même ordre d’idée, ils seraient susceptibles de remettre en cause les cohésions nationales en favorisant à la fois les irrédentismes et un individualisme trop affirmé. Il ne s’agit cependant jamais d’affirmer une critique tranchée mais tout simplement d’évoquer les errements que pourraient susciter un mauvais usage des notions. A cela peut s’ajouter des reproches exprimés de manière globale à l’encontre du mouvement en faveur des droits fondamentaux et qui sont rapportées par Céline Romainville. Ces droits occulteraient la dimension économique, sociologique et collective de nombreuses difficultés et remplaceraient le politique par une question de droits individuels qui ne seraient finalement qu’un vecteur de renforcement des pouvoirs de la légitimité d’États néolibéraux.
L’ouvrage montre que la grande transformation des politiques culturelles réside dans le recentrage sur les individus et la valorisation de la volonté de chacun. Si les actions de diffusion et d’accès à une culture considérée comme légitime ne sont pas abandonnées, elles figurent désormais, au moins dans les discours, au second rang derrière une logique de participation et de prise en compte des spécificités et désirs de chacune et chacun. Ce passage de la démocratisation à la démocratie culturelle dont les droits culturels ont été une voie privilégiée a entraîné avec lui une modification nécessaire de la notion même de culture afin de prendre en compte la diversité des conceptions individuelles et collectives.
En proposant une vue synthétique des problématiques et des évolutions des politiques culturelles, la publication offre non seulement un cadre conceptuel structurée permettant d’orienter le lecteur mais aussi un espace stimulant pour développer réflexions et critiques dans une perspective pratique ou académique.