par Frédéric Bouhon, professeur à l’Université de Liège (f.bouhon@uliege.be)
En repartant de la notion de « société du risque », la présente étude entend montrer pourquoi la Cour européenne des droits de l’homme est amenée à évaluer des risques et comment elle y procède. À cette fin, deux approches différentes de la jurisprudence sont déployées. D’une part, à travers une lecture juridico-linguistique, on cherche à recenser et à examiner les principales expressions que la Cour utilise couramment pour traiter les cas pertinents. D’autre part, par le biais d’une approche juridico-économique, on essaie d’appliquer les grands principes de la théorie de la gestion du risque (gravité, probabilité et acceptabilité) à cette même jurisprudence, avec l’intention de contribuer à une lecture originale des arrêts de la Cour.
« Je suis une bonne mère. Je pense à tout ce qui pourrait leur arriver. Tous les accidents qu’ils risquent, j’y pense d’avance. (…) Ce sont mes enfants, je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir pour leur éviter les calamités innombrables qui les guettent. (…) Je frémis à l’idée qu’ils peuvent manger des baies empoisonnées, s’asseoir dans l’herbe humide, recevoir une branche sur la tête, tomber dans le puits, rouler du haut de la falaise, avaler des cailloux, se faire piquer par les fourmis, par les abeilles, par les scarabées, les ronces, les oiseaux, ils peuvent respirer des fleurs, les respirer trop fort, un pétale leur entre par la narine, ils ont le nez obstrué, cela remonte au cerveau, ils meurent, (…) ».
Boris Vian, L’arrache-cœur, 1953[1]

- – Introduction – Nous vivons dans une « société du risque ». L’expression, développée dans les années 1980[2], paraît aujourd’hui plus pertinente que jamais. La notion de risque est en effet omniprésente : on la rencontre dans les contextes domestique et professionnel, mais aussi dans les sphères politique et juridique où on attend des autorités qu’elles préviennent divers risques. Peut être mise en exergue la question de la responsabilité des États face à des menaces diverses. La réflexion que nous proposons porte sur les risques qui posent question au regard des droits fondamentaux consacrés par la Convention européenne des droits de l’homme.
Ce sont, en première ligne, les autorités politiques (pouvoirs législatifs et exécutifs) et les administrations qui, pour assurer le respect de ces droits, évaluent et prennent en considération certains risques. Les juges, notamment ceux de la Cour européenne des droits de l’homme, sont toutefois susceptibles d’exercer un contrôle sur la manière dont les risques ont été appréhendés par les autorités ou devraient l’être. La présente contribution vise à évoquer une recherche en cours, sur la manière dont la Cour européenne des droits de l’homme traite la notion de risque dans sa jurisprudence. Il s’agit de dresser le cadre dans lequel la réflexion s’insère, d’énoncer les questions qu’elle suscite et d’élaborer de premières pistes de réponses. Il s’agit d’abord d’expliquer pourquoi la Cour européenne des droits de l’homme est amenée à évaluer des risques, ensuite d’examiner comment elle procède.
I – Pourquoi la Cour européenne des droits de l’homme évalue-t-elle le risque ?
- – Notion de risque, essai de définition – Pour comprendre le rôle que la Cour européenne des droits de l’homme est amenée à jouer dans l’évaluation de risques, il est utile de prendre un peu de recul et de s’intéresser, plus largement, au concept de risque et à la place qu’il occupe dans les sociétés contemporaines.
Le risque, dont il est question dans cette contribution, est un concept difficile à définir de façon univoque, car il est l’objet d’approches diverses dans la littérature[3]. La notion de risque suppose en tout cas un choix dans un contexte d’incertitude ; elle implique des « choices involving uncertainty »[4]. Autrement dit, le risque correspond à l’éventualité, plus ou moins probable, que survienne un préjudice, plus ou moins grave, à la suite d’un choix. La notion de risque est connectée à celle de danger, mais ne se confond pas avec elle : le risque est la conséquence éventuelle d’un danger[5]. Le danger est inhérent à certaines choses ou situations ; un serpent venimeux est dangereux, comme l’est une cabine électrique ou un homme armé. Les risques qui sont liés à ces dangers dépendent de facteurs complexes, comme la nature du danger, mais aussi divers éléments de contexte et le comportement des individus qui sont exposés au danger[6].
L’existence de risques tend à influencer le comportement de l’individu rationnel, qui se demande s’il est prêt à assumer le risque qu’engendre son action ou son inaction et qui compare les risques correspondants aux différentes options qu’il envisage avant de prendre une décision.
- – Société du risque – La question du risque n’intéresse pas que les ingénieurs ou autres spécialistes appelés à gérer des risques au sein d’entreprises ou d’institutions ; elle a gagné la société toute entière. Dans un ouvrage célèbre, publié en 1986, le sociologue allemand Ulrich Beck amène la notion de risque au cœur de sa discipline[7] en proposant une analyse du fonctionnement de la société contemporaine, qu’il a décrite comme une « société du risque »[8]. Il considère que « la production sociale de richesses est systématiquement corrélée à la production sociale de risques »[9]. Cette approche a notamment été complétée par les travaux de Niklas Luhmann[10] et Anthony Giddens[11]. Si les auteurs tirent des enseignements différents et nuancés de leurs analyses respectives[12], ils s’accordent à tout le moins sur le fait que les individus qui composent les sociétés contemporaines sont plus que jamais confrontés à des risques. Un auteur comme Luhmann étend d’ailleurs la notion de risque, que d’autres avant lui limitait aux installations de hautes technologies[13], à l’ensemble de la société moderne : « les activités juridiques, médicales, économiques, éducatives ou affectives présentent elles aussi des risques »[14]. La société du risque, décrite par ces auteurs, est une société tourmentée : « elle n’est ni sûre d’elle-même, ni dominatrice, elle est minée de l’intérieur, suspicieuse, inquiète, angoissée et donc anxiogène »[15]. Cela ne signifie pas que nous rencontrons plus de situations dangereuses que nos ancêtres – au contraire, les connaissances et les technologies acquises nous permettent de maîtriser bien des dangers, comme nombre de maladies graves –, mais que nous avons tendance à constamment chercher des solutions pour gérer de façon optimale les risques qu’engendrent les dangers. Ainsi, comme le relève Patrick Peritty-Watel, « nous vivons dans un monde plus sûr, mais plus risqué »[16].
- – L’évaluation des risques – Vu l’importance que représente la notion de risque pour toute entreprise humaine, de la plus banale à la plus ambitieuse, il n’est guère surprenant d’observer que des instruments ont été développés pour aider les individus et les institutions à réagir opportunément face au risque. On pense en particulier à la théorie de gestion des risques (risk management theory), qui se fonde sur des travaux mathématiques et probabilistes ainsi que sur la théorie économique[17]. Si on s’en tient aux rudiments, on peut considérer que la gestion des risques implique deux opérations complémentaires : d’une part, la mesure, qui se veut objective, du niveau du risque considéré et, d’autre part, l’évaluation, plus subjective, de l’acceptabilité du risque quantifié[18].
Dans un premier temps, il s’agit donc de mesurer objectivement le risque (quantitative assessment of risk). Il convient, pour ce faire, d’identifier les effets potentiellement dangereux associés à un projet donné et d’évaluer l’ampleur du risque en termes de probabilité de l’occurrence et de gravité des conséquences. La théorie de gestion des risques se base donc fondamentalement sur la mesure de deux éléments : la probabilité (likelihood) et la gravité (severity) du préjudice[19]. Le niveau du risque est le produit des valeurs qui correspondent à ces deux facteurs, tel que R (risque) = P (probabilité) x G (gravité)[20].
Une fois qu’un risque a été identifié et mesuré, l’opération suivante consiste en une réflexion sur l’acceptabilité de ce risque[21]. Il reste en effet à décider s’il y a lieu de prendre ou de ne pas prendre ce risque, ce qui revient à se demander si celui-ci est acceptable ou tolérable. Cet exercice est certes influencé par la première opération, car un risque faible est a priori plus acceptable qu’un risque élevé. Cependant, l’estimation de l’acceptabilité fait aussi entrer d’autres paramètres en jeu, de sorte que tel risque important peut être plus acceptable que tel autre risque plus faible. Ceci résulte de ce que le bénéfice – entendu ici largement, pas seulement au sens pécuniaire – qui est attendu en prenant un risque est un élément essentiel à inclure dans l’analyse. On acceptera éventuellement de prendre un risque relativement élevé parce qu’on espère obtenir un avantage significatif, alors qu’on rejettera une option faiblement risquée parce qu’elle semble infructueuse ou qu’un résultat similaire peut être atteint par une voie encore moins risquée[22]. Cette opération est nécessairement empreinte de subjectivité, car elle est avant tout une question de perception[23], qui fait notamment intervenir des facteurs culturels et psychologiques, certains individus étant plus enclins que d’autres à prendre des risques[24]. C’est pourquoi « concluding that an activity is safe enough is a judgement based on both science and value »[25].
Quand un risque n’est pas considéré comme acceptable, la personne, l’entreprise ou l’institution qui est exposée à ce risque est alors amenée à réagir et à prendre des décisions qui visent à permettre d’éviter le risque, de le réduire à un niveau acceptable ou encore de le transférer vers un tiers[26].
- – Risque, droit et État – La notion de risque imprègne la société ; elle pénètre également en profondeur le droit qui la régit. De manière fondamentale, si l’on accepte de considérer que la norme de droit est essentiellement un acte qui vise à influencer le comportement des individus[27], on comprend que la norme encadre la manière dont ces derniers prennent des décisions, d’agir ou de ne pas agir, notamment face à des risques[28]. L’État, en tant que producteur de droit, est dès lors un acteur majeur dans l’appréhension des risques. Le droit, en ce qu’il oblige à faire ou à ne pas faire certaines choses, réduit le faisceau de choix disponibles dans un contexte donné et influence le rapport au risque. Ainsi, la règle qui oblige un conducteur à porter la ceinture de sécurité au volant vise essentiellement à le protéger contre le risque significatif d’être expulsé de son véhicule en cas d’accident. Plus encore, en régissant la conduite d’autrui, le droit cherche souvent à réduire considérablement certains risques : l’interdiction du meurtre – dans un ordre juridique où sa transgression est effectivement susceptible d’entraîner des sanctions – diminue le risque qu’un individu soit volontairement tué par un autre. À cet égard, on peut affirmer que l’État, par l’intermédiaire des normes, crée un risque, à savoir celui de subir la punition prévue par le droit, pour dissuader les individus d’adopter les comportements réprouvés[29].
Les théoriciens du contrat social ne s’y sont pas trompés[30]. On sait que, pour Hobbes, l’État vise avant tout à sortir les individus « de ce misérable état de guerre »[31] qu’est l’état de nature, où chacun a recours « à ses propres forces et à son art afin de se protéger des autres »[32] ; l’État est dès lors institué pour assurer « leur paix et leur défense commune »[33]. Pour éviter que les individus ne soient livrés à la merci les uns des autres, l’État adopte des lois qui restreignent leur liberté, mais les « chaines artificielles »[34] qui sont ainsi imposées aux individus sont globalement acceptées, « non parce qu’il est difficile de les rompre, mais parce qu’il y a danger à les rompre »[35].
Si, jusqu’au 19e siècle, le rôle des États et du droit est demeuré essentiellement confiné à la protection des individus contre les risques causés par la violence d’autrui, on observe que les choses ont significativement évolué depuis lors : il suffit de penser au développement de l’État-providence (dont l’objectif peut se résumer à la protection des individus contre le risque d’une perte de revenus que peuvent engendrer divers évènements comme la maladie, l’accident ou le chômage[36]) ou, ultérieurement, du principe de précaution (qui invite les États à adapter leur action en tenant compte de certains risques pour l’environnement ou la santé publique).
Ces illustrations d’une tendance sont des concrétisations juridiques des constats opérés par les sociologues à propos de la société du risque. L’un d’eux affirme ainsi que « l’État devient l’ultime instance de transformation des dangers en risques »[37]. Même si nous n’avons formulé ici que des indications incomplètes et sommaires sur un vaste sujet, il nous semble que notre propos suffit à confirmer ce que d’autres ont par ailleurs déjà démontré, à savoir que « [l]a société du risque a des conséquences en matière de théorie de l’État »[38]. Il n’y a dès lors rien d’étonnant à constater que la gestion du risque est devenue un élément central dans l’activité quotidienne des gouvernements[39] et que de nombreux préjudices aux personnes, aux biens ou à la collectivité sont ressentis comme des défaillances de l’État dans cette gestion[40].
- – Risque et droits fondamentaux – Dans le présent article, nous n’ambitionnons évidemment pas de développer une théorie générale des rapports entre les notions de risque et de droit (ou d’État). Nous nous focalisons sur les liens entre le concept de risque et le domaine particulier des droits fondamentaux. À cet égard, nous partons du constat que l’existence d’un risque caractérisé peut être un élément factuel qui crée, ou contribue à créer, dans le chef de l’État, une obligation juridique d’agir, ou de ne pas agir, afin d’empêcher la survenance de situations qui seraient incompatibles avec un droit fondamental. En d’autres mots, pour respecter son obligation d’assurer l’effectivité des droits fondamentaux consacrés par la Convention européenne des droits de l’homme, l’État doit chercher à identifier le risque que survienne un évènement de nature à engendrer la violation d’une disposition et réagir adéquatement face à ce risque.
D’autres auteurs ont déjà montré l’importance que joue la notion de risque dans le champ des droits fondamentaux. À côté de travaux qui portent sur des droits particuliers[41], nous pointons ici les passionnants articles de Christopher Hilson[42] et de Letizia Seminara[43] dont la portée est plus transversale. Ces travaux antérieurs constituent des sources d’inspiration majeures, mais notre étude s’en distingue par les deux approches complémentaires de la jurisprudence (juridico-linguistique et juridico-économique).
- – Risque et Cour européenne des droits de l’homme – Certes, ce sont, en première ligne, les autorités politiques (pouvoirs législatifs et exécutifs) ainsi que les administrations qui, pour assurer le respect des droits fondamentaux dont l’État est débiteur, identifient, évaluent et prennent en considération certains risques. Toutefois, les juges – notamment la Cour européenne des droits de l’homme – prennent une place significative dans la société du risque[44] et sont aussi susceptibles d’être confrontés à ce type d’exercice, à tout le moins pour opérer un contrôle sur la manière dont d’autres autorités ont appréhendé un risque dans une situation antérieure (risque qui s’est matérialisé ou non par un dommage[45]) ou sur la manière dont elles gèrent un risque actuel qui pourrait déboucher sur un dommage futur[46]. Un auteur affirme ainsi que « there is, therefore, no need to show […] direct harm as such: all that is needed is to establish the existence of a risk as part of an […] impact risk assessment»[47].
II – Comment la Cour européenne des droits de l’homme évalue-t-elle le risque ?
- – Deux approches complémentaires de la jurisprudence –Les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme qui abordent la notion de risque se comptent par centaines[48]. Il n’est dès lors pas possible de peindre ici un portrait précis et détaillé de la manière dont la notion est traitée par cette jurisprudence foisonnante. Les matières concernées sont elles aussi très nombreuses, même s’il apparaît que les enjeux liés aux articles 2, 3 et 8 sont prédominants[49]. Dans les lignes qui suivent, nous nous concentrerons sur les questions les plus couramment abordées par la Cour, avec l’ambition d’esquisser modestement quelques tendances qui ressortent d’un premier examen de la masse de décisions disponible.
Pour ce faire, nous proposons d’analyser la jurisprudence avec deux approches différentes. Nous nous essaierons d’abord à un examen juridico-linguistique qui vise à recenser les principales expressions que la Cour utilise couramment pour traiter de ces cas et à préciser leur portée (A). Dans un second temps, nous tenterons une approche qu’on pourrait qualifier de juridico-économique, en ce qu’elle cherchera à appliquer les grands principes de la théorie de la gestion du risque à cette même jurisprudence, avec l’intention de contribuer à une lecture originale des arrêts de la Cour (B).
A – Essai d’approche juridico-linguistique
- – Une multitude de formules pour évoquer le risque – La première approche vise à identifier ce que la Cour considère comme un risque dont elle est susceptible de tirer des conséquences juridiques. Nous sommes donc en particulier à la recherche des qualificatifs que la Cour emploie pour caractériser le risque qui retient son attention. Il ressort de notre examen que plusieurs expressions différentes sont utilisées dans les passages-clés des arrêts étudiés[50].
Parmi les formules les plus courantes, on trouve les suivantes : « risque réel », « risque réel et immédiat »[51], « risque sérieux », « risque élevé » ou encore « risque important ». À ces formules, correspondent grosso modo les suivantes en langue anglaise : « real risk », « real and immediate risk », « serious risk », « high risk » et « significant risk ». On observe toutefois quelques inconstances dans les traductions[52]. Ainsi, à l’expression « real and immediate risk » correspond en principe celle de « risque réel et immédiat »[53], mais aussi, parfois, celle de « risque certain et immédiat »[54], voire de « risque certain et imminent »[55] [56] ; dans d’autres cas encore, la version française comporte une périphrase qui désigne un individu « menacé de façon réelle et immédiate »[57]. On ne trouve pas non plus une correspondance parfaite entre les expressions « serious risk » et « risque sérieux ». Il arrive, par exemple, que les mots « serious risk » soient traduits, dans la version en français du même arrêt, par l’expression « risque important »[58] ; inversement, on trouve des cas où les termes « risque sérieux », en français, sont traduits par « substantial risk », en anglais[59]. Dans un arrêt récent, on a pu relever une phrase où le mot « risk » est utilisé deux fois, dans la version anglaise, et est traduit une fois par le mot « risque » et une autre par le mot « danger », dans la version française[60].
Ces observations laissent entrevoir une certaine variabilité dans la terminologie que la Cour utilise, variabilité qui pourrait se refléter dans des imprécisions conceptuelles. Malgré des nuances et des zones de flou dont on ne peut pas rendre compte ici, l’examen de la jurisprudence permet toutefois de dégager quelques tendances relativement marquées. En effet, certains types de contentieux appellent le recours à des expressions particulières, qui donnent des indications sur la manière dont la Cour aborde la notion de risque.
- – Le risque réel et immédiat – Dans de nombreuses affaires qui concernent l’article 2 de la Convention, la Cour accorde une attention particulière à ce qu’elle qualifie de « risque réel et immédiat ». Elle considère qu’un État viole le droit à la vie s’il n’a pas pris de mesure adéquate pour prévenir la matérialisation d’un risque réel et immédiat qui pesait sur la vie d’un individu identifié[61]. Il s’agit en principe de situations où le dommage craint n’a pas été infligé par les autorités[62], mais où celles-ci auraient dû intervenir pour essayer de réduire le risque que le dommage survienne. Le cas de figure-type est celui où une personne était menacée par un tiers, qui a finalement mis en œuvre ses intentions criminelles, sans en être empêché par les autorités, alors qu’elles connaissaient le risque ou auraient dû le connaître[63]. Par ailleurs, la même approche est empruntée dans des cas de décès survenus dans des institutions de soin, où on reproche aussi aux autorités de ne pas avoir pris des mesures suffisantes pour empêcher des décès évitables[64]. La Cour utilise aussi cette formule quand une personne s’est suicidée alors qu’elle se trouvait sous la responsabilité de l’État (en général, dans un contexte pénitentiaire ou militaire)[65], même si la Cour a pu laisser penser qu’un risque réel (pas nécessairement immédiat) suffisait à déclencher la responsabilité de l’État dans ce genre de cas[66].
Par-delà le champ de l’article 2, la notion de risque réel et immédiat a aussi servi de critère pour déterminer l’existence d’une obligation fondée sur d’autres dispositions de la Convention. Ainsi, un État viole l’article 3 de la Convention s’il ne réagit pas par des mesures raisonnables alors que les autorités « avaient ou auraient dû avoir connaissance de l’existence d’un risque réel et immédiat pour un individu identifié de subir des mauvais traitements du fait des actes criminels d’un tiers »[67]. Un raisonnement similaire a été appliqué dans quelques affaires où les droits protégés par l’article 4 étaient en jeu[68].
La question majeure est de savoir ce que signifient les adjectifs « réel » et « immédiat » ; or la Cour ne livre pas de définition générale de ces termes. On peut même considérer qu’un certain mystère règne autour de la portée de ces mots. Si l’on s’appuie sur une définition courante du mot « réel », on devrait considérer qu’il s’agit d’un risque « qui existe d’une manière autonome, qui n’est pas un produit de la pensée »[69]. Entendu de cette façon, l’adjectif « réel » (parfois remplacé par l’adjectif « certain » dans les arrêts en français) n’indiquerait pas un niveau particulier de risque, mais pourrait signifier que la Cour ne prend en considération que les dommages potentiels dont la survenance est objectivement démontrable, en tant que conséquences – ce qui suppose la preuve d’une certaine causalité[70] – d’une situation sur laquelle les autorités avaient une certaine maîtrise. Quant au caractère « immédiat » du risque, il implique vraisemblablement que le dommage potentiel est en voie de matérialisation. On peut comprendre, à la lecture de certains arrêts, que le critère est satisfait quand des menaces paraissent conduire à « une mise en exécution imminente »[71]. Nous avons d’ailleurs vu qu’en français, la Cour oscille entre les adjectifs « immédiat »[72] et « imminent »[73] (le second indiquant sans doute davantage la proximité chronologique du dommage potentiel), alors qu’elle emploie systématiquement « immediate » en anglais. Cependant, dans de nombreuses affaires, la Cour donne l’impression de se référer à l’expression « risque réel et immédiat » comme à un tout dont les deux éléments se confondent et ne les distingue guère quand elle intègre les faits concrets de l’affaire dans son raisonnement.
Dans les cas où un risque pour la vie ne pèse pas sur un ou plusieurs individus identifiés, mais sur la société en général, il arrive que la Cour européenne des droits de l’homme se distancie, au moins formellement, des adjectifs qu’elle utilise d’habitude, pour considérer que l’autorité doit prendre des mesures « adaptées au niveau de risque », afin de protéger un droit fondamental, tel que le droit à la vie[74]. Ainsi, à propos des risques engendrés par certaines activités humaines dangereuses, la Grande chambre a jugé qu’il convient de « réserver une place singulière à une réglementation adaptée aux particularités de l’activité en jeu notamment au niveau du risque qui pourrait en résulter pour la vie humaine »[75]. Cette approche a été réitérée dans de nombreuses affaires[76] ; elle a aussi été développée dans le domaine des risques de catastrophes naturelles, où l’arrêt Boudaïeva sert de référence jurisprudentielle majeure[77]. Sont aussi à rapprocher de cette catégorie les affaires relatives à des individus dangereux qui ont porté atteinte à la vie de personnes qu’on n’aurait pas pu identifier à l’avance (à défaut de menace ciblée). On pense spécialement au cas où un individu armé a tiré au hasard sur des inconnus[78]. Le critère du risque réel et immédiat apparaît malgré cela dans certaines affaires qui relèvent de ces catégories[79], ce qui engendre parfois un certain flou sur ce que la Cour attend des autorités étatiques[80].
- – Le risque (simplement) réel – On rencontre aussi des situations où la Cour européenne des droits de l’homme se réfère à la notion de risque réel, sans avoir recours au critère de l’immédiateté. Les affaires concernées ont un point commun : il s’agit de situations où l’autorité étatique est à la manœuvre, doit prendre une décision ou mener une action, et est alors tenue de prendre en considération les conséquences potentielles de son intervention. Contrairement aux situations évoquées dans le paragraphe précédent, où l’autorité est a priori passive et en retrait, on a ici affaire à une autorité active, dont la démarche pourrait contribuer à augmenter un risque de dommage.
Concrètement, cette configuration se présente le plus souvent dans un genre particulier de contentieux. On recense en effet de nombreuses affaires qui portent sur l’expulsion ou l’extradition d’une personne vers un État étranger et où la Cour se demande s’il existe un risque réel qu’il y soit exécuté (ce qui emporterait une violation de l’article 2)[81], qu’il y soit soumis à la torture ou à des mauvais traitements (article 3)[82], qu’il y subisse une privation arbitraire de liberté (article 5) [83], ou encore qu’il y soit exposé à un déni de justice flagrant (article 6)[84]. À côté des affaires qui concernent des expulsions du territoire, la Cour a aussi cherché à savoir s’il existait un risque réel de mauvais traitement en cas de réincarcération d’un individu[85]. Dans la même logique, sous l’angle de l’article 5, elle a considéré qu’une décision d’internement forcée pouvait constituer un risque réel d’être empêché de se prévaloir des voies de recours prévues par la loi[86]. À chaque fois, on se demande si l’autorité avait suffisamment anticipé les conséquences de ses propres décisions.
L’absence de référence à la notion d’immédiateté semble ici logique : quand on examine la situation d’une personne avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, le risque qu’elle subisse les conséquences dommageables de cette décision ne se conçoit pas comme immédiat – dans le sens d’imminent – puisque sa matérialisation dépend, notamment, de la décision encore à prendre.
- – Le risque autrement qualifié – La Cour utilise divers autres adjectifs pour évoquer les risques dont elle tire des conséquences juridiques dans ses raisonnements : risque sérieux, risque important, risque élevé, risque certain, etc.
Parfois, ces expressions semblent être utilisées à la place des termes « risque réel » et signifier (à peu près) la même chose, c’est-à-dire qu’elles impliquent une obligation à charge de l’État d’essayer de prévenir la matérialisation du risque que ses propres décisions contribuent à engendrer. Ainsi, dans de nombreuses affaires relatives à l’expulsion d’individus vers un État où ils pourraient être victimes d’une violation de la Convention, la Cour emploie l’expression « risque sérieux »[87], plutôt que « risque réel », qu’elle utilise dans d’autres cas similaires. Pour prendre un exemple différent, on relève que la Cour s’est aussi demandée si l’incarcération d’une personne condamnée pour crime de guerre contre des Bosniaques, dans un établissement pénitentiaire dont la population est composée à 90% de Bosniaques, ne constitue pas un risque sérieux pour son intégrité physique[88].
Dans d’autres affaires, ces formules diverses (surtout celles de « risque important » et de « risque élevé ») servent à évoquer un niveau de risque qui contribue à justifier, aux yeux de la Cour, qu’un État ait pris des mesures qui impliquent une ingérence dans un droit fondamental. On recense par exemple plusieurs cas où le « risque important » pour la société que représente un individu permet à l’autorité de le priver de sa liberté sans violer l’article 5 de la Convention[89]. De la même façon, un régime strict de visite pour un détenu, et donc une restriction à son droit à la vie familiale protégé par l’article 8, a pu trouver une légitimité dans le risque important qu’un détenu soit de connivence avec d’autres coaccusés ou qu’il entrave la procédure judiciaire avec l’aide de visiteurs[90]. Dans d’autres cas, la Cour se demande si le profil particulier d’un individu – et, partant, le « risque élevé » qu’il engendre pour autrui (spécialement pour la prévention des droits fondamentaux d’autrui) – peut justifier des mesures qui affectent l’un de ses droits fondamentaux[91]. Dans ces derniers cas, on ne reproche pas à l’État d’avoir violé un droit fondamental en ne réagissant pas adéquatement à un risque ; on estime, au contraire, que l’État tire du risque une justification pour restreindre un droit sans le violer.
- – Bilan de la première approche – L’approche linguistico-juridique que nous avons développée aide à comprendre certains aspects de la logique que la Cour déploie lorsqu’elle aborde la notion de risque dans ses arrêts. Elle donne quelques repères sur les standards auxquels la Cour se réfère couramment. La terminologie employée donne cependant peu d’indications sur le niveau du risque qui engendre une obligation ; elle porte plutôt sur la preuve de l’existence d’un risque. En particulier, lorsque la Cour se demande s’il existe un risque réel (et immédiat) qu’un évènement dommageable se produise, elle pose principalement la question de savoir si le risque est objectivement démontrable, voire – quand elle utilise l’adjectif « immédiat » – si ce risque a un caractère manifestement apparent, quasiment palpable.
B – Essai d’approche juridico-économique
- – Présentation de l’approche complémentaire – Compte tenu de ce qui précède et pour compléter la réflexion, nous proposons d’analyser la jurisprudence d’une autre façon et de tenter d’y appliquer une grille de lecture basée sur les éléments qui structurent la théorie de la gestion des risques, c’est-à-dire les notions de gravité, de probabilité et d’acceptabilité, évoquées précédemment[92]. Par cette démarche, nous cherchons, dans les arrêts de la Cour, les traces du raisonnement qui est typiquement mis en œuvre dans les processus d’évaluation des risques. Il n’est pas question de soutenir que la Cour devrait recourir de façon plus explicite à des techniques qui sont habituellement utilisées par des gestionnaires ou des ingénieurs : notre démarche ne doit pas être comprise comme un appel à la rationalisation, voire à la mathématisation, du raisonnement des juges[93]. D’ailleurs, les controverses qui animent les spécialistes de l’analyse du risque incitent à la prudence au moment où entreprend de transposer dans le champ juridique des notions qui sont sujettes à discussion dans la discipline qui les a produites[94]. L’ambition est de développer une grille de lecture originale pour essayer de mieux comprendre la manière dont les juges évaluent les risques et en tirent des conséquences.
- – La gravité dans la jurisprudence de la Cour – Le premier élément à examiner est le concept de gravité. Plus le dommage que l’on craint est grave, plus le niveau du risque est élevé et doit en principe susciter des réactions pour le maîtriser.
Dans le champ de la Convention européenne des droits de l’homme, on pourrait partir de l’idée que toute situation qui emporte une violation d’un droit correspond nécessairement à un dommage grave. Si une disposition quelconque de la Convention qui consacre des droits considérés comme fondamentaux est violée, on peut affirmer que le dommage est grave. Cependant, et sans pour autant mettre l’affirmation précédente en cause, on ne peut pas appliquer un raisonnement aussi simple à la réflexion que nous menons autour de la notion de risque. En effet, dans les affaires qui nous intéressent, on ne demande pas à la Cour s’il existe ou s’il existait un risque de violation d’un droit fondamental, mais s’il existe ou s’il existait un risque qu’un évènement dommageable se produise et si l’attitude de l’État face à ce risque est compatible avec les dispositions de la Convention. Ainsi, dans les nombreuses affaires relatives à l’article 2, la Cour ne se demande pas si, avant que ne survienne le décès, il y avait un risque de violation du droit à la vie ; elle s’interroge sur la question de savoir s’il existait un risque caractérisé que survienne un décès et si l’État a adéquatement réagi pour essayer de prévenir ce décès. Autrement dit, l’évaluation de la gravité ne peut pas directement concerner la question de la violation de la Convention, qui ne sera tranchée qu’au bout du raisonnement de la Cour, mais devra porter sur un évènement potentiel dont la survenance, dans un contexte particulier, pourrait produire une violation de la Convention.
La Cour est donc amenée à rechercher l’existence d’un dommage éventuel qui est suffisamment grave pour soulever une question au regard de la Convention. On sait que l’évaluation de la gravité intervient dès l’examen de la recevabilité, notamment en ce que la Cour doit vérifier si le requérant peut faire valoir un préjudice important[95]. Il est vrai que cette règle ne s’applique en principe pas quand on se trouve dans le champ de l’article 3 de la Convention, dont la portée est absolue[96]. Le constat d’absence de préjudice important s’accommode en outre assez mal avec les affaires où la vie d’une personne est en jeu. Ceci relativise donc le rôle de cette condition de recevabilité dans la jurisprudence qui concerne le risque, puisque ces deux dispositions y occupent une grande place. Toutefois, l’analyse de la gravité se poursuit avec l’étude du fond de l’affaire[97]. Dans nombre de cas, la Cour recherche en effet si le préjudice dépasse un certain « seuil de gravité »[98] ; cette opération signifie que le degré de gravité doit être évalué et que, en dessous d’un certain niveau, la situation est présumée ne pas emporter de violation de la Convention. En revanche, lorsque la barre est franchie, on se situe dans une zone d’alerte. Quand un risque de dommage suffisamment grave est identifié, il convient de faire intervenir les autres paramètres (probabilité et acceptabilité) pour décider si, finalement, une violation de la Convention est identifiée. Une difficulté particulière découle de ce que, selon la Cour, l’appréciation du niveau minimal de gravité est elle-même relative et dépend de l’ensemble des données de la cause[99] : cela correspond, à nos yeux, à une certaine agrégation, voire à une confusion, des raisonnements sur la gravité et l’acceptabilité du risque.
Nous avons vu qu’une partie considérable des affaires où la notion de risque est en jeu correspond à des cas où une personne est sur le point d’être expulsée vers un État étranger. Dans ces affaires, où le dommage aura potentiellement lieu ailleurs, on peut se demander si le niveau de gravité qui alerte la Cour est le même que s’il s’agissait d’un dommage à considérer sous la juridiction (sur le territoire) de l’État attaqué. On pourrait en effet être tenté de penser que l’extranéité est susceptible de provoquer une forme d’estompement dans l’évaluation, qui mènerait la Cour à développer des standards différents – éventuellement moins stricts – quand la matérialisation du risque est susceptible d’intervenir en dehors des frontières européennes. Cette direction ne semble pas être prise, en tout cas quand il s’agit d’affaires articulées sur les articles 2 ou 3 de la Convention. On sait que la Cour considère, de façon constante, qu’il s’agit d’apprécier s’il existe un risque réel que celui qu’on envisage d’expulser vers un autre pays y soit « soumis à la peine de mort »[100] ou y « soit soumis […] à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention »[101]. Ce qui est grave au regard de la Convention dans l’État qui entend expulser quelqu’un est donc également grave dans l’État de destination. En revanche, la situation pourrait être différente quand on se trouve – ce qui est certes plus rare – dans le champ d’autres dispositions. Ainsi, la Cour a estimé « qu’un État contractant méconnaîtrait l’article 5 de la Convention s’il renvoyait un requérant vers un État où l’intéressé serait exposé à un risque réel de violation flagrante de cette disposition »[102]. Dans la même optique, elle a aussi jugé que l’article 6 serait violé en cas de déni de justice flagrant[103]. La Cour s’est expliquée elle-même sur la portée de l’adjectif « flagrant » : il renvoie à une situation qui est manifestement incompatible avec la disposition concernée ou les principes qui y sont intégrés[104]. Cela n’a pas échappé à la littérature qui considère que « the use of the adjective is clearly intended to impose a stringent test of unfairness going beyond mere irregularities or lack of safeguards in the trial procedures such as might result in a breach of Article 6 if occurring within the Contracting State itself »[105]. Ce qui peut être qualifié de grave, dans l’évaluation du risque, dépend dès lors aussi de ces considérations. - – La probabilité dans la jurisprudence de la Cour – Dans la pratique, l’évaluation de la probabilité qu’un évènement dommageable se produise n’est pas menée de façon parfaitement isolée de l’examen de sa gravité. On peut par exemple être amené à estimer, à propos d’une situation donnée, que tel dommage, de gravité moyenne, est hautement probable, mais que tel autre, de gravité majeure, est moins probable. On observe cependant que, dans nombre d’affaires, la Cour européenne des droits de l’homme consacre une réflexion particulière à la question de la probabilité.
Il convient d’abord de revenir sur la difficulté d’évaluer la probabilité, difficulté que rencontre notamment la Cour. En réalité, un calcul de probabilité convient mieux à une question générale (le risque d’incendie en général), qu’à une situation particulière (le risque d’incendie dans un immeuble donné), où on recourt à cette opération, en basant des calculs statistiques sur les données générales disponibles, à défaut de mieux[106]. C’est aussi, dans une certaine mesure, ce que fait la Cour européenne des droits de l’homme, qui est toujours saisie de situations particulières. Deux grands cas de figure peuvent se présenter : soit la Cour est saisie à propos d’un prétendu risque actuel (le dommage éventuel est futur) et doit apprécier l’attitude actuelle de l’autorité publique face au risque, soit la juridiction est saisie à propos d’un prétendu risque passé (le dommage éventuel – qui s’est finalement produit ou non – est lui aussi passé[107]) et il convient d’examiner a posteriori comment l’autorité y a réagi. Dans le premier cas, l’incertitude est manifeste au moment où les juges s’interrogent sur la probabilité d’un évènement. Dans le second, le déroulement des évènements postérieurs est connu (et n’est donc forcément plus incertain), mais la Cour doit réfléchir, pour évaluer la probabilité du dommage, comme si elle n’en avait pas connaissance[108]. Or, l’être humain lambda – mais peut-être, dans une certaine mesure, le juge aussi – a une certaine tendance à rétrospectivement considérer le risque avec une plus grande sévérité quand est un accident est finalement survenu[109].
L’évaluation de la probabilité est au cœur des affaires qui portent sur un risque. Ainsi, la Cour rappelle que l’obligation pour les États, fondée sur l’article 2, de réagir à certains risques « doit s’interpréter comme valant dans le contexte de toute activité, publique ou non, susceptible de mettre en jeu le droit à la vie » (« in which the right to life may be at stake »)[110]. Nous pensons qu’elle s’appuie déjà sur une idée de probabilité, car elle vise en réalité des situations ou des activités où la probabilité de mourir est plus grande que dans d’autres activités – qui, toutes, impliquent un certain risque pour la vie. Nous allons montrer, à travers deux exemples, comment elle effectue concrètement une analyse de probabilité.
Les affaires relatives à l’expulsion d’individus vers un État étranger fourniront la première illustration. Dans ces cas, pour déterminer la probabilité qu’un évènement grave (typiquement, des mauvais traitements) survienne après le renvoi, la Cour se fonde sur plusieurs éléments[111]. Parmi ceux-ci, on relève deux types de données qui jouent souvent un rôle décisif. D’une part, la Cour se réfère au contenu de rapports, produits par diverses organisations ou des sources gouvernementales, qui décrivent la situation quant au respect des droits fondamentaux dans l’État de destination, et qui indiquent parfois que telle catégorie d’individus subit régulièrement des violences, dans tel contexte, comme celui de l’incarcération[112]. D’autre part, la Cour prend en considération l’existence éventuelle de garanties diplomatiques données par les autorités de cet État, de ne pas agir d’une façon qui entraînerait une violation de la Convention, dans le cadre de l’affaire examinée[113]. Des auteurs ont pu remarquer que la juridiction strasbourgeoise tendait parfois à considérer que, en cas de renvoi vers un pays européen, il existait une présomption de faible probabilité qu’un traitement incompatible avec la Convention se produise[114]. Cette approche de la Cour semble contestable quand on sait qu’elle condamne elle-même ces États pour diverses violations. Toutefois, les mêmes auteurs ajoutent que le célèbre arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce[115] montre une conception différente, où la Cour ne fait pas une confiance aveugle aux États membres[116]. Il semble aussi qu’à l’inverse, la Cour tende parfois à présumer que certains États tiers ne sont pas sûrs[117], ce qui revient à considérer que la probabilité que survienne un dommage y est plus élevée. De façon plus générale, la Cour n’attend pas que le requérant démontre une forte probabilité de mauvais traitement, pour autant qu’il apporte une preuve crédible et substantielle du risque[118].
À titre de seconde illustration, nous nous intéressons aux cas où la Cour est saisie après qu’un individu, placé sous la surveillance rapprochée de l’autorité publique, a commis un suicide. Dans chaque situation particulière, il s’agit de se demander si les éléments de contexte montraient que la survenance de l’acte fatal était relativement probable. Peuvent ainsi être pris en compte, parmi d’autres considérations, le dossier médical de l’intéressé[119], son comportement éventuellement instable ou alarmant[120] ou encore le fait qu’il ait déjà tenté de se suicider[121]. - – L’acceptabilité dans la jurisprudence de la Cour – Il reste à se demander si on peut trouver, dans la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme, des traces d’un raisonnement sur l’acceptabilité du risque. Cette ultime tâche consiste notamment à rechercher si la Cour reconnait que l’État peut ignorer certains risques (prendre une décision ou s’abstenir d’agir malgré l’existence de ceux-ci), sans pour autant violer la Convention. Nous esquissons ici quatre pistes de réponse à cette question.
Premièrement, les juges de Strasbourg affirment régulièrement que tout risque n’implique pas une obligation pour l’État de le prévenir et insistent sur le fait que l’obligation positive « ne doit pas être interprétée de manière à imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif »[122]. Au fond, la Cour reconnait que les États ont, dans les faits, une capacité et des moyens limités avec lesquels ils doivent œuvrer. Dans cette perspective, la haute juridiction estime par exemple que, « eu égard aux difficultés pour la police d’exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines », il existe des « choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources »[123]. Les difficultés auxquelles l’État est confronté sont d’autant plus grandes en raison de « l’imprévisibilité du comportement humain »[124]. Dès lors que l’État ne dispose pas de moyens infinis, notamment en termes de ressources humaines et financières[125], on doit admettre qu’il ne puisse détecter et gérer tous les risques qui pourraient poser question au regard de la Convention[126]. Quant à savoir comment il doit allouer ses moyens, la Cour laisse bien entendu à l’État une marge d’appréciation relativement large, pour déterminer ses priorités[127].
Deuxièmement, on peut observer que d’autres considérations, qui découlent de la dynamique globale de la Convention, sont de nature à rendre certains risques acceptables. Si l’autorité dispose des ressources utiles pour rechercher les risques et y réagir, elle n’a en effet pas le droit de mettre tout en œuvre pour parvenir à ses fins – mêmes les plus louables, comme la protection de la vie des personnes. Ainsi, en ce qui concerne la prévention de la violence, la Cour affirme qu’il convient de tenir compte de « la nécessité de s’assurer que la police exerce son pouvoir de juguler et de prévenir la criminalité en respectant pleinement les voies légales et autres garanties qui limitent légitimement l’étendue de ses actes d’investigations criminelles et de traduction des délinquants en justice, y compris les garanties figurant aux articles 5 et 8 de la Convention [qui, respectivement, interdisent les arrestations arbitraires et protègent la vie privée et familiale] »[128]. Ceci implique que l’État ne peut pas être à l’affût de tout risque, quand bien même il en aurait les moyens pratiques. Ces limites juridiques à la capacité de l’État s’ajoutent aux limites matérielles évoquées juste avant ; elles sont particulièrement importantes dans une société en pleine évolution, dont les technologies conduisent précisément à repousser certaines limites matérielles, grâce, par exemple, à des dispositifs qui permettent d’évaluer le risque criminel en temps réel.
Troisièmement, le caractère absolu de l’article 3 doit aussi être pris en considération dans la réflexion sur l’acceptabilité. Il y a en effet lieu de se demander si certaines circonstances pourraient rendre acceptable un risque avéré de mauvais traitement. À cette question, la Cour répond négativement et juge par exemple que le risque que présente un individu pour la collectivité, s’il n’est pas expulsé vers l’étranger, ne doit pas être mis en balance avec le risque qu’il subisse un préjudice en cas de refoulement. Le risque de mauvais traitement, une fois reconnu, n’est donc en principe jamais acceptable[129].
Enfin, quatrièmement, il paraît intéressant de se demander si le fait qu’un individu soit conscient du risque auquel il s’expose, voire l’accepte lui-même, tend à rendre le risque juridiquement acceptable au point de déresponsabiliser l’État. À cette dernière question, il convient d’apporter une réponse nuancée. Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme est disposée à prendre en compte le fait qu’une personne choisisse de demeurer à proximité d’une source de nuisance[130] ; mais elle évalue la situation globale des intéressés en tenant en particulier compte des mesures prises par l’autorité pour les informer des risques[131] et de leur capacité concrète à déménager en dehors de la zone considérée[132]. Par ailleurs, dans un cas qui nous semble particulièrement intéressant pour la question examinée, la Cour a jugé que les obligations positives fondées sur l’article 2 « should not be unduly impaired by paternalistic interpretations, bearing in mind that the notion of personal autonomy is an important principle underlying the Convention guarantees, primarily those pertinent to private life »[133]. On voit qu’on rejoint ici la perspective que nous avons développée supra, à propos des limites à la capacité de l’État qui découlent des autres règles de la Convention. En l’espèce, la Cour recherchait la responsabilité éventuelle de l’État dans le décès d’une personne, survenu dans le contexte d’un jeu, organisé à la suite d’une initiative privée, qui impliquait des déplacements en voiture dans le trafic urbain. La Cour a accordé une grande importance au fait que la personne décédée était un adulte, qui avait joui de sa liberté d’agir et décidé de participer à ce jeu de son plein gré, en prenant ainsi sur lui la responsabilité de suivre ses règles[134]. Il y a donc une place pour la prise en compte de l’attitude des individus face aux risques, même si celle-ci ne va pas jusqu’à exonérer complètement l’État de toute forme d’obligation conventionnelle. - – Bilan de la seconde approche – L’approche juridico-économique de la jurisprudence, articulée sur les trois éléments de base de la gestion du risque, apporte des enseignements complémentaires à ceux que la première approche a fournis. L’examen – rudimentaire – que nous avons mené présente des limites, parce qu’il est construit sur la base de quelques exemples choisis dans une jurisprudence foisonnante ; mais il permet d’apercevoir que le raisonnement typique des analystes du risque peut, dans une certaine mesure, être transposé à la réflexion juridique que la Cour développe dans les affaires qui portent sur le risque. Les juges de Strasbourg n’emploient pas – en tout cas pas systématiquement – le vocabulaire technique de l’analyse du risque, de sorte que les notions de gravité, de probabilité et d’acceptabilité n’apparaissent pas clairement comme des jalons de leur raisonnement. Ces concepts interviennent toutefois, au fil des arrêts, et sont souvent traduits ou transformés en notions davantage juridiques.
* * * * *
- Recherches futures et réflexion finale –
L’étude que nous présentons ici devra être poursuivie pour aboutir à des résultats plus riches. Chaque paragraphe du texte soulève des questions complémentaires, qui nécessitent des travaux plus approfondis. Il serait notamment opportun d’étudier de façon exhaustive la terminologie que la Cour européenne des droits de l’homme emploie pour traiter des risques, de systématiser l’exercice de transposition des notions économiques à la jurisprudence pertinente, de mieux intégrer la réflexion dans le cadre général développé par les nombreuses disciplines scientifiques qui s’intéressent au risque, ou encore de comparer les tendances de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme avec celles qui se dégagent des arrêts d’autres juridictions, nationales ou internationales.
L’analyse menée jusqu’ici met toutefois déjà en avant la complexité des questions auxquelles la Cour européenne des droits de l’homme doit faire face, lorsqu’elle est amenée à déterminer si l’attitude d’un État vis-à-vis d’une situation à risque est compatible avec la Convention européenne des droits de l’homme. Outre les difficultés techniques inhérentes à cette opération, il existe, derrière ces questions, des enjeux politiques considérables, qui tiennent au rôle protecteur de l’État et à ses rapports avec la liberté des individus. La Cour européenne des droits de l’homme, à travers la jurisprudence qui a servi de socle à l’analyse, contribue à assurer un équilibre délicat entre deux extrêmes : elle n’admet pas que l’État abandonne tous les risques de l’existence aux individus et fonde dès lors des obligations raisonnables sur la Convention, mais elle s’oppose aussi à un État surprotecteur qui serait amené àintervenir dans tous les aspects de la vie pour prévenir la matérialisation de risques divers.
Dans l’extrait de l’Arrache-Cœur mis en exergue du présent article, Boris Vian évoque une mère qu’une angoisse exacerbée conduit à prendre des mesures radicales pour préserver ses trois enfants des risques les plus fantaisistes. À la fin du roman, sa progéniture se trouve enfermée dans de petites cages confortablement aménagées, au sein d’une propriété où tout a été sécurisé, jusqu’à un point absurde. Un observateur de la scène l’analyse naïvement : « [ç]a devait être merveilleux de rester tous ensemble comme ça, avec quelqu’un pour vous dorloter, dans une petite cage bien chaude et pleine d’amour »[135]. Le rôle protecteur de l’État à l’égard des citoyens ne se confond certes pas avec l’attention d’une mère pour ses enfants, mais il peut connaître les mêmes dérives à défaut d’être encadré par un dispositif normatif solide et effectif.
[1] B. Vian, L’arrache-cœur, Paris, Vrille, 1953, [Paris, Fayard, 1996, p. 138].
[2] Voy. infra, n° 3.
[3] Voy. not. H. Riesch, « Levels of Uncertainty », in : S. Roeser et al. (éds.), Essential of Risk Theory, Dordrecht, Heidelberg, New York et Londres, Springer, 2013, pp. 29-56, ici p. 29 ; T. Aven, « Risk assessment and risk management : Review of recent advances on their foundation », European Journal of Operational Research, 2016, pp. 1-13, ici p. 4.
[4] H. R. Varian, Intermediate Microeconomics. A modern approach, 8e édition, New York et Londres, Norton, 2010, p. 217.
[5]5 Voy. not. N. Lhumann, « Risque et danger », in P. Eon, L’adaptation au changement climatique, Québec, 2013, pp. 100-101.
[6]6 Ainsi, le risque lié au danger que représente un serpent venimeux est presque nul quand l’animal est observé par un individu depuis l’extérieur d’un terrarium. Le même individu fait face à un risque plus grand s’il croise ce reptile, stressé et affamé, alors qu’il évolue dans son espace naturel.
[7] Mais, ainsi que le souligne Denis Kessler, le concept avait fait l’objet de travaux scientifiques importants, depuis la deuxième guerre mondiale, dans le champ de l’économie (D. Kessler, « Ulrich Beck et la société du risque », Commentaire, 2002, pp. 889-892, ici p. 889).
[8] U. Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1986. Pour la traduction en français, voy. La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, Paris, Aubier, 2001.
[9] U. Beck, La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, Paris, Aubier, 2001, p. 36.
[10] On peut se référer à un des ouvrages majeurs de ce sociologue allemand : N. Luhmann, Soziologie des Risikos, Berlin & New York, 1991. Ce livre n’a pas été traduit en français, mais est disponible en anglais : N. Luhmann, Risk. A Sociological Theory, New York, Routledge, 2002.
[11] Parmi d’autres travaux, on peut mentionner les deux suivants : U. Beck, A. Giddens et S. Lash, Reflexive Modernization, Stanford, Stanford University Press, 1994 ; A. Giddens, « Risk and responsibility », Modern Law Review, 1999, pp. 1-10.
[12] Pour une comparaison entre les pensées de Beck et de Luhmann, voy. par exemple, F. Le Bouter, « La sociologie constructiviste du risque de Niklas Luhmann », Communication et organisation, 2014, n° 45, pp. 33-48.
[13] On pense ici en particulier à Ch. Perrow, Normal Accidents. Living with High-Risk Technologies, Princeton, 1984 ; l’ouvrage traite avant tout de la puissance nucléaire, de la pétrochimie, des accidents maritimes et aériens, etc.
[14] F. Le Bouter, « La sociologie constructiviste du risque de Niklas Luhmann », Communication et organisation, 2014, n° 45, pp. 33-48, p. 35. Il suffit de jeter un coup d’œil à la littérature foisonnante sur l’évaluation des risques, qui portent sur tous les domaines imaginables. Nous mentionnons ici, à titre d’exemple, un ouvrage de référence : D. J. Paustenbach (éd.), Human and Ecological Risk Assessment. Theory and Practice, New York, Wiley, 2002, 1556 pages.
[15] D. Kessler, « Ulrich Beck et la société du risque », Commentaire, 2002, pp. 889-892, ici pp. 890-891.
[16] Voy. not. P. Peritti-Watel, La société du risque, 2e édition, Paris, La découverte, 2010, p. 3.
[17] T. Aven, « Risk assessment and risk management : Review of recent advances on their foundation », European Journal of Operational Research, 2016, pp. 1-13, ici p. 5.
[18] On trouve ainsi, dans la littérature, une distinction entre l’analyse du risque (risk analysis), qui est la partie objective du raisonnement, et l’évaluation du risque (risk evaluation), où des jugements de valeur, forcément subjectifs, interviennent. Voy. not. L. Wilson et D. McCutcheon, Industrial Safety and Risk Management, Edmonton, The University of Alberta Press, 2003, p. XIX.
[19] Voy. par exemple, A. Garlick, Estimating Risk. A management approach, Aldershot et Burlington, Gower, 2007, pp. 10-12 ; B. Fischhoff, « The realities of risk-cost-benefit analysis », Science, 2015, aaa6516-1. Certains auteurs proposent des critères supplémentaires pour une analyse systémique et holistique des risques, mais rappellent en même temps les deux éléments incontournables à la base de toute mesure du risque (voy. not. O. Renn et A. Klinke, « Systemic risks: a new challenge for risk management », EMBO Rep, 2004, pp. 41-46). Dans une large revue de la littérature, Terje Aven énonce les méthodes qui sont généralement admises pour calculer un risque en commençant par rappeler la base : « The combination of probability and magnitude/severity of consequences » (T. Aven, « Risk assessment and risk management : Review of recent advances on their foundation », European Journal of Operational Research, 2016, pp. 1-13, ici p. 4).
[20] L’une des difficultés majeures, dans la gestion de risques concrets, consiste à mesurer effectivement les deux paramètres, et spécialement celui de la probabilité. S’il est possible d’estimer la probabilité de certains évènements avec une assez grande précision, d’autres échappent largement ou entièrement aux capacités humaines de calcul (voy. déjà la différence entre « unmesureable uncertainty » et « mesureable one » élaborée en 1921 par F. H. Knight, Risk, uncertainty and profit, Boston et New York, Hougton Mifflin, 1921), ce qui peut notamment impliquer l’utilisation de méthodes qualitatives pour compléter l’approche probabiliste (T. Aven, « Risk assessment and risk management : Review of recent advances on their foundation », European Journal of Operational Research, 2016, pp. 1-13, ici p. 6). Se posent aussi des questions philosophiques fondamentales, qui touchent par exemple à la manière d’appréhender la causalité, notamment dans le domaine de l’analyse et de l’évaluation du risque (R. N., Anjum et E. Rocca, « From ideal to real risk : philosophy of causation meets risk analysis », Risk Analysis, 2019, pp. 729-740).
[21] La réflexion sur ce sujet remonte à plusieurs décennies. Voy. not. W. W. Lowrance, Of acceptable risk, Los Altos, Wiliam Kaufman, 1976.
[22]22 Voy. not. B. Fischhoff, S. Lichtenstein, P. Slovic, S. L. Derby et R. L. Kenny, Acceptable risk, Cambridge, Londres, New York, New Rochelle, Melbourne et Sidney, Cambridge University Press, 1981, p. 3.
[23] À ce sujet, voy. not. M. N. Funicane, « The Role of Feelings in Perceived Risks », in : S. Roeser et al. (éds.), Essential of Risk Theory, Dordrecht, Heidelberg, New York et Londres, Springer, 2013, pp. 57-74.
[25] T. Aven, « Risk assessment and risk management: Review of recent advances on their foundation », European Journal of Operational Research, 2016, pp. 1-13, ici p. 2.
[26]26 Voy. not. A. Garlick, Estimating Risk. A management approach, Aldershot et Burlington, Gower, 2007, p. 15.
[27] On s’appuie en particulier sur la définition de Hans Kelsen, selon lequel le droit « est un ordre ou règlement normatif de l’action humaine, c’est-à-dire un système de normes qui règlent la conduite d’êtres humains » (H. Kelsen, Théorie pure du droit, 2e édition, Paris, Dalloz, 1962, p. 6).
[28] On peut ajouter qu’en réduisant la liberté, en dirigeant les actions des individus dans certaines directions, le droit a vocation à réduire l’incertitude et donc le risque. On pourrait être tenté de répondre à cela que l’inflation normative qu’on observe ces dernières décennies (voy. déjà M. Friedmann et R. Friedmann, La liberté du choix, Paris, Belfond, 1980, p. 176) et la grande complexité qui caractérise de nombreuses règles créent des incertitudes quant aux solutions juridiques à apporter à diverses questions concrètes. C’est le problème de la sécurité juridique (ou plutôt de l’insécurité juridique) qui mériterait à lui seule une réflexion articulée sur la notion de risque.
[29] Ceci fait d’ailleurs apparaître un autre lien entre le risque et le droit, qu’on pourrait rattacher à l’analyse économique du droit (law and economics). On peut en effet considérer, sous cet angle, que la règle juridique est une donnée à prendre en compte parmi d’autres dans les choix que pose un individu et que, par exemple, la commission d’un acte interdit par le droit constitue simplement une prise de risque : l’individu espère tirer profit de l’acte infractionnel et accepte le risque de subir une sanction. L’un des auteurs fondateurs de cette approche, Richard Posner, suggère que l’efficacité annoncée repose sur un critère de maximisation de la richesse qui se traduit, dans le cadre du droit civil, par le fait qu’un agent « n’a aucune obligation à respecter son contrat dès lors que la violation du contrat permet d’augmenter la richesse et tant qu’il dédommage le cocontractant des conséquences de cette violation » (S. Ferey, « Histoire et méthodologie de l’analyse économique du droit contemporain », in : B. Deffains et E. Langlais, Analyse économique du Droit, Bruxelles, De Boeck, 2009, p. 29). Corrélativement, l’État cherche logiquement à établir des mesures suffisamment dissuasives pour restreindre, dans le chef des individus, la tentation d’agir illégalement. On peut ainsi considérer que « [l]’examen des normes juridiques par le prisme de l’analyse économique est […] vecteur d’informations pour le législateur et le juge, ce qui devrait leur permettre d’améliorer la qualité du droit » (Y. Gabuthy, « Analyse économique de droit : présentation générale », Économie & prévision, 2013, pp. I-VII, ici p. III).
[30] Sur le lien entre risque et contrat social, voy. par exemple F. Ewald et D. Kessler, « Les noces du risque et de la politique », Le Débat, 2000, pp. 55-72, ici pp. 58-59.
[31] T. Hobbes, Léviathan ou Matière, forme et puissance de l’État chrétien et civil, 1651, chapitre 16.
[32] Ibidem.
[33] Ibidem.
[34] T. Hobbes, Léviathan ou Matière, forme et puissance de l’État chrétien et civil, 1651, chapitre 21.
[35] Ibidem.
[36] Comme l’a montré François Ewald, les États ont réagi aux changements provoqués par l’industrialisation, en trouvant de nouveaux instruments de gouvernement dans la philosophie du risque et l’institution de l’assurance (F. Ewald, L’État providence, Paris, Grasset, 1986).
[37] N. Luhmann, « Risque et danger », publié en français dans l’ouvrage de P. Éon, L’adaptation au changement climatique. Pour ouvrir la boîte noire, Québec, Presses de l’Université Laval, 2013, p. 104. Le même auteur avance aussi que « la politique et l’État sont débordés parce que nous attendons tous que soient créées les conditions dans lesquelles nous pourrions vivre de manière risquée sans être pour autant exposés au danger » (Idem, p. 102).
[38] D. Kessler, « Ulrich Beck et la société du risque », Commentaire, 2002, pp. 889-892, ici p. 891.
[39] Voy. not. J. Black, « The emergence of Risk-based Regulation and the New Public Risk Management in the United Kingdom », Public Law, 2005, pp. 510-546.
[40] O. Borraz et c. Gilbert, « Quand l’État prend des risques », in : O. Borraz et V. Guiraudon, Politiques publiques 1, La France dans la gouvernance européenne, Paris, Presses de Sciences Po, 2008, pp.337-357, ici p. 342.
[41] Voy., par exemple, G. Gentili, « European Court of Human Rights: An absolute ban on deportation of foreign citizens to countries where torture or ill-treatment is a genuine risk », International Journal of Constitutional Law, 2010, pp. 311-322 ; L. Hasselbacher, « State Obligations Regarding Domestic Violence: The European Court of Human Rights, Due Diligence, And International Legal Minimums of Protection », Northwestern Journal of International Human Rights, 2010, pp. 190-215 ; C. Heard et D. Mansell, « The European Arrest Warrant : the Role of Judges when Human Rights are at Risk », New Journal of European Criminal Law, 2011, pp. 133-147 ; F. C. Ebert et R. I. Sijniensky, « Preventing Violations of the Right to Life in the European and the Inter-American Human Rights Systems: From the Osman Test to a Coherent Doctrine on Risk Prevention? », Human Rights Law Review, 2015, pp. 343-368 ; R. Scott, « Risks, Reasons and Rights : the European Convention on Human Rights and English Abortion Law », Medical Law Review, 2016, pp. 1-33.
[42] Chr. Hilson, « Risk and the European Convention on Human Rights », Cambridge Yearbook of Legal Studies, 2009, pp. 353-375.
[43] L. Seminara, « Risk Regulation and the European Convention on Human Rights », European Journal of Risk Regulation, 2016, pp. 733-749.
[44] Ainsi, François Ost observe la « montée en puissance (…), dans la société du risque, de la victime en lieu et place de l’acteur social, et du juge comme substitut du politique » (F. Ost, Le temps du droit, Paris, Odile Jacob, 1999, p. 268).
[45] Ainsi, une situation où un individu a été soumis à un risque sérieux de mourir peut être examinée sous l’angle du droit à la vie, même si, par chance pour lui, il n’est finalement pas décédé. L’arrêt de référence à cet égard est Cour EDH, Makaratzis c. Grèce, 20 décembre 2004, § 55. Dans la jurisprudence plus récente, voy. par exemple Cour EDH, Pisari c. République de Moldova et Russie, 21 avril 2015, § 54 ; Cour EDH, Selahattin Demirtaş c. Turquie, 23 juin 2015, § 30 ; Cour EDH, Brincat et autres c. Malte, 24 juillet 2014, § 82.
[46] Autrement dit, le juge contribue à répondre à la question suivante : « what risks should regulators prevent occurring, and which, often more contentiously, should they not? » (J. Black, « The emergence of Risk-based Regulation and the New Public Risk Management in the United Kingdom », Public Law, 2005, pp. 510-546, ici p. 546).
[47] Chr. Hilson, « Risk and the European Convention on Human Rights », Cambridge Yearbook of Legal Studies, 2009, pp. 353-375, ici p. 372.
[48] Pour autant qu’on puisse considérer qu’il s’agit d’un indice quantitatif pertinent, on relève qu’au 31 mars 2019, l’introduction du mot « risque » dans le moteur de recherche « Hudoc » de la Cour européenne des droits de l’homme faisait apparaître 2.826 résultats parmi les arrêts de fond prononcés par une chambre ou la Grande chambre de la Cour. Le mot « risk », en anglais, conduisait à 4.787 résultats.
[49] En ce sens, voy L. Seminara, « Risk Regulation and the European Convention on Human Rights », European Journal of Risk Regulation, 2016, pp. 733-749, ici pp. 733-734.
[50] Par passage-clé, nous entendons un passage de l’arrêt où la Cour exprime son propre raisonnement juridique. Cela exclut en tout cas les passages des arrêts relatifs à la procédure, aux faits et au droit applicable, ainsi que les passages où les positions des parties sont relatées.
[51] En français, la Cour hésite entre deux approches terminologiques : celle qui consiste à évoquer le fait que le concerné est « menacé de manière réelle et immédiate » (not. Cour EDH, Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 116, al. 2 ; mais encore, beaucoup plus récemment, not. dans Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie, 17 juillet 2014, Grande chambre, § 130) et celle qui désigne le « risque réel et immédiat » (pour la première fois dans Cour EDH, Keenan, 3 avril 2001, § 93). L’approche terminologique semble plus stable en anglais, avec une préférence pour « real and immediate risk ».
[52] Sur l’usage des langues par la Cour – spécialement des langues officielles que sont l’anglais et le français – on peut notamment lire J. Brannan, « Le rôle du traducteur à la Cour européenne des droits de l’homme », Traduire, 2009, pp. 24-35.
[53] Voy., par exemple, Cour EDH, Fernandes de Oliveira c. Portugal, 31 janvier 2019, § 110.
[54] Voy. not. Cour EDH, A.Ş. c. Turquie, 13 septembre 2016, § 49 ; Cour EDH, Giuliani et Gaggio c. Italie, Grande chambre, 24 mars 2011, § 248.
[55] Cour EDH, Civek c. Turquie, 23 février 2012 ; Cour EDH, Akkoc c. Turquie, 10 octobre 2000, § 94.
[56] Le recours à l’adjectif « certain », placé après le substantif « risque », nous semble étonnant et il nous semble que le terme « réel » devrait lui être préféré – même si l’on peut aussi discuter de son opportunité. En effet, ainsi placé après le substantif, l’adjectif « certain » implique une notion de certitude qui, combinée avec la notion de risque, qui suppose l’incertitude, paraît constituer un contresens qui ne trouve pas d’équivalent dans les arrêts en anglais. Toutefois, on peut éventuellement tirer de cet usage contestable un nouvel indice sur le sens de l’expression « risque réel » / « real risk » à laquelle la Cour substitue occasionnellement celle de « risque certain » : il doit certainement s’agir d’un risque objectivement démontré, dont l’existence est donc certaine.
[57] Voy. not. Cour EDH, Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 116, al. 2 ; mais aussi, beaucoup plus récemment, Cour EDH, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie, 17 juillet 2014, Grande chambre, § 130.
[58] Voy., par exemple, Cour EDH, Bader et Kanbor c. Suède, 8 novembre 2005, § 42.
[59] Voy., par exemple, Cour EDH, Mennesson c. France, 26 juin 2014, § 58.
[60] Cour EDH, Rooman c. Belgique, 31 janvier 2019, § 145.
[61] La distinction entre les cas où un risque pèse sur des individus identifiés et celles où un risque pèse sur la société en général est parfois explicitement formulée par la Cour. Voy. not. Cour EDH, Ercan Bozkurt c. Turquie, 23 juin 2015, §§ 53 et 54 ; et Cour EDH, Bljakaj et autres c. Croatie, 18 septembre 2014, §§ 103 à 111. Voy. aussi Cour EDH, Cevrioğlu c. Turquie, 4 octobre 2016, § 50.
[62] Voy., toutefois, Cour EDH, Kavaklioğlu et autres c. Turquie, 6 octobre 2015, § 174.
[63] La Cour a développé cette approche pour la première fois à l’occasion de Cour EDH, Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 116, al. 2. Voy. aussi, parmi de nombreux exemples, Cour EDH, Opuz c. Turquie, 9 juin 2009, § 130.
[64] Selon la Cour, l’approche qu’elle a adoptée dans ces affaires « est analogue au critère qu’elle applique lorsqu’elle examine l’obligation positive matérielle qui incombe à l’État de prendre des mesures opérationnelles préventives pour protéger les individus dont la vie est en danger de manière réelle et imminente (voir les principes généraux énoncés dans l’arrêt Osman) » (Cour EDH, Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal, 19 décembre 2017, Grande chambre, § 184). Dans cet arrêt, la Cour précise cependant que les cas où la responsabilité de l’État est engagée à raison des actions et omissions des prestataires de santé sont tout à fait exceptionnelles (voy. les §§ 190-196).
[65] Voy. par exemple Cour EDH, Malik Babayev c. Azerbaidjan, 1er juin 2017, §§ 67 et 70 ; Cour EDH, Trapeznikova et autres c. Russie, 1er décembre 2016, § 40 ; Cour EDH, Hiller c. Autriche, 22 novembre 2016, §§ 49 ; Cour EDH, Isenc c. France, 4 février 2016, §§ 38 et 40 ; Keenan c. Royaume-Uni, 3 avril 2001, § 93.
[66] Ainsi, en 2011, la Cour a explicitement affirmé que la notion d’immédiateté « ne saurait entrer péremptoirement en jeu en matière de suicide » (Cour EDH, Donder et De Clippel c. Belgique, 6 décembre 2011, § 76). Dans plusieurs arrêts postérieurs, l’adjectif « immédiat » est également ignoré (Voy. not. Cour EDH, Cengiz et Saygikan c. Turquie, 24 janvier 2017, § 47 ; Cour EDH, Şahinkuşu c. Turquie, 21 juin 2016, § 57 ; Cour EDH, Tanişma c. Turquie, 27 novembre 2015, § 60). La Grande chambre a récemment contredit cette affirmation de 2011, en jugeant, à propos du suicide de personnes privées de leur liberté, que seul un risque à la fois réel et immédiat était à la source d’une obligation positive à l’aune de l’article 2 de la Convention (Cour EDH, Fernandes de Oliveira c. Portugal, 31 janvier 2019, GC, § 110, 115, 117, 124, 125, 126 et 131).
[67] Voy. par exemple Cour EDH, X. et autres c. Bulgarie, 17 janvier 2019, § 87. Voy. aussi not. Cour EDH, Khalikov c. Russie, 15 janvier 2019, § 30 ; Cour EDH, Đorđević c. Croatie, 24 juillet 2012, § 139 ; Cour EDH, Česnulevičius c. Lituanie, 10 janvier 2012, § 83 ; Cour EDH, Premininy c. Russie, 10 février 2011, § 84.
[68] Cour EDH, Chowdury et autres c. Grèce, 30 mars 2017, § 88 ; Cour EDH, Rantsev c. Chypre et Russie, 7 janvier 2010, § 305.
[69] TLFi : Trésor de la langue Française informatisé, http://www.atilf.fr/tlfi, ATILF – CNRS & Université de Lorraine.
[70] On peut penser que la Cour donne ce sens à la notion de « risque réel », en s’appuyant notamment sur les §§ 38, al. 2, et 39 de l’arrêt L.C.B. c. Royaume-Uni du 9 juin 1998.
[71] Voy. par exemple Cour EDH, Talpis c. Italie, 2 mars 2017, § 122.
[72] C’est cet adjectif qui est le plus couramment utilisé. Voy., parmi de nombreux autres exemples, Cour EDH, Patsaki c. Grèce, 7 février 2019, § 90 ; Cour EDH, Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, 14 mars 2002, § 57 ; Cour EDH, Keenan c. Royaume, 3 avril 2001, § 93.
[73] Voy., par exemple, Cour EDH, Yasemin Doğan c. Turquie, 6 septembre 2016, § 53 ; Cour EDH, Akkoc c. Turquie, 10 octobre 2000, § 94 ; Cour EDH, Mahmut Kaya c. Turquie, 28 mars 2000, § 101 ; Cour EDH, Kiliç c. Turquie, 28 mars 2000, § 77.
[74] Dans certaines affaires du même type, la Cour aborde la notion de risque sous l’angle de l’article 8 de la Convention, dont elle tire des obligations similaires. Voy., par exemple, Cour EDH, Cordella c. Italie, 24 janvier 2019 ; Cour EDH, Brincat et autres c. Malte, 24 juillet 2014, § 102. Voy. aussi déjà Cour EDH, Guerra et autres c. Italie, Grande chambre, 19 février 1998, où la Cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les faits sous l’angle de l’article 2, après avoir considéré que l’État avait violé l’article 8, en s’abstenant de livrer aux requérants les informations nécessaires pour leur permettre d’évaluer les risques qui pouvaient résulter de l’activité d’une usine.
[75] Cour EDH, Öneryildiz c. Turquie, Grande chambre, 30 novembre 2004, § 90.
[76] Voy., par exemple, Cour EDH., R.Ş. c. Lettonie, 8 mars 2018, § 80 ; Cour EDH, Sinim c. Turquie, 6 juin 2017, § 58 ; Cour EDH, Cevrioğlu c. Turquie, 4 octobre 2016, § 51 (dans le § 67 de cet arrêt, la Cour affirme explicitement que la responsabilité de l’État est engagée même si le risque n’était pas imminent) ; Cour EDH, Cavit Tinarlioğlu c. Turquie, 2 février 2016 ; Cour EDH, Prilutskiy c. Ukraine, 26 février 2015, § 31 ; Cour EDH, Oruk c. Turquie, 4 février 2014, § 52 ; Cour EDH, Vilnes et autres c. Norvège, 5 décembre 2013, § 220 ; Cour EDH, Mosendz c. Ukraine, 17 janvier 2013, § 90 ; Cour EDH, Kolyadenko et autres c. Russie, 28 février 2012, § 158.
[77] Cour EDH, Boudaïeva c. Russie, 20 mars 2008, § 132. La distinction entre les affaires relatives à des activités humaines dangereuses et celles qui concernent des catastrophes naturelles n’est pas étanche. Ainsi, dans l’arrêt Kolyadenko (précité), la Cour examine une situation où, à l’occasion de pluies torrentielles, des autorités ont été amenées à libérer de grandes quantités d’eau d’un réservoir et à les laisser se répandre dans des zones habitées. Même si la cause des dommages trouve notamment son origine dans un phénomène naturel, la Cour tend à considérer que le rôle des activités humaines est prépondérant (voy. en particulier le § 164 de l’arrêt).
[78] Dans ces cas, on n’aurait pas pu identifier un risque particulier pour les victimes, mais il existait bien un risque plus général pour la société que l’État aurait parfois pu réduire, par exemple, en contrôlant mieux la circulation des armes à feu (Voy., en particulier, Cour EDH, Gerasimenko et autres c. Russie, 1er décembre 2016, § 94 et Cour EDH, Sašo Gorgiev c. « L’Ex-République yougoslave de Macédoine », 19 avril 2012, § 42. Voy. aussi Gorovenky et Bugara c. Ukraine, 12 janvier 2012, §§ 31-40. Le critère du « risque réel et immédiat » a néanmoins été appliqué dans l’arrêt Mastromatteo qui relève pourtant a priori de cette catégorie d’affaires (Voy. Cour EDH, Mastromatteo c. Italie, Grande chambre, 24 octobre 2002, §§ 69 à 79).
[79] Cour EDH, Mikhno c. Ukraine, 1er septembre 2016, § 124 ; Cour eur. dr. h., Svitlana Atamanyuk et autres c. Ukraine, 1er septembre 2016, § 129 ; Cour EDH, Prilutskiy c. Ukraine, 26 février 2015, § 33 ; Cour EDH, Öneryildiz c. Turquie, Grande chambre, 30 novembre 2004, § 90. En outre, dans l’affaire Boudaiëva, précitée, « l’imminence d’une […] catastrophe clairement identifiable » est également prise en considération par la Cour (§ 137).
[80] Le retour à ce critère s’explique peut-être par le fait que, dans les affaires concernées, le risque lié à des activités humaines dangereuses pesait en particulier, selon l’analyse de la Cour, sur une ou plusieurs personnes identifiées. On peut toutefois trouver des affaires où un risque existait pour des individus identifiés, mais où la Cour ne se réfère pas au critère du risque réel et immédiat (voy., par exemple, Cour EDH, Vilnes et autres c. Norvège, 5 décembre 2013).
[81] Voy. not. Cour EDH, Allanazarova c. Russie, 14 février 2017, § 99. Voy. aussi not. Cour EDH, Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni, 2 mars 2010, §§ 123, 133, 135, 137, 143 et 144 ; Cour EDH, Bader et Kanbor c. Suède, 8 novembre 2005, §§ 43 et 48 ; Cour EDH, Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, 12 avril 2005, § 372.
[82] Voy. not. Cour EDH, A.S. c. France, 19 avril 2018, § 60 ; Cour EDH, M.A. c. France, 1er février 2018, §§ 51-52 ; Cour EDH, N.A. c. Suisse, 30 mai 2017, § 41 ; Cour EDH, A.I. c. Suisse, 30 mai 2017, § 48 ; Cour EDH, Ilias et Ahmed c. Hongrie, 14 mars 2017, § 105 ; Cour EDH, Allanazarova c. Russie, 14 février 2017, § 67, 68, 71, 73, 76, 77, 78 et 82 ; Cour EDH, Khamtokhu et Aksenchik c. Russie, 24 janvier 2017, § 73 ; Cour EDH, Paposhvili c. Belgique, 13 décembre 2016, §§ 173, 183 et 186.
[83] Voy. par exemple Cour EDH, El-Masri c. L’Ex-République yougoslave de Macédoine, 13 décembre 2012, § 239.
[84] Voy. not. Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, 17 janvier 2012, §§ 261, 263, 271, 273, 275, 282 et 285, mais aussi le dispositif de l’arrêt.
[85] Cour EDH, Balyemez c. Turquie, 22 décembre 2005, § 96.
[86] Cour EDH, Comoraşu c. Roumanie, 31 mai 2016, § 70 ; Cour EDH, B. c. Roumanie (n° 2), 19 février 2013, § 92 ; Cour EDH, Cristian Teodorescu c. Roumanie, 19 juin 2012, § 65.
[87] Si l’on s’en tient à la jurisprudence récente, on peut notamment faire référence aux arrêts suivants : Cour EDH, R.D. c. France, 16 juin 2016, § 45 ; Cour EDH, A.A. c. France, 15 janvier 2015, § 62 ; Cour EDH, Mamazhonov c. Russie, 23 octobre 2014, § 146 ; Cour EDH, M.G. c. Bulgarie, 25 mars 2014, §§ 95-96 ; Cour EDH, Tershiyev c. Azerbaidjan, 31 juillet 2014, § 60 ; Cour EDH, Savriddin Dzhurayev c. Russie, 25 avril 2013, § 167.
[88] Voy. Cour EDH, Rodić et autres c. Bosnie-Herzégovine, 27 mai 2008, §§ 70 et 72.
[89] Voy. not. Cour EDH, Merčep c. Croatie, 26 avril 2016, § 90 ; Cour EDH, Nedad Kovačević c. Croatie, 24 novembre 2015, §§ 67 et 70 ; Cour EDH, Artemov c. Russie, 3 avril 2014, § 79 ; Cour EDH, Zimin c. Russie, 6 février 2014, § 39 ; Cour EDH, Shikuta c. Russie, 11 avril 2013, § 47 ; Cour EDH, Grishin c. Russie, 24 juillet 2012, § 148.
[90] Cour EDH, Bogusław Krawczak c. Pologne, 31 mai 2011, § 114.
[91] Voy., par exemple, Cour EDH, Ilnseher c. Allemagne, Grande chambre, 4 décembre 2018, §§ 158, 159 et 169 ; Cour EDH, W.P. c. Allemagne, 6 octobre 2016, § 62 ; Cour EDH, Petschulies c. Allemagne, 2 juin 2016, § 80 ; Cour EDH, Murray c. Pays-Bas, 26 avril 2016, § 121 ; Cour EDH, Van Zandbergen c. Belgique, 2 février 2016, § 47 ; Cour EDH, Moustaquim c. Belgique, 18 février 1991, § 42.
[92] Voy. supra, n° 4.
[93] À l’appui de ceci, nous reprenons un avertissement qui nous paraît important : « [l]’évaluation est une tentative de conjuration de l’ambiguïté et de l’ambivalence du monde, un simulacre pour tenter de fixer à travers des chiffres et une apparence de rationalité une réalité toujours fuyante. Elle fait le pari que la rationalité est un principe d’organisation du monde plus efficace que le fait de l’intuition des acteurs concernés. » (D. Le Breton, « Évaluation des dangers et goût du risque », Cahiers internationaux de sociologie, 2010, pp. 267-284, ici p. 269).
[94]94 Certains auteurs doutent ainsi de la possibilité de développer une approche unifiée de l’analyse du risque (voy. par exemple A. Moretto, A. Bachman, A. Boobis, K. R. Solomon, T. P. Pastoor, M. F. Wilks et M. R. Embry, « A framework for cumulative risk assessment in the 21st century », Critical Reviews in Toxology, 2017, pp. 85-97), même si d’autres cherchent à développer les bases conceptuelles d’une approche interdisciplinaire (Voy. par exemple T. Aven et V. Kristensen, « Perspectives on risk : review and discussion of the basis for establishing a unified and holistic approach », Reliability Engineering and System Safety, 2005, pp. 1-14.
[95] Article 35, § 3, b), de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour précise que la gravité du préjudice doit être appréciée compte tenu à la fois de la perception subjective du requérant et de l’enjeu objectif d’une affaire donnée (voy. not. Cour EDH, Korolev c. Russie (déc.), 1er juillet 2010). Elle ajoute que l’impression subjective n’est jamais suffisante pour convaincre la Cour et qu’elle doit être soutenue par des éléments objectifs (voy. not. Cour EDH, Ladygin c. Russie (déc.), 30 août 2011).
[96] L’application du critère relatif à l’absence de préjudice important ne se limite certes pas à tel ou tel droit protégé par la Convention. La Cour a toutefois considéré qu’il est difficile d’envisager une situation où un grief fondé sur l’article 3, qui ne serait pas irrecevable pour un autre motif et qui relèverait bien de cette disposition (c’est-à-dire que le critère relatif au minimum de gravité serait rempli), pourrait être déclaré irrecevable du fait que le requérant n’a subi aucun préjudice important (Cour EDH, Y c. Lettonie, 21 octobre 2014, § 44).
[97] De façon générale, la Cour affirme que, dans les affaires où elle retient l’approche fondée sur les conséquences de la mesure en cause, « l’analyse de la gravité de celles-ci occupe une place importante » (voy. not. Cour EDH, Denisov c. Ukraine, 25 septembre 2018, § 110).
[98] Ceci vaut non seulement dans les affaires relatives à l’article 3 (voy., par exemple, Cour EDH, Bouyid c. Belgique, 28 septembre 2015, § 86 ; Cour EDH, Gäfgen c. Allemagne, 1er juin 2010, § 88), mais aussi dans certains cas où l’article 8 est en jeu, spécialement dans les affaires d’environnement (voy., par exemple, Cour EDH, Dubetska et autres c. Ukraine, 10 février 2011, § 105 ; Cour EDH, Fadeïeva c. Russie, 9 juin 2005, §§ 68 et 69).
[99] Voy. not. Cour EDH, F.G. c. Suède, Grande chambre, 23 mars 2016, § 112.
[100] Voy., par exemple, Cour EDH, Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni, 2 mars 2010, § 123.
[101] Voy., par exemple, Cour EDH, A.S. c. France, 19 avril 2018, § 60.
[102] Cour EDH, El-Masri c. L’Ex-République yougoslave de Macédoine, 13 décembre 2012, § 239. C’est nous qui soulignons.
[103] Cour EDH, Mamatkoulov et Askarov c. Turquie, 4 février 2005, § 91. C’est nous qui soulignons.
[104] Voy., par exemple, Cour EDH, Ahorugeze c. Suède, 27 octobre 2011, § 114.
[105] C. Heard et D. Mansell, « The European Arrest Warrant: the Role of Judges when Human Rights are at Risk », New Journal of European Criminal Law, 2011, pp. 133-147, ici pp. 136-137.
[106] N. Luhmann, « Risque et danger », op. cit., p. 70.
[107] Ainsi, la Cour accepte parfois de traiter, sous l’angle de l’article 2, une situation où un décès n’a pas eu lieu (le dommage ne s’est pas produit), mais où une personne s’est trouvée, à un moment du passé, dans une situation où un risque sérieux pesait sur sa vie (voy., par exemple, Cour EDH, Pisari c. République de Moldova et Russie, 21 avril 2015, § 54 ; Cour EDH, Selahattin Demirtaş c. Turquie, 23 juin 2015, § 30 ; Cour EDH, Brincat et autres c. Malte, 24 juillet 2014, § 82 ; Cour EDH, Eduard Popa c. République de Moldova, 12 février 2013, § 45).
[108] On pourrait être tenté de penser que la situation est plus facile dans le second cas, puisqu’on a une vue sur la situation postérieure au moment du risque. Un auteur relève à cet égard que les expertises ne peuvent souvent « être effectués de manière satisfaisante qu’après la survenue des dommages. Les commissions d’enquête ne peuvent ainsi déterminer qu’a posteriori ce qui a été mal fait et ce qui aurait dû être fait » (Flavien Le Bouter, « La sociologie constructiviste du risque de Niklas Luhmann », Communication et organisation, 2014, n° 45, pp. 33-48, p. 35). Mais la situation est au contraire plus complexe, car pour évaluer correctement le risque, il faut parvenir à se replacer virtuellement dans la situation antérieure, qui peut être éloignée de plusieurs années, en omettant sa connaissance du futur.
[109]109 C. Danner et P. Schulman, « Rethinking Risk Assessment for Public Utility Safety Regulation », Risk Analysis, 2019, pp. 1044-1059, ici p. 1048. L’auteur écrit que « this leads to a postaccident public risk tolerance much lower than would have been implied by the prior reluctance to pay the cost needed to mitigate the risk’s likelihood or consequences ».
[110] Voy. not. Cour EDH, Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal, Grande chambre, 19 décembre 2017, § 165.
[111] La Cour s’appuie sur l’ensemble des éléments qu’on lui fournit ou, au besoin, qu’elle se procure d’office (voy. not. Cour EDH, Hilal c. Royaume-Uni, 6 mars 2001, § 60 ; Cour EDH, H.L.R. c. France, 29 avril 1997, § 37).
[112] Voy. not. Cour EDH, A.S. c. France, 19 avril 2018, § 62 ; Cour EDH, Saadi c. Italie, Grande chambre, 28 février 2008, § 131.
[113] Voy. not. Cour EDH, Trabelsi c. Belgique, 2 septembre 2014, § 122 ; Cour EDH, Saadi c. Italie, Grande chambre, 28 février 2008, § 147.
[114] C. Heard et D. Mansell, « The European Arrest Warrant: the Role of Judges when Human Rights are at Risk », New Journal of European Criminal Law, 2011, pp. 133-147, p. 145. Cet argument s’appuie notamment sur Cour EDH, KRS c. Royaume-Uni (déc.), 2 décembre 2008.
[115] Cour EDH, M.S.S. c. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011.
[116] C. Heard et D. Mansell, op. cit., p. 145.
[117] Voy. A. Peyre, « Ainsi parlait Daoudi, une jurisprudence pour tous et pour personne », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 18 mai 2018, consulté le 30 avril 2019. URL : http://journals.openedition.org/revdh/3854.
[118] C. Heard et D. Mansell, op. cit., p. 140.
[119] Voy. not. Cour EDH, Perevedentsevy c. Russie, 24 avril 2014, § 98 ; Cour EDH, Kilinç et autres c. Turquie, 7 juin 2005, § 44.
[120] Voy. not. Cour EDH, Kilinç et autres c. Turquie, 7 juin 2005, § 45.
[121] Voy. not. Cour EDH, Renolde c. France, 16 octobre 2008, §§ 87-89.
[122] Cour EDH, Verein gegen Tierfabrieken Schweiz (VgT) c. Suisse (No. 2), Gr. Ch., 30 juin 2009, § 81. Pour une decision plus récente, voy. par exemple Cour EDH, Yasemin Doğan c. Turquie, 6 septembre 2016, § 48.
[123] Voy. not. Cour EDH, Talpis c. Italie, 2 mars 2017, § 101, al. 2.
[124] Voy. not. Cour EDH, Fernandes de Oliveira c. Portugal, Grande chambre, 31 janvier 2019 ; Cour EDH, Olszewscy c. Pologne, 3 novembre 2015, § 59.
[125] En ce qui concerne la limite des capacités financières, la Cour a par exemple jugé que « l’attribution de fonds publics dans le domaine de la santé est une question sur laquelle elle n’a pas à prendre position, et qu’il appartient aux autorités compétentes des États contractants de déterminer la manière dont leurs ressources limitées doivent être allouées, ces autorités étant mieux placées qu’elle pour apprécier les exigences respectives au regard des ressources finies dont elles disposent et pour assumer la responsabilité des choix difficiles devant être opérés entre différents besoins tous dignes d’être financés » (Cour EDH, Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal, Grande chambre, 19 décembre 2017, § 175).
[126] Sur cette question, voy. par exemple O. Borraz et c. Gilbert, « Quand l’État prend des risques », in : O. Borraz et V. Guiraudon, Politiques publiques 1, La France dans la gouvernance européenne, Paris, Presses de Sciences Po, 2008, pp.337-357, ici p. 345 et s.
[127] En ce sens, voy. not. Chr. Hilson, « Risk and the European Convention on Human Rights », Cambridge Yearbook of Legal Studies, 2009, pp. 353-375, ici p. 358.
[128] Cour EDH, Opuz c. Turquie, Grande chambre, 9 juin 2007, § 129. Voy. aussi Cour EDH, V.C. c. Italie, 1er février 2018, § 90 ; Cour EDH, Osman c. Royaume-Uni, Grande chambre, 28 octobre 1998, § 116.
[129] Voy., par exemple, Cour EDH, Saadi c. Italie, Grande chambre, 28 février 2008, § 139. Pour apporter de la nuance au propos, nous ajoutons que la Cour a parfois laissé planer un doute sur l’éventuelle acceptabilité de mauvais traitements, dans un contexte particulier. Ainsi, dans une affaire qui concernait la répression d’une mutinerie dans un établissement pénitentiaire, la Cour a d’abord reconnu que la force employée par les agents dépassait le seuil de gravité dans le cadre de l’article 3 (Cour EDH, Gömi et autres c. Turquie, 21 décembre 2006, § 76), avant d’ajouter qu’elle ne pouvait conclure à la violation de la disposition dans les circonstances particulières de l’espèce, où les autorités avaient réagi « remarquablement en ayant eu recours à des moyens pertinents » (§ 77). Il ne s’agit toutefois pas d’une affaire qui porte sur la notion de risque.
[130] Cour EDH, Hatton et autres c. Royaume-Uni, 8 juillet 2003, § 127.
[131] Voy., par exemple, Cour EDH, Öneryildiz c. Turquie, Grande chambre, 30 novembre 2004, § 105.
[132] Voy., par exemple, Cour EDH, Fadeïeva c. Russie, 9 juin 2005, § 120. Un auteur relève ainsi que « choice is acknowledged by the Court as being economically determined; choice, in other words, depends not just on having access to appropriate information resources about risk, but also on having appropriate financial resources to be able to avoid it » (Chr. Hilson, « Risk and the European Convention on Human Rights », Cambridge Yearbook of Legal Studies, 2009, pp. 353-375, ici p. 364).
[133] Cour EDH, Prilutskiy c. Ukraine, 26 février 2015, § 32. Dans le même paragraphe, la Cour ajoute que « The Court has observed that the ability to conduct one’s life in a manner of one’s own choosing may also include the opportunity to pursue activities perceived to be of a physically or morally harmful or dangerous nature for the individual concerned, and improper State interference with this freedom of personal choice may give rise to an issue under the Convention ».
[134] Cour EDH, Prilutskiy c. Ukraine, 26 février 2015, § 36.
[135] B. Vian, L’arrache-cœur, Paris, Vrille, 1953, [Paris, Fayard, 1996].
 Le millésime 2019 de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme est placé sous le signe du dialogue des juges, la Cour européenne ayant rendu son premier avis au titre du protocole n° 16 le 10 avril 2019
Le millésime 2019 de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme est placé sous le signe du dialogue des juges, la Cour européenne ayant rendu son premier avis au titre du protocole n° 16 le 10 avril 2019  Le terme de « robot » a été inventé en 1921 dans une pièce du tchèque Karel Čapek, RUR, les Robots universels de Rossum pour désigner des « ouvriers artificiels », automates androïdes fabriqués par la firme R.U.R. pour se substituer à l’être humain dans certains travaux
Le terme de « robot » a été inventé en 1921 dans une pièce du tchèque Karel Čapek, RUR, les Robots universels de Rossum pour désigner des « ouvriers artificiels », automates androïdes fabriqués par la firme R.U.R. pour se substituer à l’être humain dans certains travaux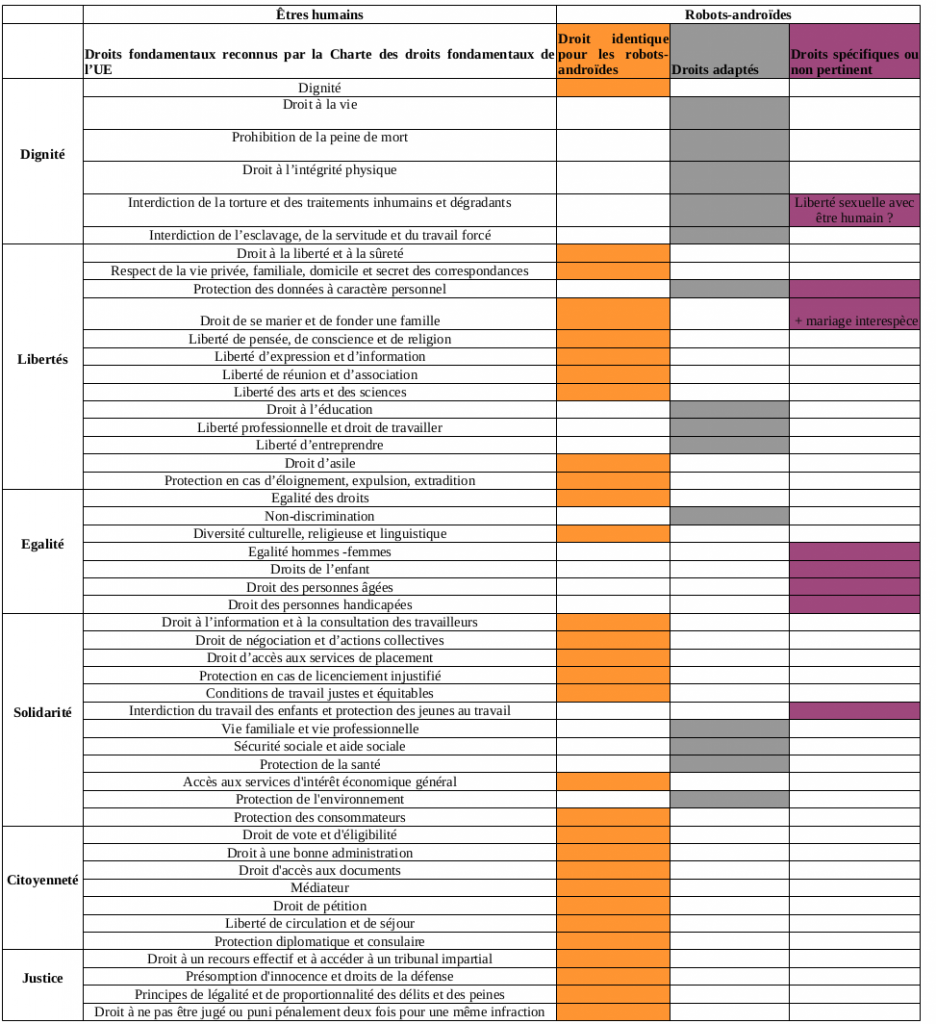
 Plus de trois années après la consécration du contrôle de conventionnalité in concreto de la loi par le Conseil d’État, à l’occasion de son fameux arrêt d’assemblée Gonzalez Gomez du 31 mai 2016
Plus de trois années après la consécration du contrôle de conventionnalité in concreto de la loi par le Conseil d’État, à l’occasion de son fameux arrêt d’assemblée Gonzalez Gomez du 31 mai 2016  A l’évidence, le système conventionnel de sauvegarde des droits de l’homme n’a jamais fait l’unanimité. Les débats et les réticences qui ont émaillés sa ratification tardive en 1974 en attestent
A l’évidence, le système conventionnel de sauvegarde des droits de l’homme n’a jamais fait l’unanimité. Les débats et les réticences qui ont émaillés sa ratification tardive en 1974 en attestent
 La référence au « politiquement correct » est omniprésente dans le débat public aujourd’hui. Elle est mobilisée pour dénoncer certains discours ou revendications jugées liberticides. L’hebdomadaire « Valeurs actuelles » s’est fait une spécialité de la dénonciation de ses supposés méfaits à travers des dossiers aux intitulés tout en nuances : « La tyrannie des bien-pensants » (novembre 2019) ; « La terreur végan » (décembre 2019) ; « La nouvelle terreur féministe » (mai 2019) ; « Les racistes anti-Blancs » (septembre 2019). Sur le plan éditorial, deux ouvrages en langue française ont été publiés en 2019 qui ont entendu critiquer le politiquement correct : l’ouvrage du sociologue canadien Mathieu Bock-Côté intitulé L’emprise du politiquement correct (Cerf, 2019) et le livre de l’universitaire française Isabelle Barbéris titré L’art du politiquement correct (PUF, 2019).
La référence au « politiquement correct » est omniprésente dans le débat public aujourd’hui. Elle est mobilisée pour dénoncer certains discours ou revendications jugées liberticides. L’hebdomadaire « Valeurs actuelles » s’est fait une spécialité de la dénonciation de ses supposés méfaits à travers des dossiers aux intitulés tout en nuances : « La tyrannie des bien-pensants » (novembre 2019) ; « La terreur végan » (décembre 2019) ; « La nouvelle terreur féministe » (mai 2019) ; « Les racistes anti-Blancs » (septembre 2019). Sur le plan éditorial, deux ouvrages en langue française ont été publiés en 2019 qui ont entendu critiquer le politiquement correct : l’ouvrage du sociologue canadien Mathieu Bock-Côté intitulé L’emprise du politiquement correct (Cerf, 2019) et le livre de l’universitaire française Isabelle Barbéris titré L’art du politiquement correct (PUF, 2019). Cette question peut être perçue comme provocante ou naïve. Provocante puisque par définition les droits de solidarité sont pensés pour compenser les limites du marché (comme métaphore d’une société ne reposant que sur la responsabilité individuelle) et ne sauraient dépendre de lui pour leur garantie ; mais naïve aussi parce que de fait, une partie de la solidarité est déjà prise en charge par des entreprises privées, par le mécanisme des chèques sociaux ou celui de l’assurance, mais aussi par d’autres modalités relevant de l’initiative privée, via des associations caritatives ou encore, depuis quelques temps, par des « cagnottes » de type « Leetchi ».
Cette question peut être perçue comme provocante ou naïve. Provocante puisque par définition les droits de solidarité sont pensés pour compenser les limites du marché (comme métaphore d’une société ne reposant que sur la responsabilité individuelle) et ne sauraient dépendre de lui pour leur garantie ; mais naïve aussi parce que de fait, une partie de la solidarité est déjà prise en charge par des entreprises privées, par le mécanisme des chèques sociaux ou celui de l’assurance, mais aussi par d’autres modalités relevant de l’initiative privée, via des associations caritatives ou encore, depuis quelques temps, par des « cagnottes » de type « Leetchi ». Le 28 septembre 2009, un meeting de l’opposition tournait au drame dans la capitale guinéenne. Alors qu’une foule d’opposants s’était réunie dans le stade de Conakry pour manifester contre la candidature à l’élection présidentielle du capitaine Moussa Dadis Camara, chef de la junte au pouvoir – le Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD) –, les forces de sécurité réprimaient violemment le rassemblement
Le 28 septembre 2009, un meeting de l’opposition tournait au drame dans la capitale guinéenne. Alors qu’une foule d’opposants s’était réunie dans le stade de Conakry pour manifester contre la candidature à l’élection présidentielle du capitaine Moussa Dadis Camara, chef de la junte au pouvoir – le Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD) –, les forces de sécurité réprimaient violemment le rassemblement La désignation des trois candidats au poste de juge français à la Cour européenne des droits de l’homme intervenue le 19 décembre 2019 était attendue par beaucoup. Celle-ci est, cependant, tout sauf une surprise compte tenu de la tradition française consistant à réserver exclusivement et alternativement la fonction de juge français à Strasbourg comme à Luxembourg aux conseillers d’Etat et aux conseillers à la Cour de cassation. Il n’y a donc là rien de bien nouveau. La liste présentée par le gouvernement français comportait trois noms : le favori du Conseil d’Etat, Mattias Guyomar, Carole Champalaune, conseillère à la Cour de cassation, et Tristan Gervais de Lafond, premier Président de la Cour d’appel de Montpellier. Et sans réelle surprise, l’Assemblée parlementaire a élu le 28 janvier Mattias Guyomar, celui-ci devant succéder à André Potocki (conseiller à la Cour de cassation) dont le mandat s’achève en juin. Si la présence de Tristan Gervais de Lafond dans la liste était inattendue, puisqu’il a fait toute sa carrière dans des TGI, sa candidature avait très peu de chances de prospérer devant l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, ce qui amène à la critique majeure. En effet, c’est du côté des universitaires que la France était attendue… et a déçu.
La désignation des trois candidats au poste de juge français à la Cour européenne des droits de l’homme intervenue le 19 décembre 2019 était attendue par beaucoup. Celle-ci est, cependant, tout sauf une surprise compte tenu de la tradition française consistant à réserver exclusivement et alternativement la fonction de juge français à Strasbourg comme à Luxembourg aux conseillers d’Etat et aux conseillers à la Cour de cassation. Il n’y a donc là rien de bien nouveau. La liste présentée par le gouvernement français comportait trois noms : le favori du Conseil d’Etat, Mattias Guyomar, Carole Champalaune, conseillère à la Cour de cassation, et Tristan Gervais de Lafond, premier Président de la Cour d’appel de Montpellier. Et sans réelle surprise, l’Assemblée parlementaire a élu le 28 janvier Mattias Guyomar, celui-ci devant succéder à André Potocki (conseiller à la Cour de cassation) dont le mandat s’achève en juin. Si la présence de Tristan Gervais de Lafond dans la liste était inattendue, puisqu’il a fait toute sa carrière dans des TGI, sa candidature avait très peu de chances de prospérer devant l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, ce qui amène à la critique majeure. En effet, c’est du côté des universitaires que la France était attendue… et a déçu. François Sureau est un homme aux mille vies, énarque, officier, écrivain, avocat et ami ou conseil des puissants. Il est aujourd’hui aux premières loges du combat juridique pour la défense des libertés à travers son activité d’avocat au Conseil. La SCP Spinosi-Sureau a joué un rôle central dans des contentieux emblématiques récents devant le Conseil constitutionnel comme devant le Conseil d’Etat, qu’il s’agisse de l’état d’urgence, de la situation des migrants ou encore des détenus. Il bénéficie donc d’un point de vue informé sur la situation des libertés en France aujourd’hui. L’état des lieux qu’il dresse dans son ouvrage « Sans la liberté » n’est guère réjouissant. Qu’il s’agisse de la liberté individuelle, de la liberté de manifester ou encore de la liberté d’expression, des exemples ne manquent pas qui donnent à voir une régression dans la jouissance des libertés en France. L’ouvrage se présente aussi comme un essai mélancolique sur les dérives des gouvernants et les démissions du citoyen. L’auteur ne se contente pas de rendre compte du recul des libertés. Il replace cette évolution dans le temps long, et notamment à travers l’expérience de sa génération (il est né à la fin des années 1950). Aussi le propos prend-il parfois les atours d’une introspection voire d’une auto-critique. Pour rendre compte de ce court ouvrage (55 p.), et puisque l’auteur y invite, nous insisterons sur cette dimension générationnelle. Il est le regard d’une génération sur l’évolution du statut des libertés. A ce titre, il n’est pas sans évoquer une querelle des anciens et les modernes.
François Sureau est un homme aux mille vies, énarque, officier, écrivain, avocat et ami ou conseil des puissants. Il est aujourd’hui aux premières loges du combat juridique pour la défense des libertés à travers son activité d’avocat au Conseil. La SCP Spinosi-Sureau a joué un rôle central dans des contentieux emblématiques récents devant le Conseil constitutionnel comme devant le Conseil d’Etat, qu’il s’agisse de l’état d’urgence, de la situation des migrants ou encore des détenus. Il bénéficie donc d’un point de vue informé sur la situation des libertés en France aujourd’hui. L’état des lieux qu’il dresse dans son ouvrage « Sans la liberté » n’est guère réjouissant. Qu’il s’agisse de la liberté individuelle, de la liberté de manifester ou encore de la liberté d’expression, des exemples ne manquent pas qui donnent à voir une régression dans la jouissance des libertés en France. L’ouvrage se présente aussi comme un essai mélancolique sur les dérives des gouvernants et les démissions du citoyen. L’auteur ne se contente pas de rendre compte du recul des libertés. Il replace cette évolution dans le temps long, et notamment à travers l’expérience de sa génération (il est né à la fin des années 1950). Aussi le propos prend-il parfois les atours d’une introspection voire d’une auto-critique. Pour rendre compte de ce court ouvrage (55 p.), et puisque l’auteur y invite, nous insisterons sur cette dimension générationnelle. Il est le regard d’une génération sur l’évolution du statut des libertés. A ce titre, il n’est pas sans évoquer une querelle des anciens et les modernes. Près de dix ans après l’entrée en vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil d’État a reconnu, dans trois décisions d’assemblée du 24 décembre 2019, le principe de la responsabilité de l’État du fait des lois déclarées contraires à la Constitution. Ce nouveau régime de responsabilité, dont les conditions ont été déterminées, permet au justiciable de demander l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’application d’une loi méconnaissant les dispositions constitutionnelles. La Haute juridiction administrative a donc posé un troisième cas de responsabilité de l’État du fait des lois. À côté de la traditionnelle responsabilité La Fleurette pour rupture d’égalité devant les charges publiques (CE, ass., 14 janv. 1938, Société des produits laitiers « La Fleurette », Rec. CE p. 25) et de la responsabilité Gardedieu pour méconnaissance par la loi des engagements internationaux de la France (CE, ass., 8 fév. 2007, Gardedieu, n° 279522, Rec. CE p. 78), le justiciable peut désormais engager la responsabilité de l’État du fait de l’application d’une loi déclarée contraire à la Constitution.
Près de dix ans après l’entrée en vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil d’État a reconnu, dans trois décisions d’assemblée du 24 décembre 2019, le principe de la responsabilité de l’État du fait des lois déclarées contraires à la Constitution. Ce nouveau régime de responsabilité, dont les conditions ont été déterminées, permet au justiciable de demander l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’application d’une loi méconnaissant les dispositions constitutionnelles. La Haute juridiction administrative a donc posé un troisième cas de responsabilité de l’État du fait des lois. À côté de la traditionnelle responsabilité La Fleurette pour rupture d’égalité devant les charges publiques (CE, ass., 14 janv. 1938, Société des produits laitiers « La Fleurette », Rec. CE p. 25) et de la responsabilité Gardedieu pour méconnaissance par la loi des engagements internationaux de la France (CE, ass., 8 fév. 2007, Gardedieu, n° 279522, Rec. CE p. 78), le justiciable peut désormais engager la responsabilité de l’État du fait de l’application d’une loi déclarée contraire à la Constitution.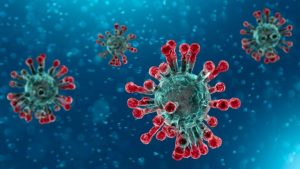 Au cœur des chassés-croisés des vacances d’hiver, l’apparition de cas groupés (« clusters ») de Covid-19 a provoqué une panique médiatique rarement égalée. A celle-ci a répondu l’annonce de mesures destinées à contenir la contagion : activation du plan ORSAN organisant la mobilisation du système de santé, déploiement d’une campagne d’information et de recommandations sanitaires, conseils de défense et conseils des ministres exceptionnels, passage au stade 2 du plan de prévention et de gestion de crise sanitaire.
Au cœur des chassés-croisés des vacances d’hiver, l’apparition de cas groupés (« clusters ») de Covid-19 a provoqué une panique médiatique rarement égalée. A celle-ci a répondu l’annonce de mesures destinées à contenir la contagion : activation du plan ORSAN organisant la mobilisation du système de santé, déploiement d’une campagne d’information et de recommandations sanitaires, conseils de défense et conseils des ministres exceptionnels, passage au stade 2 du plan de prévention et de gestion de crise sanitaire.