Forgé et promu par le juriste et activiste sud-africain, Kabir Bavikatte, le concept de droits bioculturels est le résultat d’un effort d’interprétation et de construction autour d’instruments internationaux contraignants et non contraignants, de décisions rendues par des juridictions ou quasi-juridictions internationales, de recommandations des organes conventionnels de protection des droits de l’homme et de dispositions et jurisprudences régionales et nationales. Il s’agit d’un « faisceau » de droits conçu de manière à mieux protéger les intérêts collectifs des peuples autochtones et populations locales, mais aussi – et c’est ce qui en fait assurément toute la singularité – de mieux protéger l’humanité (ou la communauté biotique dans son ensemble) à travers la préservation des activités, pratiques, savoirs et valeurs des peuples autochtones et communautés locales liés à leur rôle supposé d’intendants (« steward ») de la nature. Récemment consacrés par une décision importante de la Cour constitutionnelle de Colombie, les droits bioculturels, qui s’inscrivent aussi dans la dynamique initiée par la réflexion sur les communs, permettent d’interroger à nouveaux frais un certain nombre de thématiques importantes qui se situent au croisement du droit de l’environnement et des droits et libertés fondamentaux : la capacité des droits fondamentaux à répondre aux crises environnementales sans intégrer un volet de « devoirs » ; l’aptitude des systèmes juridiques contemporains à tenir compte d’ontologies non occidentales ; la nécessité de concevoir un cadre juridique intégré pour permettre à la fois un contrôle des communautés autochtones et locales sur leurs ressources et savoirs traditionnels associés et assurer une gestion efficace de l’environnement ; enfin, l’enjeu, d’ontologie politique, de constitution de nouveaux sujets de droit, qui va de pair avec la reconnaissance des « droits de la nature », et qui interroge directement le statut éthico-politique des peuples autochtones et communautés locales dans l’Anthropocène.
![]()
Fabien Girard est maître de conférences à la Faculté de droit de Grenoble (UGA), membre du Centre de Recherches Juridiques (Grenoble – UGA). Ses travaux se situent à l’intersection de la propriété, de l’agrobiodiversité et des droits des populations locales. Son dernier ouvrage, The Commons, Plant Breeding and Agricultural Research. Challenges for Food Security and Agrobiodiversity (avec C. Frison), a paru chez Routledge en 2018.
Communs et droits fondamentaux : la catégorie naissante des droits bioculturels[1]
I. La genèse des droits bioculturels : de la protection des populations locales à une approche intégrée de la gestion locale de l’environnement.
A. Des droits « tribaux » aux droits sur les « ressources traditionnelles ».
B. Les communautés autochtones et locales, intendantes de la nature.
II. La physionomie des droits bioculturels : de l’autodétermination à l’intendance de la nature
A. Les fondements des droits bioculturels.
1) Fondements textuels.
2) Fondements jurisprudentiels.
B. Le contenu des droits bioculturels.
1) Droit à la terre, au territoire et aux ressources naturelles.
2) Le droit à l’autodétermination.
3) Les droits culturels.
4) Le devoir d’intendance.
III. Les défis des droits bioculturels : du devoir d’intendance à la subjectivité juridique.
![]()
<IMAGE 1 : https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/ambalavao-madagascar-december-11-2013-rice-407635330>
1.— Plutôt que d’affronter directement les communs dans leur nature polymorphe et transdisciplinaire, on aimerait plutôt ici en décrire l’un des aboutissements récents dans le champ des droits fondamentaux. Mais qu’on ne s’y trompe pas, il s’agit moins ici d’une contribution massive et éclatante, que d’une contribution diffuse mais néanmoins omniprésente à une construction avant tout doctrinale qui commence à recevoir ses premières traductions positives.
Quant aux liens avec les droits et libertés fondamentaux, ils sont à la fois nombreux et ténus, car les droits bioculturels permettent assurément d’observer le droit international des droits de l’homme en mouvement dans sa confrontation aux enjeux environnementaux et d’assister au rôle de la doctrine et de la pratique dans la théorisation d’éléments disparates et la constitution de nouvelles catégories juridiques opérationnelles ; de conduire aussi à nouveaux frais le débat sur la place des devoirs dans la théorie des droits humains et d’entamer une réflexion sur les soubassements éthiques des droits fondamentaux, en particulier leur capacité à intégrer des valeurs non instrumentales et moins anthropocentriques au nom des intérêts de la communauté biotique[2] ; enfin, d’ouvrir une réflexion moins inédite, mais néanmoins nécessaire, sur la place des « droits collectifs » et « droits de groupe » au sein des droits humains et leur acclimatation dans un système à prétention universaliste.
2.— Avec les droits bioculturels, on entre dans le domaine des catégories juridiques naissantes, non encore consacrées en droit international, même si on signalera quelques références discrètes aux « protocoles communautaires » – encore appelés « protocoles bioculturels communautaires »[3] – qui leur sont étroitement associés et même si une décision récente et audacieuse de la Cour constitutionnelle colombienne[4] paraît les promettre à un avenir juridique radieux. On verra en tout cas dans ces évolutions la confirmation que les droits bioculturels ne sont pas qu’une opinion de iure condendo[5], mais bien le résultat d’un effort d’interprétation et de construction autour d’instruments internationaux contraignants et non contraignants, de décisions rendues par des juridictions ou quasi-juridictions internationales, de recommandations des organes conventionnels de protection des droits de l’homme, ainsi que de dispositions et jurisprudences régionales et nationales. Les droits qui composent le « faisceau » des « droits bioculturels » – puisqu’il s’agit, selon leurs promoteurs d’un « panier » de droits – existent néanmoins déjà et bénéficient d’une reconnaissance plus ou moins assurée en droit international. Mais, c’est leur interaction et leur ambition intégrative qui ne serait pas reconnue, de même que la singularité de leur régime juridique articulé autour d’un devoir central : celui d’assurer une bonne gestion ou intendance de la nature.
3.— Car disons-le, le concept de droits bioculturels, forgé et promu par Kabir Bavikatte, juriste de l’environnement, activiste et fondateur de l’ONG Natural Justice[6], était avant tout destiné à saisir de manière intégrée ce qu’on a appelé « des dynamiques juridiques anciennes amorcées dans le sillage de la Convention sur la diversité biologique (CDB), adoptée lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992 »[7] ; et à porter aussi la voix et les intérêts des « communautés autochtones et locales »[8] dans les débats internationaux sur les droits des communautés locales « traditionnelles »[9] et peuples autochtones et la protection de l’environnement. Se dévoile d’ailleurs ici le double fondement qui fait toute l’originalité des droits bioculturels comme faisceau de droits destiné à maintenir le rôle des communautés locales et des peuples autochtones dans la protection de l’environnement (ce qu’on appelle aussi leur « ethic of environmental stewardship ») [10] : d’une part, une meilleure protection des intérêts collectifs des peuples autochtones et populations locales ; de l’autre, la protection plus générale de l’humanité (ou de la communauté biotique dans son ensemble), à travers la préservation des activités, pratiques, savoirs et valeurs des peuples autochtones et communautés locales liés à leur rôle supposé d’intendants[11] (« steward ») de la nature. La singularité de la construction découle donc de ce que peuples autochtones et communautés locales sont protégés non en tant que tels, mais en tant que leurs activités et leurs valeurs sont instrumentalement liées à la protection de l’environnement. Ce lien instrumental est particulièrement visible à l’article 8(j) de la Convention sur la diversité biologique (CDB) qui stipule, sous un certain nombre de réserves, que chaque Partie contractante « préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique »[12].
4.— Quant au faisceau lui-même, il est composé de plusieurs droits déjà reconnus ou en voie de reconnaissance au profit des peuples autochtones et communautés locales, auxquels s’ajoute un devoir particulier qui accuse encore la singularité de proposition dans le cadre actuel des droits fondamentaux.
De manière synoptique, le panier de droits comprend : (i) le droit à la terre, au territoire et aux ressources naturelles ; (ii) le droit à l’autodétermination, entendu principalement ici dans sa dimension « interne »[13], i.e. le droit des communautés à l’autonomie et à s’administrer elles-mêmes ; (iii) les droits culturels. Enfin, le faisceau comporte (iv) un « devoir d’intendance » qui découle de l’« ethic of stewardship » associée aux pratiques, valeurs et modes de vie des populations locales. Comme permet de le voir le schéma suivant (schéma n° 1), qui souligne aussi le rôle nodal de l’éthique d’intendance (« stewardship »), les droits et le devoir qui forment le faisceau des droits bioculturels ont bien pour fondement (et finalité) principal la conservation et l’utilisation durable de l’environnement.
![]()
Schéma n° 1 – Représentation du « faisceau » des droits bioculturels[14]
5.— La construction théorique croise de manière évidente deux discours particulièrement présents, à l’échelle internationale, à l’appui des revendications des peuples autochtones et communautés locales. Le premier, qui s’inscrit dans un contexte de rejet progressif de la figure coloniale et néocoloniale du « primitif » pauvre, sous-développé et marginalisé[15], souligne que les populations locales peuvent prendre en charge leur destin sur un territoire donné, ce d’autant plus qu’elles l’occupent de longue date et, à travers leurs institutions, exercent une forme de souveraineté. Quant au second, il postule, à la faveur d’une révision du récit dépréciatif des populations locales comme ennemies de la nature[16], « […] que les solutions à la crise environnementale globale ne peuvent venir que des communautés autochtones et locales qui ont historiquement fait la preuve de leur capacité à tirer parti de leur milieu sans le dégrader »[17].
6.— Nous voudrions montrer ici que, sans être inexacte, cette lecture est un peu étroite ; que si, en effet, les droits bioculturels s’inscrivent dans une dynamique de renouvellement du cadre de la conservation et des politiques de développement et d’élargissement des droits des peuples autochtones et communautés locales, ils sont inséparables d’une série d’enjeux et de transformations contemporaines qui interrogent la capacité des droits fondamentaux à répondre aux crises environnementales sans intégrer un volet de « devoirs », l’aptitude des systèmes juridiques contemporains à tenir compte d’ontologies non occidentales (et donc à répondre véritablement aux revendications portées par les peuples autochtones, mais aussi un grand nombre de communautés locales à travers le monde, y compris en Occident) et la nécessité de concevoir un cadre juridique intégré pour permettre à la fois un contrôle des communautés autochtones et locales sur leurs ressources et savoirs traditionnels associés et assurer une gestion efficace de l’environnement – et ce sans essentialisation ni romantisation ou instrumentalisation. Un dernier enjeu, qu’on qualifiera d’ontologie politique, porte sur la constitution de nouveaux sujets de droit que le débat sur les « droits de la nature » a contribué à porter au premier plan, et il interroge aujourd’hui aussi le statut éthico-politique des peuples autochtones et communautés locales dans l’Anthropocène[18].
Cette mise en abîme, qui souligne les insuffisances des droits occidentaux et la nécessaire « défragmentation »[19] tant du droit international que des droits nationaux en matière d’environnement, de culture et de ressources naturelles, est à mettre au crédit des droits bioculturels qui, pour ces raisons, et quelles qu’en soient les insuffisances et les dangers, méritent d’être pris en sérieux.
7.— On en propose une étude approfondie dans les lignes qui suivent, en gardant pour prisme la série de défis qui accompagne l’entrée des droits contemporains dans l’ère de l’Anthropocène et la nécessité d’acclimater des éthiques moins anthropocentriques au sein des droits fondamentaux. Pour ce faire, on offre une présentation du développement des droits bioculturels, de la protection des populations locales à une approche intégrée de la gestion locale de l’environnement (§1) ; elle-même suivie d’une étude de la physionomie des droits bioculturels, de l’autodétermination à la question de l’intendance de la nature (§2). On examine dans un dernier temps les défis que posent les droits bioculturels, en particulier les enjeux liés au devoir d’intendance et à la subjectivité juridique (§3).
I. La genèse des droits bioculturels : de la protection des populations locales à une approche intégrée de la gestion locale de l’environnement
8.— Si la conceptualisation des « droits bioculturels » est due, pour l’essentiel, au travail de Kabir Sanjay Bavikatte[20], elle n’a pu s’accomplir sans le travail pionnier de quelques auteurs sur ce qu’on a pu appeler les droits « tribaux » et les droits sur les « ressources traditionnelles » (A). Elle a également bénéficié d’une série de transformations au plus long court et sans doute plus discrètes qui ont contribué à faire émerger, dans la rhétorique des organisations internationales et des acteurs du développement, l’idée de communautés locales et autochtones comme « intendantes de la nature » (B).
A. Des droits « tribaux » aux droits sur les « ressources traditionnelles »
9.— Seul ou avec les quelques collègues – activistes ou universitaires – qui l’ont suivi depuis le développement de Natural Justice jusqu’à l’accompagnement du groupe des États africains dans le cadre des négociations du Protocole de Nagoya[21], Kabir Bavikatte a eu maintes fois l’occasion de s’exprimer sur les courants et auteurs qui l’ont guidé dans la conceptualisation des droits bioculturels. On aura l’occasion de s’y attarder à la subdivision suivante, mais il faut peut-être d’emblée insister ici sur le rôle joué par une poignée d’universitaires, tels Tom Greaves, Tewolde Egziabher et surtout Darrell Addison Posey[22], particulièrement sensibles à la situation des populations des Suds, et qui, dans un contexte de profonde refonte du régime international des ressources génétiques, ont souhaité œuvrer au développement de mécanismes juridiques ad hoc susceptibles de mieux protéger les ressources génétiques et savoirs traditionnels associés des populations locales.
10.— Dans les années qui ont suivi l’adoption, en 1983, de l’Engagement international sur les ressources phytogénétiques et la consécration de la notion de « patrimoine commun de l’humanité »[23], il est assez rapidement apparu un déséquilibre dans le régime international de protection de la biodiversité. Censé permettre de maintenir, dans un contexte de prise de conscience de l’érosion rapide de la biodiversité, un flot suffisant de germoplasme (ressources génétiques) pour garantir l’innovation variétale tout en fixant des règles de « réciprocité » et de « consentement préalable » sous le contrôle des États érigés en fidéicommissaires, il a surtout permis aux pays industrialisés de continuer de puiser sans contrepartie dans les centres de diversité du Sud, de faire protéger leurs innovations végétales par des droits de propriété intellectuelle et de les exploiter ensuite commercialement dans l’ensemble du monde[24]. Pour mettre fin à ce qui continuait d’être perçu comme une forme d’injustice de la part des pays des Suds[25], et dans un contexte de diffusion internationale du brevet[26], la communauté internationale a accepté de reconnaître « les droits souverains » des États sur les ressources présentes sur leur territoire et donc la nécessité pour les États utilisateurs de ressources de respecter des règles d’Accès et de Partage des Avantages (APA) et des règles fixées d’un commun accord. C’est le progrès considérable qu’accomplit la CDB, adoptée lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992.
L’autre changement de taille, c’est la reconnaissance, dès le Préambule de l’instrument international, du fait qu’un « grand nombre de communautés locales et de populations autochtones dépendant étroitement et traditionnellement des ressources biologiques sur lesquelles sont fondées leurs traditions » et de la nécessité « d’assurer le partage équitable des avantages découlant de l’utilisation des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles intéressant la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments »[27].
11.— L’article 8(j), dont les stipulations s’efforcent de donner effet utile à cette déclaration d’intention, constitue assurément une avancée notable, en imposant aux États « dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra […] » et « [s]ous réserve des dispositions de sa législation nationale », de respecter, préserver et maintenir les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales, d’en favoriser « l’application sur une plus grande échelle, avec l’accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques » et d’encourager « le partage équitable des avantages découlant de l’utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques ». Mais, outre son caractère « programmatoire »[28] – qui a conduit la grande majorité des États au plus grand immobilisme en matière de procédures d’APA au profit des peuples autochtones et communautés locales[29] – et son caractère vague[30], le texte de la CDB restait surtout totalement silencieux sur le sort à réserver aux « ressources génétiques » éventuellement « détenues » par les communautés locales et autochtones pour lesquelles les États ne sont même pas « invités » à recueillir l’accord ou assurer la participation des « détenteurs », pour ne rien dire du partage équitable des avantages[31]. Ainsi, face au large consensus international louant la « bioprospection »[32] comme promesse d’innovation par l’usage combiné du matériel biologique et des savoirs traditionnels associés, des activistes puis des universitaires ont commencé à dénoncer avec vigueur la « biopiraterie »[33] organisée par le régime international des ressources génétiques[34].
12.— Dans les premières années qui suivent son entrée en vigueur, la CDB est donc naturellement l’objet de critiques virulentes qui conduisent quelques auteurs pionniers à proposer des solutions techniques ambitieuses, qui convergent toutes dans la volonté « d’ériger une barrière contre l’utilisation et l’appropriation, par des tiers, des innovations produites par les agriculteurs/les communautés sans leur consentement et sans partage des avantages »[35]. Méritent particulièrement d’être signalées la proposition de Greaves suggérant de créer des droits « tribaux » ou « communaux »[36] et celle de Egziabher pressant la communauté internationale de reconnaître des « droits intellectuels communautaires »[37]. Ce n’est pas lieu d’en examiner les vertus et surtout les faiblesses[38]. Tout au mieux peut-on dire que, en même temps qu’elles soulignent la nécessité de mieux protéger les ressources, innovations, savoirs et pratiques de populations locales, elles reproduisent le biais en partie réductionniste de la CDB. C’est ce qu’avait bien compris l’ethnobiologiste Darrell A. Posey, l’un des premiers grands défenseurs des droits des peuples autochtones, dont la théorie des « droits sur les ressources traditionnelles » s’efforçait justement de dépasser la logique d’appropriation et de marchandisation à laquelle beaucoup d’auteurs paraissaient jusqu’alors condamner les populations locales.
13.—La force de Posey, aux travaux duquel est venu par la suite s’associer le juriste anglais Graham Dutfield[39], est d’avoir mis en lumière la double philosophie qui parcourt la CDB et d’en avoir tiré des enseignements sur les évolutions possibles du cadre international de protection des communautés locales. D’un côté, certes, la CDB poursuit un projet qu’on a justement qualifié de néo‑libéral : ressources génétiques et savoirs traditionnels sont appréhendés dans leur valeur marchande, que les communautés locales et peuples autochtones peuvent échanger sur le marché de la biodiversité en contrepartie d’avantages monétaires et non monétaires. Les ressources et savoirs transférés aux bioprospecteurs servent à développer de nouvelles technologies pour le bien de l’humanité, tandis que les avantages qui reviennent aux communautés sont censés jouer comme leviers incitatifs à la préservation de la biodiversité, tout en contribuant à leur développement[40]. D’un autre côté, toutefois, et c’est tout le mérite de Posey de l’avoir montré, la CDB porte une vision moins économiste et utilitariste que dévoile la reconnaissance explicite et insistante de l’« incarnation » des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales dans des modes de vie, leur rôle aussi dans la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique[41]. L’Agenda 21, plan d’action pour le XXIe siècle, également adopté lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992[42], énonce d’ailleurs nettement, dans son Principe 26, que les « populations autochtones et leurs communautés » « […] ont développé au cours des générations une connaissance scientifique traditionnelle et holistique de leurs terres, de leurs ressources naturelles et de leur environnement »[43]. Au titre des objectifs, les gouvernements et les organisations internationales sont invités à reconnaître « leurs valeurs, connaissances traditionnelles et pratiques de gestion des ressources en vue de promouvoir un développement écologiquement rationnel et durable »[44] et à reconnaître le fait que « la dépendance traditionnelle et directe à l’égard des ressources renouvelables et des écosystèmes, y compris les récoltes durables, continue d’être essentielle pour le bien-être culturel, économique et physique des populations autochtones et de leurs communautés »[45]. Il ne s’agit plus ici de consacrer ce qui pourrait s’apparenter à des droits de propriété intellectuelle des populations locales sur les ressources génétiques et savoirs associés qu’elles détiennent, mais bien de protéger des valeurs, connaissances et pratiques associées à un mode de vie, en tant que ce dernier est lui-même fondé sur des rapports particuliers à la terre et aux ressources naturelles et s’avère positivement lié au développement de ces populations et à la protection de l’environnement.
14.—Notant ainsi les fortes tensions traversant la CDB, mais aussi la Déclaration de Rio et l’Agenda 21[46], Posey proposait de les exploiter pour faire triompher, à l’échelle internationale, le volet le plus protecteur des peuples autochtones[47]. Pour ce faire, il lui paraissait urgent et indispensable de renoncer à appréhender les savoirs traditionnels à travers le prisme des droits occidentaux, sans tenir compte de la manière dont les systèmes juridiques autochtones conçoivent la propriété[48]. Il lui semblait surtout inapproprié et dangereux de positionner le débat sur le seul terrain de l’appropriation : ce que désirent les populations locales – et ce dont elles ont besoin –, ce n’est pas (ou pas seulement) la commercialisation de leur savoirs et ressources génétiques, mais bien au contraire la possibilité de dire « non » à la privatisation et la commercialisation, i.e. de choisir si, comment et avec qui elles partagent telle ou telle partie de leur patrimoine. Investis de valeurs multiformes, attachés indéfectiblement à leur identité et conditions indispensables de la continuité de la communauté[49], ressources et savoirs traditionnels[50] ne peuvent être réduits sans péril à leur seule valeur marchande[51]. Si on suppose du reste que les populations locales ont, du fait de leur attachement à la terre et leurs ressources, un rôle crucial à jouer dans la préservation de l’environnement, il convient ainsi de défendre non point tant la propriété immatérielle des communautés sur leurs ressources et savoirs que leur autonomie dans la gestion des éléments de leur culture et de leur environnement naturel. De fait, les « traditional resources rights » – droits sur les ressources traditionnelles –, dont Posey fait la proposition au milieu des années 1990, sont avant tout un appel à une plus grande autonomie des populations locales, ce qu’il qualifie de « droit à l’autodétermination », et qui constitue le noyau dur de sa construction. Le « de facto self-determination », comme il l’appelle encore autrement[52], c’est avant tout un faisceau de droits qui permet aux communautés de contrôler leurs culture, savoirs, pratiques, traditions, mais qui ne saurait être effectif sans une reconnaissance préalable des droits sur la terre et le territoire[53]. L’un ne saurait aller sans l’autre[54]. En tant que l’un des fondateurs du concept de « diversité bioculturelle » qui met en évidence les liens indissociables entre la diversité de la culture et la diversité biologique[55], Posey a toujours insisté sur la nécessité de protéger ensemble territoires, terres et ressources, d’une part, et cultures, pratiques, langages et traditions, de l’autre[56]. Pour assurer la protection de l’identité des peuples autochtones et communautés locales et ne pas compromettre leur survie, il importe donc de promouvoir une approche intégrée[57]. La reconnaissance des droits sur les ressources est une nécessité, mais elle est inséparable d’une reconnaissance plus large du droit d’accès à la terre qui en est le support, et des droits sur la culture qui est en interaction constante avec la biodiversité.
Retour en haut
B. Les communautés autochtones et locales, intendantes de la nature
15.— Adossé au concept naissant de diversité bioculturelle, le concept de « droits sur les ressources traditionnelles » porte sur la scène internationale un discours nouveau sur la nécessité d’offrir aux communautés locales et peuples autochtones une protection intégrée de leurs ressources et savoirs traditionnels, mais aussi de leurs terres, territoires et cultures. Si la démarche est novatrice, elle ne place pas encore les populations locales au centre des enjeux de conservation[58]. Ce changement de prisme, qu’accomplit formellement la proposition de « droits bioculturels », ne devient en réalité possible que parce que se développent parallèlement de nouveaux discours sur le rôle des populations locales dans « l’intendance de la nature ». La figure du peuple autochtone ou de la communauté locale porteur d’une « ethic of stewardship » est, en effet, très présente dans quatre mouvements qui se déploient entre les années 1980 et le début du XXIe siècle[59] : le mouvement post-développement, la critique du modèle dit « fortress conservation », les « commons », enfin le mouvement en faveur du droit des peuples autochtones.
16.— Dans les années 1970-1980, la rencontre des notions de capital, de progrès et de technologies ouvre une période de certitude qu’on a appelé le « développement ». Selon ces principes sous-jacents, les prescriptions produites par les grandes institutions comme la Banque mondiale et les grandes universités occidentales doivent permettre, à terme, à coup d’investissements majeurs et de nouvelles technologies, de transformer activement les « sociétés traditionnelles » en « sociétés modernes »[60]. Ces principes ont notamment guidé, entre les années 1970 et 1980, de larges projets destinés à profondément transformer les agricultures des PED et des pays les moins avancés, et ont conduit à une large intensification de la production, à un usage massif de variétés améliorés à haut rendement et à l’emploi d’intrants à grande échelle – ce qu’on a appelé la Révolution Verte[61]. Le mouvement du développement a rapidement rencontré ses critiques, venues respectivement des camps libéral, marxiste et poststructuraliste[62]. Mais il faut surtout souligner l’importance de la critique issue du « post-développement », qui va plus loin que les premiers en ne s’interrogeant plus seulement sur les alternatives de développement, mais en recherchant directement des alternatives au développement[63]. La première grande vertu du post-développement a été de questionner la place nodale du développement dans les représentations de la réalité sociale en Afrique, en Asie et en Amérique latine, de remettre aussi profondément en cause la configuration du savoir et du pouvoir par les experts internationaux, tout en ouvrant un nouvel espace discursif pour construire de nouveaux projets en rupture avec le développement. Autre apport de poids que résume Arturo Escobar, le post‑développement a pu suggérer que « les idées les plus utiles en termes d’alternatives pouvaient être obtenues à partir des connaissances et des pratiques des mouvements sociaux […] »[64]. Le constat dramatique de la pauvreté et des désastres environnementaux causés par les projets de développement – dont l’exemple symptomatique reste sans doute la Révolution Verte en Inde[65] –, alimente une pensée contre-hégémonique qui commence à faire le lien entre protection de l’environnement et l’activité subalterne et jusque-là invisible des communautés rurales, des paysans et des peuples autochtones.
17.— Ce premier changement se double d’une évolution notable des sciences de la conservation. Aux XVIIIe et XIXe siècles, les administrations coloniales installées dans le Sud global ont commencé à prendre conscience des conséquences néfastes de l’exploitation massive de l’environnement sur lequel reposait leur système économique et social[66]. Elles ont, en réaction, fait de l’environnement, à la fois un capital à exploiter de manière extensive pour répondre aux besoins des empires et une nature « vierge » et « sauvage » à préserver à tout prix des activités jugées destructrices des populations locales. Ce cadre, imprégné d’idées passablement contradictoires et parfois racistes[67], aboutit à la mise en place du modèle dit « fortress conservation » (ou « fences and fines approach »)[68] dont le Parc national Yellowstone, créé en 1872 dans le Montana, est souvent présenté comme le parangon. Les aires protégées doivent restées vierges de toute activité humaine (« pristines »), et la législation qui se met progressivement en place – alimentée par une science coloniale qui voit dans les peuples et communautés locales une menace directe à la survie des écosystèmes –, transforme les chasseurs en braconniers, les bûcherons en délinquants et les paysans en ennemis de la conservation[69]. Les conséquences de ce modèle ont été souvent dramatiques pour les populations locales. La création de vastes aires protégées, que ce soit en Amérique, en Australie, en Asie ou en Afrique, n’a, en effet, été possible que par « le déplacement forcé et la décimation des peuples autochtones, à l’origine de nombreuses violations des droits civils, économiques et culturels […] »[70]. En 2016, la Rapporteuse spéciale sur les droits des peuples autochtones soulignait ainsi qu’environ 50% des aires protégées existantes avaient été créées sur les terres et territoires traditionnellement détenus par les peuples autochtones[71].
18.— Le modèle commence à être remis en cause à partir du début des années 1980[72], à la fois en raison, d’un réajustement des politiques de « développement », du constat de son ineffectivité[73] en matière environnementale et d’une mise en visibilité, qui va de pair avec les critiques du développement[74], du rôle essentiel des peuples autochtones et communautés locales dans la protection de l’environnement[75]. Dans les deux décennies qui suivent, la littérature souligne ainsi, avec plus de force, l’importance des savoirs agroécologiques locaux, mais aussi des institutions traditionnelles, droits coutumiers et systèmes éthiques en accord avec les contextes écologiques locaux pour la protection et le maintien des espaces protégés. Posey a également contribué à faire évoluer les idées chez les conservationnistes en mettant en lumière l’existence d’une relation mutuelle, durable et bénéfique entre certaines populations locales et l’environnement. Insistant sur les liens indissociables entre nature et culture[76] – au cœur du concept de diversité bioculturelle qu’il a contribué à populariser[77] –, il n’a cessé de souligner, ce qu’admettent aujourd’hui largement l’ethnoécologie et l’ethnobiologie[78], la centralité de l’environnement dans les pratiques et croyances d’un grand nombre de peuples autochtones et communautés locales. Comme le disait aussi Luisa Maffi, ces communautés et peuples « savent que leur vie et leur futur immédiat – ainsi que le bien-être des futures générations – dépendent de l’environnement dans lesquels ils vivent et de la biodiversité dont ils dépendent étroitement »[79]. Parce que, pour nombre de ces populations, tout dans la nature est interconnecté et interdépendant, et parce qu’elles sont aussi étroitement dépendantes de l’environnement dans lequel elles vivent, elles ont développé une relation ou éthique particulière de soin ou d’intendance de la nature. Comme l’écrit Posey : « Indigenous and traditional peoples frequently view themselves as guardians and stewards of nature. Harmony and equilibrium among components of the cosmos are central concepts in most cosmologies »[80]. En 1992, la Recommandation 6 du Caracas Action Plan 1992, adoptée lors de la 4e édition du Congrès Mondial des Parcs de l’UICN[81], acte ce changement de philosophie que viennent confirmer l’Accord et le Plan d’action de Durban adoptés lors de la 5e édition du Congrès de l’UICN[82].
19.— Autre mouvement (et même école) qui a contribué à rendre visible l’activité des peuples autochtones et communautés locales et qui a, ce faisant, participé à la genèse intellectuelle des droits bioculturels, celui des « commons » ou « communs ». Le mouvement des « communs » [83] est avant tout associé au nom d’Elinor Ostrom, connue au-delà du cercle des économistes pour le prix de la Banque de Suède en sciences économiques qui lui a été attribuée en 2009, en récompense de ses travaux sur la gouvernance économique des « ressources communes » (en anglais : « common pool resources »). Son nom est indissociablement associé à celui de l’écologue et néomalthusien américain[84], Garrett Hardin, surtout célèbre pour un article publié en 1968 dans la revue Science : « The Tragedy of the Commons »[85]. Hardin a, malgré lui, contribué à populariser le terme de « commun »[86], et la première thèse d’Ostrom est une réfutation de l’argument articulé par Hardin en 1968 : un pâturage ouvert à tous, sur lequel chaque berger peut librement venir faire paître ses bêtes, est mécaniquement conduit au surpâturage, i.e. à l’épuisement de la fertilité du pré. Dans un « commun », notait-il – et c’est là que réside la « tragédie » – « chacun cherche à maximiser ses intérêts » et nul n’est incité à préserver la ressource commune[87]. Pour échapper à la tragédie, en contraignant chaque pâtre à intégrer à sa décision le coût de l’unité prélevée pour la collectivité, il n’est d’autre ressource que de recourir à la propriété publique ou privée.
20.— Dès 1970, des économistes de l’écologie pointaient l’erreur fondamentale d’Hardin : l’amalgame, niché au cœur de son raisonnement, entre « commun » et « libre accès »[88]. Dans ce dernier cas, comme le montre la production historique et ethnographique assez dense qui documente la gestion locale défectueuse des ressources qui suit une période coloniale ou postcoloniale d’intense centralisation[89], l’absence de règles de gestion et institutions (ou leur extrême faiblesse) compromet la gestion durable de la ressource commune[90]. Dans le premier cas, et c’est tout le mérite du travail d’Ostrom que de l’avoir décrit à partir d’études empiriques, les communautés sont capables de surmonter les problèmes d’action collective en s’auto-organisant, assurant ainsi la gestion à long terme des ressources communes (common-pool resources). Comme a pu le résumer Ostrom : « a surprisingly large number of individuals facing collective action problems do cooperate. Contrary to the conventional theory, many groups in the field have self-organized to develop solutions to common-pool resource problems at a small to medium scale »[91]. Le cadre ostromien, qui a été affiné au fil des années par l’économiste américaine et tous ceux qui se réclament de son œuvre, a pour point de départ les « principes de conception communs aux institutions durables »[92]. S’ils ne sauraient être analysés comme des conditions sine qua non devant être satisfaites pour garantir une gestion durable des communs[93], ils rappellent en tout cas que, pour qu’un cadre institutionnel de gouvernance soit efficace et durable, il doit susciter la confiance et la réciprocité entre les membres et être collectivement défini et appliqué par les membres eux-mêmes, en tenant compte des conditions locales et de la préservation de la ressource à long terme.
21.— Le dernier mouvement qui permet également de faire émerger les populations locales dans leur lien particulier à l’environnement, c’est le mouvement en faveur des droits des peuples autochtones qui a progressivement permis leur insertion dans le droit international des droits de l’homme et la reconnaissance des peuples autochtones, en droit international, mais aussi dans un nombre croissant de droits nationaux, en tant que véritables « sujets collectifs »[94]. On peut laisser de côté la Convention n° 107 de l’OIT relative aux populations aborigènes et tribales [95], qui, tout en reconnaissant des besoins spécifiques pour assurer la protection des droits fondamentaux des peuples autochtones, reflète principalement, comme le note James Anaya, « the premise of assimilation operative among dominant political elements in national and international circles at the time of the convention’s adoption. The universe of values that promoted the emancipation of colonial territories during the middle part of this century simultaneously promoted the assimilation of members of culturally distinctive indigenous groups into dominant political and social orders that engulfed them »[96]. Les changements ne se dessinent qu’à compter des années 1960, lorsqu’une jeune génération de femmes et d’hommes éduqués et fins connaisseurs des systèmes juridiques dominants commence à porter de nouvelles revendications, dont celle des peuples autochtones de continuer d’exister en tant que communautés distinctes avec des cultures et des institutions politiques enracinées dans l’histoire et jouissant de droits sur la terre. Anaya observe que, dès lors, les « Indigenous peoples articulated a vision of themselves different from that previously advanced and acted upon by dominant sectors »[97]. Grâce à la tenue de plusieurs conférences internationales et aux appels lancés aux grandes institutions intergouvernementales, ces efforts ont pu se transformer en véritable campagne, à laquelle universitaires et ONG sont, du reste, venus offrir un large écho[98] dans les années 1970. La fin des années 1980 marquent enfin l’adoption et l’entrée en vigueur du premier instrument international majeur, la Convention (n° 169) de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux, adopté en 1989[99]. La Convention est une révision de la Convention n° 107 dont elle vient d’abord rejeter la philosophie intégrationniste et assimilationniste.
22.— Le préambule s’ouvre sur des clauses particulièrement importantes, dont celle par laquelle la Conférence générale de l’OIT prend acte de l’aspiration à l’autonomie des peuples concernés[100] (à l’égard de leurs modes de vie, leurs institutions et leur développement économique) et à la préservation et au développement de leur identité, langue et religion. Surtout, les clauses du préambule permettent à la Conférence générale de l’OIT d’attirer l’attention « […] sur la contribution particulière des peuples indigènes et tribaux à la diversité culturelle et à l’harmonie sociale et écologique de l’humanité […] »[101]. Outre l’obligation faite aux États de respecter « l’importance spéciale que revêt pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples intéressés la relation qu’ils entretiennent avec les terres ou territoires, ou avec les deux […] »[102], la Convention leur impose la reconnaissance des droits de propriété et de possession sur les terres que les peuples tribaux et indigènes occupent traditionnellement. Par ailleurs, elle commande que des mesures soient prises, « dans les cas appropriés », « pour sauvegarder le droit des peuples intéressés d’utiliser les terres non exclusivement occupées par eux, mais auxquels ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance »[103]. Par une stipulation particulièrement forte, les Parties contractantes sont, du reste, spécialement tenues de sauvegarder les droits des peuples intéressés sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres – droits qui comprennent celui, pour ces peuples, de participer à l’utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources[104]. S’ajoutent, enfin, les stipulations relatives aux mesures spéciales qui doivent être adoptées en vue de sauvegarder, notamment, la culture et l’environnement des peuples intéressés[105], l’obligation faite aux États, dans l’application de la Convention, « de reconnaître et protéger les valeurs et les pratiques sociales, culturelles, religieuses et spirituelles »[106] et de « respecter l’intégrité des valeurs, des pratiques et des institutions desdits peuples »[107], ainsi que le droit des peuples intéressés de conserver leurs coutumes et institutions[108]. Par son étendue et sa vision holistique, qui souligne à la fois les liens indissociables entre les peuples autochtones, leurs terres et leurs ressources, et la nécessité de préserver les pratiques et valeurs traditionnelles et la culture, ainsi que la coutume et les institutions qui les médiatisent, la Convention n° 169 de l’OIT a constitué une étape décisive dans la reconnaissance internationale des droits de peuples autochtones. Par les liens qu’elle ébauche aussi entre les modes de vie de ces peuples et « l’harmonie écologique », elle a pu être naturellement perçue comme une contribution décisive à la notion de stewardship placée au cœur des droits bioculturels.
23.— Ces liens s’accusent d’ailleurs dans deux instruments ultérieurs. Le premier, la CDB qui, sans être étranger au mouvement que l’on vient d’étudier, n’intéresse pas exclusivement les peuples autochtones. Il en sera plutôt question dans la deuxième partie[109]. Le second, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée en 2007[110], qui approfondit considérablement les garanties de la Convention (n° 169) de l’OIT. Bien que non juridiquement contraignante, la Déclaration a largement contribué à la reconnaissance, à l’échelle nationale, des droits constitutionnels des peuples autochtones et des minorités ethniques[111]. Elle continue aussi d’inspirer les systèmes régionaux de protection des droits de l’homme et les organes conventionnels des droits de l’homme[112], participant ainsi sans doute au développement d’un droit coutumier international[113]. Ces questions méritent un examen approfondi, que nous reportons au paragraphe suivant, mais il faut préciser ici que c’est dans le préambule que la Déclaration affirme de manière particulièrement forte le lien entre le mode de vie des peuples autochtones et la protection de l’environnement. L’instrument reconnaît, en effet, dans ses dispositions liminaires, que le « respect des savoirs, des cultures et des pratiques traditionnelles autochtones contribue à une mise en valeur durable et équitable de l’environnement et à sa bonne gestion »[114].
24.— Les quatre grands courants qui viennent d’être examinés ont contribué à faire émerger un récit productif faisant des communautés locales et des peuples autochtones des intendants de la nature. Ce récit se cristallise progressivement dans un certain nombre d’instruments internationaux relatifs aux aires protégées, à la conservation de la biodiversité et aux droits des peuples autochtones. C’est cette phase de cristallisation juridique qu’il convient désormais d’étudier attentivement en montrant comment elle a progressivement donné forme et substance à la catégorie des droits bioculturels.
Retour en haut
II. La physionomie des droits bioculturels : de l’autodétermination à l’intendance de la nature
25.— La mise en récit du rôle des communautés locales et des peuples autochtones dans la gestion de l’environnement, à laquelle contribue le post-développement, les communs, le mouvement en faveur des droits de peuples autochtones ou bien encore les sciences de la conservation, commence à recevoir une traduction juridique à la fin des années 1980. Le changement dans l’appréhension des populations locales est bien perceptible dans le texte de la CDB dont Posey remarquait la profonde ambiguïté[115], partagé qu’il est entre une vision économiste et utilitariste de la biodiversité et une vision plus holistique plaçant les peuples autochtones et communautés locales au centre du projet de préservation et d’usage durable des ressources génétiques et savoirs associés. La CDB constitue néanmoins une étape cruciale qui marque l’amplification d’une dynamique juridique alors récente en faveur de la protection de ces populations en leur qualité de steward/intendant de la nature. C’est cette dynamique, qui aboutit en définitive à l’éclosion des droits bioculturels, qu’il faut décrire, de manière à mettre en évidence les fondements des droits bioculturels (A), puis à en préciser le contenu (B).
A. Les fondements des droits bioculturels
26.— Même s’ils ont reçu une première consécration juridique récente et spectaculaire[116], les droits bioculturels sont avant tout attachés à la personne de Kabir Bavikatte dont il fait la proposition dans sa thèse de doctorat publiée en 2014[117]. On l’a déjà souligné, la proposition n’est pas simplement opinio doctorum ou opinion de iure condendo[118]. Elle s’appuie sur un riche matériau juridique existant, en droit international et en droit national, qu’elle réélabore de manière à montrer que de nouveaux droits de troisième génération sont en train d’apparaître sous nos yeux[119]. Il faut repartir de ce matériau, textuel et jurisprudentiel, qui a pu servir au travail de réélaboration normative, souligner aussi ce qui s’est produit depuis cette première formulation.
1) Fondements textuels
27.— La reconnaissance large du rôle d’intendance des communautés locales et peuples autochtones, à partir des années 1990, dans un grand nombre d’instruments internationaux contraignants et non contraignants, est annoncée par le Rapport Brundtland, Our Common Future/Notre avenir à tous, rédigé par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’Organisation des Nations Unies, présidée par la Norvégienne Gro Harlem Brundtland, et publié en 1987[120]. Ce rapport est d’une grande importance, car outre qu’il souligne l’exemplarité des populations locales dans la gestion des ressources présentes dans les écosystèmes complexes des forêts, des montagnes et des terres arides, et le lien entre cette gestion exemplaire et un riche patrimoine de connaissances et d’expériences traditionnelles, il appelle à la reconnaissance des droits de ces communautés comme moyen de maintenir leur mode de vie soutenable traditionnel[121]. Le rapport notait, de manière frappante, soulignant en termes particulièrement forts la nécessité d’une approche intégrée, que :
Le point de départ d’une politique juste et humaine à l’égard de ces groupes consiste à reconnaître et à protéger leurs droits traditionnels sur leurs terres et les autres ressources qui assurent leur mode de vie – droits qu’ils sont susceptibles de définir en des termes qui n’ont rien à voir avec les systèmes juridiques ordinaires. Les institutions de ces groupes, qui réglementent les droits et les obligations, jouent un rôle capital dans le maintien de l’harmonie avec la nature et de la conscience de l’environnement, caractéristiques du mode de vie traditionnel. Par conséquent, la reconnaissance des droits traditionnels doit aller de pair avec des mesures tendant à protéger les institutions locales qui inculquent la responsabilité de l’utilisation des ressources. Cette reconnaissance doit aussi donner aux communautés locales la possibilité d’intervenir dans les décisions prises au sujet de l’utilisation des ressources dans leur région[122].
28.— Le troisième Sommet de la Terre, qui s’est tenu à Rio de Janeiro (Brésil) en 1992, constitue, on l’a dit, une étape fondamentale vers la reconnaissance positive du rôle d’intendance des populations locales et a été analysé comme un moment décisif dans la consolidation des fondements des droits bioculturels[123]. Parmi les documents adoptés durant cette période, on doit mentionner la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement[124], dont le Principe 22 reconnaît que « [l]es populations et communautés autochtones et les autres collectivités locales ont un rôle vital à jouer dans la gestion de l’environnement et le développement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles » et invite les États à « reconnaître leur identité, leur culture et leurs intérêts, leur accorder tout l’appui nécessaire et leur permettre de participer efficacement à la réalisation d’un développement durable »[125]. Pareillement, l’Agenda 21, le plan d’action volontaire développé à l’occasion du Sommet de Rio, appelle les États à prendre leurs responsabilités à l’égard de l’environnement, en respectant les droits des peuples autochtones de participer dans la gestion de leurs territoires et en contribuant à la préservation et la promotion de leurs valeurs, savoirs traditionnels, pratiques de gestion qui ont un rôle à jouer en vue de la « promotion d’un développement écologiquement rationnel et durable » [126]. La CDB vient parachever l’ouvrage de manière forte[127]. Premier instrument international juridiquement contraignant reconnaissant tout à la fois le rôle des peuples autochtones et des communautés locales dans la conservation et l’usage durable de l’environnement, il souligne aussi expressément, dans ce cadre, l’importance de leur connaissances, innovations et pratiques pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique aux articles 8(j) et 10(c)[128]. Il faut toutefois redire ici la grande faiblesse de ces deux stipulations qui sont inhabituellement restrictives et conservent un caractère largement « programmatoire »[129]. Les États ont « le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources […] »[130], et même s’ils n’en sont pas les « propriétaires », ils ont le pouvoir de réglementer l’accès aux ressources génétiques[131] et donc de reconnaître, dans leur législation, les droits réels ou des mécanismes de contrôle sur ces connaissances au profit de tel ou tel groupe. L’article 8(j) ne s’achemine que timidement vers le devoir. C’est, en effet, sous fortes réserves (« Chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra : […] (j) Sous réserve des dispositions de sa législation nationale […] »)[132], que les États respectent, préservent et maintiennent les « connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique ».
29.— Par ailleurs, en incitant les États à favoriser « l’application sur une plus grande échelle » des connaissances, innovations et pratiques des peuples autochtones et communautés locales, l’instrument international s’inscrit incontestablement dans le grand récit – qu’on appellera économie de la promesse[133] – de la bioprospection[134]. Les ressources biologiques et savoirs associés sont extraits de leur contexte social et culturel et réduits à leur seule valeur technologique et marchande, au nom du progrès général de l’humanité et du développement économique des communautés locales et peuples autochtones[135]. De fait, comme nous l’avons observé plus haut, le texte de la CDB oscille entre une approche qu’on pourrait qualifier de « propriétaire » de la biodiversité,[136] en phase avec les vieux dogmes du développement[137] qui imputent les carences dans la gestion de l’environnement à des conditions de sous-développement[138], et une approche plus moderne, « d’intendance » (« stewardship »)[139], qui valorise le rôle de « gardien » des populations locales et s’efforce d’élaborer un cadre de protection intégrée de leurs modes de vie, terres, territoires, ressources, culture, institutions et coutumes.
30.— À peu près à la même période, on voit aussi évoluer les soubassements philosophiques des instruments et politiques en matière d’aires protégées et espaces naturels protégés. À la faveur, là encore, d’une réévaluation des rapports humains-nature, les communautés locales et peuples autochtones, jusque-là chassés de ces espaces de nature « pristine », sont de nouveau admis, même s’il est vrai, dans un premier temps, par simple tolérance et à condition que leurs activités soient compatibles avec les activités de conservation[140]. On voit pareillement des changements s’opérer dans les catégories de l’Union internationale pour la conservation de la nature qui établit, dès 1994, 6 catégories d’aires protégées, et qui reconnaît l’installation des peuples autochtones et communautés locales, y compris dans la catégorie la plus stricte, celle de « Réserve naturelle intégrale » (en anglais : « strict nature reserve »). Le texte tolère, en effet, a contrario, la présence d’humains « non modernes » (!)[141].
31.— Les instruments internationaux adoptés depuis le début du nouveau millénaire reprennent aussi largement à leur compte, et même intensifient, les liens entre les modes de vie et pratiques des populations locales et l’intendance de la nature. Ainsi du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPAA), adopté en 2004 dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)[142], dont le préambule reconnaît « les contributions passées, présentes et futures des agriculteurs de toutes les régions du monde, notamment de ceux vivant dans les centres d’origine et de diversité, à la conservation, l’amélioration et la mise à disposition de ces ressources », qui sont « le fondement des Droits des agriculteurs »[143]. Les « Droits des agriculteurs », catégorie nouvelle de droits que vient consacrer le TIRPAA, sont particulièrement importants dans la genèse des droits bioculturels, parce qu’ils sont justement destinés à maintenir le rôle multimillénaire des agriculteurs dans la conservation, l’amélioration et la mise à disposition des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (RPGAA)[144]. Leur finalité était bien exprimée dès la Résolution 5/89 de la FAO[145] qui précède le TIRPAA de quelques années : ces droits visent à « aider les agriculteurs et les communautés agricoles de toutes les régions du monde, et spécialement ceux des lieux d’origine et de diversité des ressources phytogénétiques, à protéger et conserver ces ressources et la biosphère naturelle »[146]. C’est l’article 9 du TIRPAA qui décrit, de manière indicative, le contenu du « faisceau » possible de droits en faveur des agriculteurs et des communautés locales et autochtones, après un rappel appuyé « de l’énorme contribution que les communautés locales et autochtones ainsi que les agriculteurs de toutes les régions du monde, et spécialement ceux des centres d’origine et de diversité des plantes cultivées, ont apportée et continueront d’apporter à la conservation et à la mise en valeur des ressources phytogénétiques qui constituent la base de la production alimentaire et agricole dans le monde entier »[147]. Les dispositions pertinentes de l’article 9.2 sont singulièrement affaiblies par l’emploi du conditionnel et la multiplication de formules restrictives (« En fonction de ses besoins et priorités, chaque Partie contractante devrait, selon qu’il convient et sous réserve de la législation nationale, prendre des mesures »), mais la liste de mesures possibles souligne bien le rôle d’intendant que le TIRPAA reconnaît et entend faire jouer aux populations locales et aux agriculteurs. Il en est ainsi de « [l]a protection des connaissances traditionnelles présentant un intérêt pour les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture »[148] ou du « droit de conserver, d’utiliser, d’échanger et de vendre des semences de ferme ou du matériel de multiplication »[149].
32.— Le dernier texte que l’on évoquera de manière détaillée dans ces lignes représente sans doute le jalon le plus important dans la genèse des droits bioculturels. Il s’agit du Protocole de Nagoya sur l’accès et le partage des avantages, adopté le 20 octobre 2010 à Nagoya, au Japon[150]. Mais il faut d’emblée en souligner la double spécificité au regard de la question de l’intendance de la nature et des droits bioculturels. Tout d’abord, il s’agit d’un protocole à la CDB, qui en reprend donc les fondements contrastés, tout en poussant en l’occurrence plus loin l’inspiration bioculturelle. Ensuite, compte tenu du rôle joué par Sanjay Kabir Bavikatte et Natural Justice dans les négociations qui ont conduit à l’adoption du Protocole[151], il n’est guère surprenant que les références à l’intendance au stewardship y soit plus marquées[152], singulièrement à travers l’inclusion des « protocoles bioculturels communautaires », que l’instrument appelle « protocoles communautaires »[153] , et qui sont toujours un cheval de bataille de l’ONG sud-africaine. Dans ce nouveau cadre approfondi, on peut désormais dire que les peuples autochtones et communautés locales – « historiquement les principaux acteurs impliqués dans les semences de ferme, la sélection massale et le développement de techniques destinés à conserver et maintenir les cultures et les variétés »[154] –, ont droit à un partage juste et équitable des bénéfices qui sont issus de l’utilisation de leurs ressources génétiques et savoirs traditionnels associés, le droit au consentement préalable donné en connaissance de cause, le droit de négocier des conditions convenues d’un commun accord, et le droit à l’utilisation coutumière ou à l’échange de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées (que ce soit à l’intérieur de la communauté ou entre communautés)[155]. Si les États ont toujours des droits souverains sur les ressources présentes sur leur territoire[156], ils ont en revanche des devoirs plus fermes à l’égard des peuples autochtones et communautés locales. Bien que des différences subsistent selon que l’accès porte sur les savoirs traditionnels[157] ou les ressources génétiques[158], le Protocole de Nagoya[159], qui reconnaît d’ailleurs le « lien d’interdépendance »[160] entre les deux, va dans le sens de la reconnaissance généralisée de procédures locales d’Accès et de Partage des Avantages (APA) garantissant le consentement préalable donné en connaissance de cause des communautés (ou leurs accord et participation) et un partage juste et équitable des avantages qui en résultent[161]. De manière plus générale, le Protocole s’efforce d’appréhender et de protéger de manière intégrée ceux qu’il appelle les « gardiens de la diversité biologique »[162] en demandant aux États, tout du moins en ce qui concerne les obligations du Protocole qui portent sur les connaissances traditionnelles, de tenir compte du droit coutumier, et le cas échéant des protocoles bioculturels et procédures locales d’accès qu’ils doivent d’ailleurs s’efforcer d’appuyer[163]. Remarquons également que, lors de la COP 10, qui a conduit au Protocole de Nagoya, les Parties ont également adopté le Code de conduite éthique Tkarihwaié:ri destiné à assurer le respect plus large du patrimoine culturel et intellectuel des communautés autochtones et locales[164]. Bien que purement volontaire[165], ce Code de conduite éthique montre mieux encore la diffusion du concept d’intendance de la nature et la compréhension de la nécessité de garantir, sans fragmentation, le « droit des communautés autochtones et locales de jouir de leur patrimoine culturel et intellectuel, notamment les connaissances, les innovations et les pratiques traditionnelles »[166] . Avec plus de netteté encore que le Protocole, le texte rompt ici avec la tendance, perceptible dans la CDB, à saisir les connaissances traditionnelles comme de pures informations détachées du système de valeurs dans lesquelles elles sont forgées et prennent sens[167]. La définition de ce que le Code appelle l’« Intendance/garde traditionnelle » finit de convaincre de la reconnaissance internationale du rôle des populations locales dans la protection de la nature et surtout du fait que cette protection dépend d’un lien particulier entre humains et écosystèmes, d’un réseau complexe de droits et d’obligations que médiatisent institutions traditionnelles, croyances spirituelles et pratiques coutumières. Comme l’énonce le texte :
L’intendance/garde traditionnelle reconnaît le lien d’interdépendance holistique entre l’humanité et les écosystèmes, ainsi que les obligations et les responsabilités des communautés autochtones et locales de protéger et de conserver leur rôle traditionnel d’intendants et de gardiens de ces écosystèmes par le maintien de leur culture, de leurs croyances spirituelles et de leurs pratiques coutumières. Par conséquent, la diversité culturelle, y compris la diversité linguistique, est essentielle à la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique[168].
Retour en haut
2) Fondements jurisprudentiels
33.— Ce lien « d’intendance traditionnelle » est aussi aujourd’hui perceptible avec plus ou moins de netteté dans la jurisprudence des organes juridictionnels et quasi-juridictionnels de protection des droits de l’homme, à l’échelle internationale, mais surtout à l’échelle régionale. C’est à l’étude de cette riche matière, qu’éclairent aussi les avis et recommandations des organes de contrôle des droits de l’homme, que Kabir Bavikatte a consacré une large partie de son attention[169], venant ainsi confirmer les liens entre populations locales et gestion durable de la nature que la lecture attentive des instruments internationaux avait permis de dévoiler. Il serait inutile et fastidieux de parcourir une nouvelle fois les chemins tracés par le juriste et activiste sud-africain. On peut en revanche, avec intérêt, insister sur les affaires les plus marquantes et porter un regard insistant sur les développements récents de l’intendance de la nature et même des droits bioculturels dans quelques jurisprudences nationales. On laisse pour l’instant de côté la jurisprudence internationale et régionale, d’ailleurs assez abondante, qui a permis dans certains cas de conférer aux communautés locales le statut protecteur des peuples autochtones[170] ; on n’aborde pas non plus la jurisprudence qui inclut à la culture les modes de vie, les systèmes économiques et les rapports à la terre et au territoire[171].
34.— Une attention particulière doit être portée à l’affaire Endorois Welfare Council v. Kenya, jugée par la Commission Africaine des droits de l’homme et des peuples, et à laquelle Kabir Bavikatte a consacré des développement substantiels[172]. C’est probablement celle qui, parmi l’abondante jurisprudence régionale citée par l’auteur, marque le mieux la reconnaissance de l’activité d’intendance traditionnelle. Les Endorois sont un peuple autochtone d’environ 60 000 membres aux modes de vie traditionnels, et qui occupent la vallée du Rift au Kenya. Ils vivent essentiellement de pastoralisme et de transhumance. En 1978, le gouvernement du Kenya déclarait les terres ancestrales autour de la région du lac Bogoria « Réserve Faunique du Lac Bogoria » et évinçait les Endorois sans consultation préalable. Tout au plus le gouvernement leur promettait-il une compensation pour l’éviction, un partage des revenus découlant de l’exploitation de la réserve de chasse et la distribution des nouvelles terres. Ainsi déplacés et interdits d’accès à leurs terres ancestrales, la communauté autochtone perdait l’accès à des ressources économiques vitales (pierres à lécher, sols fertiles, herbes traditionnelles et eaux non polluées des lacs de la région) pour l’entretien de leur bétail et leur propre subsistance. Leurs pratiques religieuses et traditionnelles se trouvaient également profondément affectées par la privation d’accès à des sites religieux (pour la pratique de la circoncision) ou servant à la pratique de cérémonies culturelles. À partir des années 2000, un certain nombre de terres ancestrales furent délimitées et vendues à des tiers, et en 2002 une concession aurifère était accordée à une entreprise privée, créant ainsi un risque de pollution des eaux. En 2003, seules de très faibles compensations monétaires pouvaient être constatées, et les Endorois n’intervenaient toujours pas dans la gestion de la réserve faunique.
35.— Saisie en 2003, la Commission a d’abord reconnu la qualité de « peuples autochtones » aux Endorois. S’appuyant expressément sur un rapport du Groupe de travail d’experts sur les populations/communautés autochtones[173], elle en a repris les quatre critères dégagés pour identifier les peuples autochtones, à savoir l’occupation et l’usage d’un territoire particulier ; la perpétuation volontaire d’une singularité culturelle ; l’auto-identification en tant que collectivité distincte, elle-même reconnue par d’autres groupes ; une histoire marquée par l’assujettissement, la marginalisation, la dépossession, l’exclusion ou la discrimination[174]. La Commission a également souligné que, d’après le Groupe de travail d’experts, les chasseurs-cueilleurs et les bergers sont typiquement autochtones en Afrique, car la « survie de leur mode de vie particulier dépend des droits sur leurs terres traditionnelles et les ressources naturelles qui s’y trouvent »[175]. La Commission a également puisé dans la définition des peuples autochtones donnée par la Groupe de travail des Nations Unies sur les peuples autochtones, réinterprétée à la lueur des travaux du Groupe de travail d’experts sur les populations/communautés[176]. Elle n’a pas non plus hésité à utiliser les ressources de la Convention n° 169 de l’OIT, tout en notant que beaucoup d’États africains ne sont pas parties à l’instrument international. C’est que l’instrument exprime, selon la Commission, le « dénominateur commun » à toutes les tentatives visant à saisir les caractéristiques des peuples autochtones : les « peuples autochtones ont un lien manifeste avec un territoire distinct » et il existe par ailleurs des « liens entre un peuple, sa terre et sa culture »[177]. Plus loin, la Commission a aussi souligné la nécessité d’une auto-identification collective comme « critère clé pour déterminer qui est effectivement autochtone »[178]. Un ensemble d’éléments qui, en tout cas, dans le cadre d’un « consensus naissant » sur les traits objectifs, doivent être réunis par un collectif d’individus pour être considéré comme un peuple, et que l’on peut résumer comme suit : « une tradition historique commune, une identité raciale ou ethnique, une homogénéité culturelle, une unité linguistique, des affinités religieuses et idéologiques, une liaison territoriale, et une vie économique ou d’autres liens, identités ou affinités dont ils jouissent collectivement – en particulier les droits énoncés aux termes des articles 19 et 24 de la Charte africaine – ou souffrent collectivement de la dénégation de ces droits »[179]. La Commission a estimé que, en l’occurrence, de tels critères étaient réunis pour les Endorois[180]. Interrogée sur la violation du droit de propriété au sens de l’article 14 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la Commission a reconnu que le peuple évincé avait « un droit de propriété en ce qui concerne leurs terres ancestrales, les possessions qui y sont rattachées et leurs animaux »[181]. Ce droit comprend « non seulement le droit d’avoir accès à sa propriété » et le droit « d’empêcher l’invasion et l’empiètement de ladite propriété », mais encore, note la Commission, le droit à « une possession, et une utilisation ainsi qu’un contrôle en toute tranquillité de cette propriété »[182]. Tout en reconnaissant, comme le prévoit l’article 14 de la Charte, qu’une atteinte puisse être portée à la propriété « par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité », la Commission notait toutefois le caractère plus rigoureux du contrôle du critère « d’utilité publique » en cas d’empiètement des terres autochtones[183]. La terre ancestrale représentant, en l’espèce, pour le peuple Endorois, un enjeu de survie culturelle[184], on comprend que seules des circonstances exceptionnelles d’utilité publique, l’absence de mesures moins restrictives et la prévision d’une compensation auraient pu justifier l’éviction[185].
36.— Tout l’intérêt de la décision réside également dans la réfutation de l’argument de l’État défendeur, d’après lequel la constitution de la réserve visait avant tout à assurer une bonne gestion et une bonne conservation de la faune[186]. Or, comme l’énonce la Commission, « les Endorois – en tant que dépositaires ancestraux de la terre [dans la version anglaise : ancestral guardians of that land][187] – sont mieux équipés pour préserver ses écosystèmes délicats » ; ils sont d’ailleurs prêts, ajoute-t-elle, « à poursuivre l’effort de conservation entrepris par le Gouvernement »[188]. Pour Kabir Bavikatte, la Commission reconnaissait expressément dans ce passage, en soulignant le lien indéfectible entre le peuple Endorois et sa terre, le « duty of stewardship »[189] qu’il place au centre des droits bioculturels. Comme le note l’auteur, cette qualité de « dépositaires ancestraux/ancestral guardians » n’a pas permis, à elle seule, à fonder le « droit collectif de propriété » des Endorois sur leurs terres ancestrales. La Commission s’est aussi largement appuyée sur la relation culturelle, spirituelle et même holistique du peuple à sa terre[190]. Il considère néanmoins que, la preuve eût-elle été rapportée de pratiques destructives de la part de la communauté, la Commission aurait vraisemblablement retenu une compensation, plutôt qu’un ordre de restitution de la terre[191].
37.— La fin du raisonnement n’emportera pas totalement la conviction. Comme on le verra en détail plus loin, les droits sur la terre, les territoires et les ressources – qui ne sont pas nécessairement des droits de pleine propriété[192] – sont attachés en droit international à la qualification de « peuple autochtone » et, dans certains cas, à celle de « communauté locale ». Surtout, comme le montre un récent et très important arrêt rendu par la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples dans l’affaire Ogiek[193], si les pratiques éventuellement non durables doivent être prises en compte, c’est vraisemblablement au stade de l’appréciation de la « nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité » et de la proportionnalité de l’atteinte qui est portée au droit de propriété de la communauté. Cette affaire apporte d’autres enseignements. Il y était question des Ogiek, l’un des derniers groupes de chasseurs-cueilleurs d’Afrique de l’Est et habitants traditionnels de la forêt de Mau, en l’occurrence évincés de leurs terres traditionnelles par le gouvernement kenyan. La Cour a jugé que l’État défendeur n’avait « fourni aucune preuve de nature à établir que la présence continue des Ogiek dans la zone est la cause principale de l’épuisement des ressources de ladite zone ». Au contraire, « [d]ifférents rapports préparés par le défendeur ou en collaboration avec lui sur l’état de la forêt Mau révèlent également que les causes principales des dégradations environnementales sont le fait d’empiètement sur la terre imputables à d’autres groupes ou à des reclassements en terres habitables ou des concessions minières inopportunes accordés par le gouvernement ». Dans ses conclusions, relève également la Cour, le défendeur admet aussi que « la dégradation de la forêt Mau n’est pas entièrement imputable ou ne peut être imputée au peuple Ogiek ». Dans ces circonstances, la Cour a pu juger que « […] le refus continu de l’accès à la forêt Mau et l’éviction de la population Ogiek de celle-ci ne peuvent être nécessaires ou proportionnés pour atteindre la justification avancée de préservation de l’écosystème nature de la forêt Mau »[194].
38.— Autre décision intéressante, également mise en lumière par Kabir Bavikatte, l’affaire Niyamgiri jugée par la Cour Suprême Indienne en 2013[195]. Les faits sont passablement compliqués, mais peuvent être ramenés à quelques données simples : depuis le début des années 2000, l’entreprise Vedanta Aluminium Ltd, une filiale de Vedanta Resources PLC, cherchait à obtenir une autorisation pour ouvrir une mine de bauxite dans la zone appelée Niyamgiri Hill, qui s’étire entre les districts de Kalahandi et Rayahada – qui font partie de l’État d’Orissa (dans l’est de l’Inde). Il s’agit d’une zone particulièrement précieuse, qui abrite une forêt très riche en biodiversité et hébergeant plusieurs espèces en danger qui apparaissent sur la Liste Rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature. La forêt est également la principale source de subsistance des tribus Dongaria Kondh et Kutia Kondh (para. 9 & 14), qui sont toutes deux des « Scheduled Tribes », i.e. des tribus répertoriées au sens du droit indien et qui, comme on le verra, bénéficient d’une protection spéciale. Pour ces tribus, les forêts sont, du reste, sacrées, puisqu’elles sont regardées comme étant habitées par la déité Niyam Raja, et elles perçoivent leur conservation comme étant essentielle à leur survie en tant que communautés. On sait aussi que la préservation remarquable de la forêt est due au bannissement de l’abattage des arbres par la communauté[196].
Afin de mener à bien le projet, une entité ad hoc était créée entre Vedanta Aluminium, d’une part, et l’État d’Orissa et Orissa Mining Corp. (une entreprise publique), d’autre part. Dans la mesure où le projet supposait le changement d’affectation des terres forestières pour un usage non forestier, une autorisation devait être obtenue auprès du Central Empowered Committee (CEC), un organe constitué par la Cour Suprême pour traiter les demandes de changement d’affectation[197]. Dans son rapport de 2005, soulignant un certain nombre d’illégalités commises par l’entreprise, dont la soumission d’informations inexactes, le commencement des travaux avant même l’obtention de l’autorisation et la violation de dispositions du Forest Conservation Act, 1980, le CEC recommandait de ne pas accorder la conversion pour la conduite du projet[198]. Saisi pour avis, et en dépit de ces illégalités, le Forest Advisory Committee (FAC) du Ministère de l’Environnement et des Forêts (MoEF) recommandait une approbation de « principe » pour les activités extractives, sous quelques réserves liées aux pratiques d’abattage des arbres. Il est à noter que, durant ce processus, les droits coutumiers des Adivasis (un terme indien utilisé pour désigner les peuples autochtones ou tribaux) sur leurs terres et sur leurs lieux de culte ne furent à un aucun moment pris en cause, ce qui constituait une violation flagrante du Scheduled Tribes and Other Traditional Forests Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act de 2006 (encore appelé Forest Rights Act ou FRA), un texte qui reconnaît les droits coutumiers des groupes tribaux comme les Kondh[199]. En 2007, la Cour Suprême d’Inde rendait deux ordonnances autorisant le changement d’affectation des terres forestières, mais obligeant aussi Vedanta à adopter un ensemble de mesures compensatoires (« rehabilitation package ») incluant le reversement d’un pourcentage de ses profits pour financer un plan de développement pour la région[200]. À la suite de ces deux ordonnances, le MoEF accordait donc une autorisation « de principe » au projet.
39.— En 2009, enfin, le gouvernement de l’État d’Orissa introduisait à son tour une demande afin d’obtenir l’approbation définitive du projet. C’est à ce moment-là seulement que les droits des Kondh, dont la situation avait entretemps commencé à recevoir une plus large attention nationale et internationale, furent placés au centre du débat. Comme la question était largement controversée au sein du MoEF, un comité présidé par Naresh C. Saxena fut designé. Le « Saxena Committee » releva un grand nombre de risques et d’illégalités. Outre le défaut de consultation des tribus Dongaria Kondh et Kutia Kondh, le comité déplorait les conséquences préjudiciables du projet d’extraction sur les sentiments religieux des tribus, tout en relevant de nombreuses contraventions of FRA, ainsi qu’au Forest Conservation Act, 1980, et à l’Environmental Protection Act, 1986.
Enfin, et surtout, le rapport dénonçait le défaut de consentement préalable des gram sabhas, les conseils de villages qui doivent normalement se prononcer en vertu du Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act (PESA), 1966, une loi à l’origine de mécanismes décentralisés de gouvernance des zones tribales[201]. Comme le MoEF décidait de suivre les résultats du rapport, il retirait en 2010 l’autorisation accordée pour le projet d’extraction minière, décision qui était attaquée devant la Cour Suprême indienne. Dans son arrêt, la Cour Suprême ordonne au gouvernement de l’État d’Orissa d’obtenir le consentement des villageois, notant en particulier que le FRA accorde au groupes tribaux primitifs (en l’occurrence les Kondh) un droit coutumier de culte dans leurs lieux sacrés. Elle relève que, tout au long du processus, ce droit coutumier n’a jamais été pris en compte, que ce soit par les autorités administratives ou par les gram sabhas[202]. La Cour Suprême commande ainsi que les procédures devant les gram sabhas soient conduites de nouveau, en présence cette fois d’une officier judiciaire ayant le rang de juge de district de manière à s’assurer de leur indépendance, tant à l’égard du gouvernement que des défenseurs du projet[203]. Pour parvenir à sa conclusion, la Cour a non seulement insisté sur la nécessité, placée au cœur du FRA, de protéger des populations qui ne connaissent suffisamment le cadre légal et ne sont pas en mesure de faire valoir leurs droits et dont le droit à la vie est très étroitement lié aux droits spéciaux qui leur sont reconnus sur les forêts, mais aussi sur la prise de conscience récente que « les forêts tirent leurs meilleures chances de survie de la participation des communautés dans les mesures de conservation et de régénération »[204].
40.— Cet arrêt constitue un moment important dans l’histoire juridique indienne, puisque c’est la première fois, comme l’observe Rajshree Chandra, que « […] the available legal vocabulary of the Forest Rights Act (FRA), 2006 had been invoked to address issues of collective, community claims, affirming a determinacy and a jurisdiction for indigeneity »[205]. C’est la première fois aussi que les dispositions relatives au « consentement communautaire » font l’objet d’une interprétation dynamique de manière à dépasser le « devoir de consultation » et à y inclure le « droit de véto et d’exclusion »[206]. La décision donne ainsi son plein effet à la loi qui reconnaît aux tribus enregistrées et autres habitants traditionnels des forêts[207], le droit de vivre dans la forêt, des droits réels sur la terre, d’utilisation des ressources forestières, d’utilisation de la biodiversité, des droits aussi sur leur patrimoine immatériel et leurs savoirs traditionnels associés à la biodiversité et la diversité culturelle[208], le droit d’être protégés contre « les pratiques destructrices affectant leurs patrimoine culturel et naturel »[209], et de « réglementer l’accès aux ressources forestières communautaires et de mettre fin à toute activité qui porte atteinte à la faune sauvage, à la forêt et à la biodiversité »[210]. Ce droit, en particulier, est intimement lié au droit reconnu aux communautés concernées de « protéger, régénérer, conserver ou gérer toutes les ressources forestières communautaires qu’ils ont traditionnellement protégées et conservées en vue d’une utilisation durable »[211]. Pour Giulia Sajeva, ce passage de la loi est important et doit être mis en rapport avec les attendus de l’arrêt qui soulignent le rôle vital des communautés dans la conservation de la forêt[212]. Il montre en creux que les communautés tirent leurs droits non pas tant de leur occupation traditionnelle de la forêt, que de leur rôle d’intendantes de la forêt qu’elles partagent avec le gram sabha et les institutions villageoises compétentes[213]. Il est d’ailleurs significatif que les dispositions de la loi relatives à la protection contre les pratiques destructrices et les activités qui portent atteinte à l’écosystème forestier sont présentées comme des « devoirs des titulaires des droits forestiers » (« 5. Duties of holders of forest rights »)[214], i.e. en somme des droits qui sont instrumentalement reconnus aux communautés pour remplir les responsabilités particulières qui pèsent sur elles.
41.— La dernière décision mérite des développements particuliers. Rendue après la parution de la thèse de Kabir Bavikatte, elle peut être lue comme la consécration de la construction de l’auteur sud-africain, la première décision, en tout cas, à reconnaître, par une motivation particulièrement exemplaire, l’existence des droits bioculturels. Il s’agit de la décision de la Cour constitutionnelle de Colombie, rendue dans l’affaire dite Tierra Digna en 2016[215], dont on a surtout retenu les attendus reconnaissant la personnalité juridique à la rivière Atrato. Sa portée est encore renforcée par la décision très récente de la Cour Suprême de Justice de Colombie, sans doute moins impressionnante que la précédente, mais qui s’y réfère toutefois longuement pour faire à son tour de l’Amazonie un « sujet de droit »[216]. Les faits de l’affaire Tierra Digna méritent d’être rapportés, même s’ils ne sont qu’un triste rappel de la lutte que les peuples autochtones et communautés locales mènent à travers le monde contre l’extractivisme, les groupes armés et la complicité ou la corruption des gouvernements. Le contentieux a pour scène le département colombien du Chocó, forêt de nuage reculée et l’une des dix « zones critiques » de biodiversité au monde. 98% du territoire fait l’objet de droits de propriété communautaire accordés à des populations autochtones, paysannes et afro-descendantes. Le département est du reste composé de 120 réserves autochtones (« Resguardos ») (i.e. des réserves autochtones) et de 70 « consejos comunitarios mayores » qui sont les organes de gouvernance des territoires communautaires de populations d’Afro-descendants. Depuis les années 1990, le territoire, riche en or et qui, du fait de sa position géographique, est stratégique pour le trafic de drogues et l’importation illicite d’armes, est devenu un nouvel Eldorado pour les groupes armés, les paramilitaires et les mineurs venus du Brésil qui luttent pour son contrôle. Les excavatrices mécaniques, les bulldozers et les « dragons », ces plateformes d’extraction positionnées sur les rivières, font partie de l’environnement délétère des communautés riveraines qui, en plus de connaître la violence, les intimidations, les couvre-feux et les activités souterraines, sont victimes de la déforestation et de la contamination des eaux par les résidus de mercure utilisé dans les activités d’orpaillage[217]. La situation a d’ailleurs probablement été aggravée par la signature de l’Accord de Paix signé avec les FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en 2016. Le retrait des FARC a laissé un vide qui est aujourd’hui rempli par l’Ejército de Liberacion Nacional (ELN), le groupe de guérilleros le plus important après les FARC, et des paramilitaires pour obtenir le contrôle du territoire[218].
42.—Pour tenter de faire cesser les atteintes portées à l’environnement, l’association représentative des conseils communautaires de Bajo Atrato, (Associacion de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato (ASOCOBAR)) a demandé à l’ONG Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna (Tierra Digna), spécialisée dans la défense des populations locales contre les activités extractives, d’introduire une Tutela, au nom des communautés vivant sur les rives de l’Atrato et ses territoires voisins, contre plusieurs agences du gouvernement colombien afin d’obtenir la protection effective de leurs droits fondamentaux garantis par la Constitution et dont ils se plaignaient de la violation par les opérations minières. La Tutela est un recours d’Amparo qui permet à toute personne de saisir n’importe quel juge du pays afin qu’il se prononce sur la violation de ses droits fondamentaux protégés par la Constitution[219]. Il s’agit normalement d’une action individuelle, puisqu’elle vise à protéger l’individu comme l’énonce l’article 86 de la Constitution de 1991 et non un collectif organisé ou une communauté. Il n’en demeure pas moins que, en l’espèce, la Cour constitutionnelle a déclaré recevable la demande introduite par le groupe de communautés et a reconnu d’un même mouvement l’interdépendance entre les droits environnementaux et les droits fondamentaux. Sur le fond, les communautés arguaient de ce que les contaminations produites par les activités extractives illégales avaient eu un effet direct sur la santé des membres des communautés, ainsi que d’autres effets indirects sur le bien-être humain. Les demandeurs invoquaient en particulier la réduction des produits forestiers, mettant en péril leur sécurité alimentaire et leur médecine traditionnelle, entraînant aussi des changements dans les pratiques et usages traditionnels, ainsi que dans les coutumes des communautés ethniques, notamment en raison de l’impact de ces activités sur la biodiversité. Ils concluaient que, ayant été incapables de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme aux activités extractives illégales, les autorités n’avaient pas rempli leurs obligations constitutionnelles positives, avec pour conséquence une crise environnementale et humanitaire sans précédent.
43.— Nous n’avons pas la place de détailler ici tout le cheminement de la procédure[220]. Il suffira de noter que la Cour Constitutionnelle a finalement admis le recours d’Amparo et, après avoir consulté nombre d’experts, réalisé une descente sur les lieux, mené plusieurs auditions et organisé une assemblée locale avec toutes les communautés impliquées, a rendu une décision, qu’on peut juger historique, le 10 novembre 2016, en promouvant une approche écocentrique des droits humains, reconnaissant la personnalité juridique à la rivière Atrato et lui accordant des droits environnementaux devant être protégés au même titre que les droits bioculturels des communautés. C’est ce dernier volet de la décision, consacré à la protection des communautés, qu’il faut explorer, étant précisé que la Cour constitutionnelle mobilise également longuement les droits bioculturels dans les paragraphes afférents à la personnalité juridique de la rivière Atrato[221]. Selon la Cour, les droits bioculturels sont les « droits des communautés ethniques d’administrer et d’exercer une tutelle <tutela> autonome sur leurs territoires – conformément à leurs propres lois, coutumes – et sur les ressources naturelles qui constituent leur habitat, où leur culture, leurs traditions et leur mode de vie sont développés sur la base de la relation spéciale qu’elles entretiennent avec l’environnement et la biodiversité »[222]. La tutelle ou garde fait écho à l’éthique de stewardship que la Cour fonde en l’occurrence sur un territoire particulier, substrat d’un rapport d’attachement particulier, lui-même à l’origine d’une culture, de traditions et d’un mode de vie singuliers. Comme elle le précisera plus tard en examinant le statut de la rivière, le concept-clé reste celui de « diversité bioculturelle » qui, par son inspiration écocentrique, permet de reconnaître l’interdépendance entre la culture et la nature[223], telle qu’elle existe notamment chez les peuples autochtones et les communautés locales. Du fait de cette interrelation profonde, « la conservation de la biodiversité conduit nécessairement à la préservation et à la protection des modes de vie et des cultures qui interagissent avec elle ». Mais cela fonctionne également en sens inverse : « la protection et la conservation de la diversité culturelle sont essentielles à la conservation et l’exploitation durable de la biodiversité »[224]. Les droits bioculturels, dit la Cour, se signalent surtout par la manière dont ils permettent de préserver les communautés pour lesquelles cette interdépendance est inscrite dans le mode de vie et les cosmovisions. Ces droits visent, en effet, à « protéger dans une seule clause de protection les dispositions éparses sur les droits aux ressources naturelles et à la culture des communautés ethniques » que l’on trouve dans la Constitution[225]. Se référant ici expressément aux travaux de Kabir Bavikatte, la Haute juridiction note que les droits bioculturels ne forment pas une nouvelle catégorie de droits : « il s’agit plutôt d’une catégorie spéciale qui unifie leurs droits aux ressources naturelles et à la culture, les considérant comme intégrés et interdépendants »[226].
44.— Quant aux traits caractéristiques des droits bioculturels, la Cour en voit au moins deux, en plus du concept de bioculturalité qui nécessite, encore une fois, d’appréhender comme un tout indissociable ressources biologiques et l’ensemble des traditions culturelles et spirituelles, des usages et des coutumes des peuples[227]. Premièrement, parce qu’ils sont aussi fondés sur les expériences concrètes des peuples autochtones et communautés locales, en particulier leur expérience multiséculaire de la marginalisation et de l’oppression, ils permettent de porter un regard critique sur les politiques de développement et sur le système actuel, en l’orientant vers la préservation de la diversité bioculturelle notamment pour les générations futures. En d’autres termes, les droits bioculturels ont aussi une puissance heuristique et permettent de corriger les biais de politiques publiques de développement et de conservation[228]. Deuxièmement, les droits bioculturels mettent en lumière une forme de singularité « exemplaire » qui a valeur pour l’humanité tout entière[229]. Pour le dire autrement, les droits bioculturels ont une prétention à l’universalité en montrant ce qui, chez les peuples autochtones et locales, peut servir de modèle global dans une approche contre-hégémonique. C’est ce que le sociologue Boaventura de Sousa Santos a appelé le « subaltern cosmopolitanism »[230] (ou « cosmopolitan legality »), un « cosmopolitisme insurgé subalterne » qui n’est pas synonyme d’uniformité, mais prétend montrer ce que les expériences et identités locales, dans toute leur diversité, peuvent offrir de ressources pour sortir de l’ornière du système juridique dominant[231].
45.— Central dans le « paradigme des droits bioculturels », observe la Cour, est le concept de « communauté ou de collectif », qu’il faut comprendre comme incluant les communautés autochtones, ethniques, tribales et traditionnelles (« comunidades indígenas, étnicas, tribales y tradicionales »). Elles sont définies par des modes de vie principalement « “basés sur le territoire et qui ont des liens culturels et spirituels étroits avec leurs terres et ressources traditionnelles. Bien que les communautés soient qualifiées selon diverses catégories, dont l’ethnicité, les ressources partagées, les intérêts communs et la structure politique, le terme de communauté est utilisé ici pour désigner les groupes de personnes dont le mode de vie est déterminé par leur écosystème” »[232]. Ce passage, qui est une citation de Kabir Bavikatte et Tom Bennett[233], et dont elle vient appuyer la référence au « mode de vie », met en lumière que, pour la Cour constitutionnelle, les droits bioculturels sont fondés sur un certain mode de vie favorable à la conservation et à l’utilisation durable de la biodiversité. Ces droits sont destinés à permettre le maintien de ce mode de vie, en particulier le lien aux terres et territoires, ainsi qu’à l’écosystème. Tout comme chez Kabir Bavikatte, les droits sont associés moins à la protection des populations locales pour elles-mêmes, qu’à la préservation d’un mode vie associé à des pratiques qu’on peut qualifier de « durables »[234]. La Cour note d’ailleurs ensuite, par une formule dont il faut relever la formulation impérative, que « ces droits impliquent que les communautés doivent maintenir leur patrimoine culturel distinctif […] »[235]. La Cour paraît vouloir signifier que les droits bioculturels sont conditionnés par le type de mode de vie dont elle a offert une ébauche au même paragraphe. Cette lecture tend à être confirmée par la citation qui suit, empruntée à Kabir Bavikatte et Daniel Robinson[236], mais qui se trouve sensiblement transformée au cours de la traduction. La Cour énonce :
De tels droits “ne sont pas de simples revendications de la propriété au sens typique de l’économie ou du marché, conçue comme ressource aliénable, valorisable et négociable ; à l’inverse […] les droits bioculturels sont les droits collectifs des communautés qui assument des rôles de gestion traditionnelle en accord avec la nature, telle que les conçoivent les ontologies autochtones” ou traditionnelles[237].
46.— La citation originale est assez différente, puisque les deux auteurs notent que « [o]n the contrary biocultural assertions of property rights are property claims in the form of use, stewardship and fiduciary rights. The ‘peoplehood’ of biocultural communities is integrally linked to the rights to stewardship of their lands and concomitant traditional knowledge through a complex system of customary use rights and fiduciary duties »[238]. Il est frappant de voir la référence au stewardship muer en une formule extensive de « gestion traditionnelle en accord avec la nature, telle que les conçoivent les ontologies autochtones ou traditionnelles ». Il est aussi notable que la Cour ait pris le soin d’omettre la mention finale aux « devoirs fiduciaires » qu’elle a pourtant implicitement abordés au même paragraphe et qui restent apparemment un point nodal du paradigme des droits bioculturels. Il faudra revenir sur cette question de l’intendance et s’interroger aussi sur cette esquive des « devoirs » qui témoigne sans doute du malaise de la Cour face à ce qui pourrait s’apparenter à des responsabilités nouvelles pour des populations peu épargnées par la modernité[239]. Si devoirs il y a, pour la Cour, le débiteur en est d’abord et avant tout l’État. C’est à lui qu’incombe de préserver la profonde unité de la nature et de l’espèce humaine et d’intégrer donc, à travers ses politiques publiques, sa législation et sa jurisprudence, la nécessaire protection de la bioculturalité[240].
Retour en haut
B. Le contenu des droits bioculturels
47.— La grande spécificité des droits bioculturels est de reposer sur un double fondement, dont l’un est d’ailleurs si important qu’il est potentiellement à l’origine de devoirs nouveaux à la charge des populations locales[241]. Le premier est simple : il s’agit de conserver et promouvoir l’identité culturelle et l’autodétermination des peuples autochtones et des communautés locales, en leur garantissant des droits sur leurs terres, territoires, ressources, leur culture et leurs savoirs traditionnels. Les droits bioculturels sont, de cette manière, directement destinés à servir les intérêts des communautés et peuples concernés, ce qui est un enjeu particulièrement instant pour les peuples autochtones[242]. Le second fondement porte sur la protection de l’environnement et soulève des questions plus complexes. Si on insiste sur la force des liens établis, chez les populations locales, entre la diversité culturelle et la diversité biologique, la conservation de l’environnement n’est pertinente que tout autant qu’elle permet d’assurer la réalisation du premier fondement, à savoir l’autodétermination des communautés locales et peuples autochtones et la protection de leur identité culturelle. La jurisprudence internationale souligne d’ailleurs avec insistance la nécessité de protéger l’environnement[243] et leurs terres[244], en vue de préserver l’identité culturelle des communautés locales et des peuples autochtones.
48.— Cette lecture est cependant trop étroite, et tandis qu’elle conduit immanquablement à dissoudre le second fondement dans le premier[245], elle fait disparaître « l’éthique d’intendance » bien visible en droit international et dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle de Colombie[246]. Kabir Bavikatte l’a du reste répété à maintes reprises : « les droits bioculturels se distinguent sensiblement d’autres droits de groupes [par exemple les droits de peuples autochtones] en ce que la nature des droits qu’ils cherchent à affirmer n’est pas nécessairement fondée sur l’ethnicité, la religion ou le statut de minorités, mais plutôt sur une tradition d’intendance <stewardship> »[247] ; et ces droits « présupposent un lien explicite avec la conservation et l’usage durable de la diversité biologique »[248]. Il convient donc d’insister une nouvelle fois sur la particularité des droits bioculturels : les peuples autochtones et communautés locales se voient reconnaître un « faisceau » de droits, non pas seulement pour leur survie, leur développement et leur épanouissement (comme cela était le cas dans le modèle porté par Posey et Dutfield), mais aussi et surtout pour la survie, le développement et l’épanouissement de l’humanité (i.e. l’homme dans sa dimension transgénérationnelle incluse) ou plus largement des humains et des non-humains ensemble[249]. On peut donc dire que ces droits sont instrumentalement liés à l’objectif de conservation et d’usage durable de l’environnement, i.e. qu’ils visent à tout le moins au maintien de « l’éthique d’intendance ». Par une ellipse – dont il faudra éprouver la justesse –, on dit alors que ces droits visent à permettre aux communautés concernées de maintenir un certain mode de vie[250], un lien particulier entre humains et écosystèmes[251], ou plus simplement ils tendent à leur donner les moyens de continuer de « s’occuper de leurs terres et ressources » [252], ce qui renvoie à certaines pratiques. Enfin, dans la mesure où chaque communauté ou peuple a des besoins différents concernant les droits nécessaires pour maintenir une certaine éthique d’intendance, un mode de vie, etc., les droits bioculturels ne peuvent être théorisés comme un ensemble fixe de droits[253]. Si, toutefois, l’éthique de stewardship dépend d’un minimum de garanties juridiques portant sur la terre, la culture et les ressources, on peut postuler l’existence d’un « noyau dur » de droits dont, en plus du principe de non-discrimination et du droit au bien-être et à la santé, le droit à la terre, au territoire et aux ressources naturelles, le droit à l’autodétermination, ainsi que les droits culturels[254]. Il faut s’attarder sur chacun de ces droits, en accordant des développements spécifiques au devoir d’intendance.
1) Droit à la terre, au territoire et aux ressources naturelles
49.— Les terres, territoires et ressources des peuples autochtones sont appréhendés comme partie intégrante de leurs cultures, leur spiritualité, leurs économies et participent aussi du droit à l’autodétermination[255]. Le droit international des droits de l’homme, universel et régional, le reconnaît toujours plus nettement, et on peut même dire que se diffuse aujourd’hui l’idée que tous ces éléments touchent à l’identité même des peuples autochtones en tant que peuples[256]. Dans beaucoup de cosmovisions autochtones, le territoire est désigné « mère » (la terre-mère) dont les peuples sont issus[257]. D’un point vue simplement utilitariste et fonctionnel, terres, territoires et ressources sont le support d’activités économiques – souvent de subsistance[258] –, à la fois vitales et également nécessaires au développement social et culturel des peuples concernés[259]. L’adoption de la Convention n° 169 de l’OIT a constitué une étape fondamentale dans la reconnaissance internationale de ces droits[260]. L’article 13 impose ainsi aux États, dans l’application de la partie de la Convention relative aux terres (Partie II), de « respecter l’importance spéciale que revêt pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples intéressés la relation qu’ils entretiennent avec les terres ou territoires, ou avec les deux, selon le cas, qu’ils occupent ou utilisent d’une autre manière, et en particulier des aspects collectifs de cette relation »[261]. Le texte reconnaît également « les droits de propriété et de possession sur les terres qu’ils occupent traditionnellement », et commande que « des mesures [soient] prises dans les cas appropriés pour sauvegarder le droit des peuples intéressés d’utiliser les terres non exclusivement occupées par eux, mais auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance »[262]. Les États ont pareillement l’interdiction de déplacer les peuples autochtones des terres qu’ils occupent[263].
50.— Autre instrument juridiquement contraignant, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale[264] a pu également œuvrer à la reconnaissance des droits sur les terres, territoires et ressources naturelles ; droits auxquels le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a d’ailleurs donné une large portée dans sa Recommandation générale n° 23, demandant expressément aux États parties « de reconnaître et de protéger le droit des populations autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux et, lorsqu’ils ont été privés des terres et territoires qui, traditionnellement, leur appartenaient ou, sinon, qu’ils habitaient ou utilisaient, sans leur consentement libre et informé, de prendre des mesures pour que ces terres et ces territoires leur soient rendus »[265]. À travers la procédure de plainte individuelle, le Comité a par ailleurs développé une jurisprudence certes encore embryonnaire, mais qui lui a déjà permis d’appeler les États à reconnaître les droits des peuples autochtones sur leurs terres, territoires et ressources, n’hésitant pas à suivre les évolutions des législations internes à partir de la fin des années 1990, comme ce fut le cas au sujet de la législation australienne sur le « titre natif » (Native Title Amendment Act)[266]. Y fait écho le travail du Comité des droits de l’homme qui, bien que contraint par les faibles ressources que lui offre l’article 27 du Pacte relatif aux droits civils et politiques[267], a pu néanmoins préciser le lien, notamment pour les peuples autochtones, entre la culture et les modes de vie associés à l’utilisation des ressources naturelles[268], et inciter les États à respecter les coutumes et la culture des peuples autochtones en relation avec la terre[269] ou le droit de disposer de leur richesses et ressources naturelles et de ne pas être privés de leurs propres moyens de subsistance[270]. Il faut noter pour une conclure, une tendance qui se dessine en droit international, du moins à l’échelle régionale, qui consiste à étendre aux communautés locales le statut protecteur des peuples autochtones[271].
Retour en haut
2) Le droit à l’autodétermination
51.— Alors qu’il gagnait en visibilité internationale dans les années 1970, le mouvement en faveur des peuples autochtones a fait du droit à l’autodétermination l’étendard de sa lutte[272]. Rien d’étonnant à ce qu’il fût placé par Posey au centre des traditional resources rights[273] et qu’il se retrouve aussi dans le paradigme des droits bioculturels. La place du droit à l’autodétermination est considérable en droit international. Présent notamment dans les deux Pactes de 1966[274], il est souvent analysé comme une coutume de droit international, voire comme une norme de jus cogens[275]. Le « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » est reconnu à « tous les peuples » comme le rappellent les deux Pactes de 1966, i.e. normalement aussi aux « peuples » autochtones. C’est cette assimilation, potentiellement synonyme du droit des peuples autochtones de faire eux aussi sécession unilatérale[276], qui a pu entraver et entrave sans doute encore une plus large reconnaissance de leur droit à l’autodétermination. La Convention n° 169 de l’OIT est partiellement parvenue à surmonter la difficulté en utilisant le terme de « peuples », mais tout en précisant immédiatement par une stipulation substantielle qu’il ne peut se voir attribuer le sens et les conséquences ordinairement attachés à ce mot en droit international[277]. Or, ce compromis, qui pouvait être aisément atteint dans le contexte technique de la négociation de la Convention n° 169, s’avérait hors de portée dans le contexte pléthorique du Groupe de travail des Nations Unies[278] chargé de préparer ce qui deviendra la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones[279]. Pris entre les revendications fortes d’identité portées par les peuples autochtones et l’opposition d’un certain nombre d’États inquiets d’une reconnaissance qui pourrait signifier le droit à la sécession[280], le principal rédacteur de la Déclaration, la Professeure Daes, a privilégié une troisième voie : la reconnaissance explicite du droit à l’autodétermination pour les peuples autochtones, mais en lui donnant un sens différent, entendu comme le droit à l’autonomie et à la participation politique et, par ailleurs, intimement associé aux droits substantiels sur la terre, la culture et l’éducation[281].
52.— Pour les peuples autochtones, le droit à l’autodétermination est donc limité à ce qu’on appelle son volet « interne »[282]. Alors que dans son volet « externe »[283], le droit à l’autodétermination comprend le droit de former un nouvel État, d’en intégrer un autre ou de s’associer avec un autre État[284], il signifie, dans son volet « interne », « the right to authentic self-governement, that is, the right for a people really and freely to choose its own political and economic regime – which is much more than choosing among what is on offer perhaps from one political or economic position only. It is an ongoing right »[285]. Cette lecture est confirmée par la pratique internationale[286], par d’autres instruments internationaux et leur interprétation[287], ainsi que par les dispositions constitutionnelles d’un certain nombre d’États d’Amérique latine et d’Afrique[288]. Il ne faut pas perdre de vue que le droit à l’autodétermination est un « droit fondateur » (« foundational right »)[289], en ce sens qu’il rayonne sur d’autres droits qui lui sont intimement associés et auxquels ils donnent une cohérence. Il en est d’abord ainsi des dispositions qui concernent l’existence, ce qui inclut le droit à la vie et à l’intégrité physique et mentale, ainsi que la protection contre la destruction ou le génocide, le déplacement forcé et l’assimilation[290]. S’ajoute le droit à la non-discrimination[291], considéré comme « le minimum minimorum pour l’exercice de l’autodétermination »[292]. Le troisième niveau de droits concerne l’identité et la culture, qu’il s’agisse de son expression au quotidien, de l’usage de la langue ou de la transmission de l’identité autochtone aux générations futures à travers l’éducation[293]. Ces droits sont partagés avec les minorités, mais on dit qu’ils sont plus extensifs pour les peuples autochtones, puisqu’ils sont destinés à réparer une longue histoire d’assimilation[294]. Enfin, les peuples autochtones disposent de droits dits « spéciaux » qui reflètent l’identification du peuple autochtone avec la terre qu’il habite traditionnellement[295].
53.— Le cœur de l’autodétermination (« interne ») est constitué du droit à l’autonomie, le droit à s’administrer soi-même (« autonomy », « self-government »), et du droit à la participation politique. La plupart des États ont adopté dans leur droit national des dispositions reconnaissant le droit d’autodétermination des peuples autochtones[296]. Mais comme l’observe Marc Weller, on ne peut inférer de ces pratiques nationales la reconnaissance, par les États, d’une coutume internationale[297]. Si la Déclaration sur les droits des peuples autochtones a été adoptée par une majorité de 143 États[298], il s’agit d’un instrument juridique non contraignant. Quant à la Convention n° 169 de l’OIT, qui est juridiquement contraignante, elle n’a été ratifiée que par 22 États seulement[299]. Au-delà, il est assez difficile de définir les contours précis du droit à l’autodétermination, que ce soit à partir d’autres instruments internationaux ou de la pratique des États qui reste assez variable[300]. L’article 5 de la Déclaration reste le texte le plus précis qui établit, on l’a dit, le principe général d’autonomie (i.e. le droit de se donner des normes)[301] à travers des institutions propres (ce que l’on retrouve également dans les articles 20, 33(2) et 34), ainsi que le droit de participer plus largement à la vie publique au sein de l’État. Au niveau universel, l’article 27 du Pacte relatif aux droits civils et politiques ne fait pas référence à l’autonomie. La Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques proclame au mieux les droits des personnes appartenant à des minorités de participer effectivement à la vie culturelle, religieuse, sociale, économique et publique[302], bien que le commentaire faisant autorité identifie l’autonomie comme l’un des moyens pour assurer la participation effective en relation avec les régions où les minorités vivent[303]. Les instruments régionaux restent également assez vagues[304]. On peut toutefois convenir avec Anaya[305] que :
Many indigenous communities have retained de facto their own institutions of autonomous governance, which are at least partly rooted in historical patterns of social and political interaction and control. These systems often include customary or written laws as well as dispute resolution and adjudicative mechanisms developed over centuries. For some indigenous groups, such as Indian tribes within the United States, such autonomous institutions have also existed de jure within legal systems of the states within which they live. Pursuant to precepts of constitutive selfdetermination, any diminishment in the authority or altering of de facto or de jure indigenous institutions of autonomous governance should not occur unless pursuant to the wishes of the affected groups. To the contrary, states are enjoined to uphold the existence and free development of indigenous institutions[306].
Par ailleurs, indépendamment du fait qu’ils aient ou non développé des institutions autonomes, le droit à l’autodétermination les autoriserait aussi à développer des mécanismes de gouvernance adaptés à leurs circonstances et nécessaires pour maintenir leur identité[307]. Ces deux aspects trouvent un soutien dans la jurisprudence des organes de surveillance des traités relatifs aux droits de l’homme et aux peuples autochtones[308]
54.— Au-delà, les peuples autochtones ont un droit à la participation qui reste également assez peu développé. La Déclaration sur les droits des peuples autochtones évoque le droit de participer à la vie politique, en particulier en ce qui concerne des questions les concernant, mais sans évoquer une représentation directe dans les principales instances de décision de l’État, ou même un pouvoir de codécision ou, à tout le moins, une procédure de consultation obligatoire. Sur ces différents aspects, la doctrine a remarqué combien le texte final était en retrait par rapport aux versions antérieures ou propositions qui ont pu être formulées au sein de Groupe de travail[309]. L’article 19 semble aller un peu plus loin en ce qui concerne l’adoption et l’application, par l’État, de mesures législatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, puisqu’il requiert leur « consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause »[310]. On peut sans doute y voir l’expression d’un pouvoir de codécision ou de véto[311], même s’il faut admettre que la finale n’est pas totalement en phase avec le début de l’article qui vise la « concertation » et la « coopération »[312].
55.— Au vu de ce qui précède, il ne sera peut-être si étonnant de constater une absence presque complète de reconnaissance internationale du droit à l’autonomie des populations locales qui n’ont pas le statut de peuple autochtone. Il est sans doute vrai que, en ce qui concerne par exemple l’auto-gouvernance et l’autonomie territoriale, les communautés locales n’ont pas les mêmes attentes que les peuples autochtones. On retrouve, en quelque sorte, le même écart qu’entre les aspirations des minorités, d’une part, et celles des peuples autochtones, de l’autre. Alors que pour les seconds l’enjeu est de disposer d’une véritable autonomie institutionnelle et normale sur le territoire de l’État qu’il habite, pour les minorités il s’agit de ménager « un espace pour le pluralisme dans l’unité »[313]. De la même manière, les peuples autochtones portent souvent des revendications plus radicales qui touchent à la souveraineté de l’État et cherchent à obtenir le rétablissement de droits qui sont vus comme antérieurs à l’installation des autorités coloniales[314]. À l’inverse, nul ne peut aujourd’hui contester la superposition assez fréquente entre les demandes des peuples autochtones et celles des communautés locales, qu’il s’agisse de l’autonomie ou du droit de se gouverner soi-même, du contrôle des terres et territoires ancestraux ou de droits reconnus au groupe. Un faisceau convergent de preuves montrent d’ailleurs à quel point les institutions locales traditionnelles, par lesquelles les populations locales fixent les règles d’accès aux terres et de prélèvement des ressources naturelles, sont les premiers instruments qui permettent d’exprimer et de satisfaire les besoins, préoccupations et intérêts des peuples et communautés[315]. Ces institutions sont plus largement fondamentales pour assurer la préservation des savoirs traditionnels, des valeurs, ainsi que des règles coutumières, et permettent aussi la transmission intergénérationnelle du langage et de la culture, jouant ainsi un rôle de conservation et de renforcement des pratiques culturelles et spirituelles et des croyances qui sont pertinentes pour la protection de l’environnement local[316]. Pour beaucoup de chercheurs, qui rejoignent ici les enseignements des organisations internationales de conservation, un certain degré d’autodétermination et de contrôle sur les ressources naturelles et la terre sont nécessaires pour permettre la survie et l’épanouissement aussi bien des peuples autochtones que des communautés locales[317]. Cette autonomie est, du reste, jugée déterminante du point de vue du rôle d’intendance de la nature des communautés locales. Lee Breckenridge note que :
From the paradigmatic “environmental” perspective, the autonomy and rights to self-management of local communities are important means for achieving global ecological goals. Shifting power to local communities is a way of fostering biological diversity by placing resources in the hands of people who are particularly knowledgeable about, and interested in, the preservation of their environment, and by taking control away from those who have profited, at the expense of local and global interests, from over-exploitation. This perspective takes a predominantly instrumental view of local communities: local rights are means to global ends[318].
56.— L’analyse est également confirmée par la théorie des communs dont les travaux montrent bien que des ressources communes ne sont gérées durablement par une communauté qui se donne elle-même des règles gouvernance de ces ressources et que si elles s’insèrent dans un cadre institutionnel qui suit un certain nombre de principes. L’autonomie normative reste une condition fondamentale, et des expériences récentes autour de la mise en place de programmes REDD+ montrent que la durabilité du commun n’est pas garantie lorsque l’État impose ses propres règles sans tenir compte des conditions locales, des règles coutumières et des institutions déjà en place[319]. D’aucuns plaident aujourd’hui pour un alignement au moins partiel de leur statut sur celui des peuples autochtones. Laura Westra, par exemple, propose d’étendre la catégorie de peuple autochtone à toutes les communautés qu’elle appelle « land-based », i.e. fondées sur la terre. Le concept unificateur – qui permet de les distinguer d’autres minorités – est, en effet, celui du lien particulier à la terre[320]. Par ailleurs, « [a]ll these peoples : first, view themselves as distinct people; second, have inhabited the same territory from time immemorial ; third, possess a common language, culture and religion; fourth, view themselves as “custodians” of their environment ; fifth, define themselves, at least in part, through the habitat that provides for them; sixth, have tribal and communal forms of social relations and resources management, often based on directions from their elders; seventh, have an identity based upon their lands; and eighth, view the ecosystems they inhabit and have inhabited traditionally as religiously significant »[321]. Surtout, dit-elle, « ils se perçoivent eux-mêmes comme les environnementalistes les plus expérimentés au monde[322], investis d’un rôle de protection et de conservation de l’environnement, en particulier de l’écosystème qu’ils ont traditionnellement habité »[323]. Comme dans les droits bioculturels, c’est l’intendance de la nature qui vient en quelque sorte justifier un renforcement des droits des communautés locales[324].
Retour en haut
3) Les droits culturels
57.— La place de la culture parmi les droits de l’homme reste difficile à appréhender et on se plaint d’ailleurs souvent – ce qui est lié – du caractère toujours vague du concept de culture en droit international et du caractère non contraignant des dispositions qui s’y rapportent[325]. N’est sans doute pas étranger à cette situation le fait que, pendant longtemps, la culture ait été appréhendée, en droit international des droits de l’homme, à travers le prisme unique du « droit à la culture »[326] : « droit à l’éducation » au sens de l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDD) et droit de prendre part à la vie culturelle de la communauté au sens de l’article 27 du même texte[327]. Dans ce premier texte d’importance, la culture apparaît certes comme un droit, mais uniquement en tant que « facteur de perfectionnement et de développement humains »[328] ; il doit être compris comme un « droit d’accès la culture universelle »[329], i.e. comme une fenêtre d’accès à un ensemble de valeurs jugées communes à l’humanité. Mais l’intelligence de la culture a évolué.
On pourrait résumer cette évolution à un glissement progressif mais marqué du « droit à la culture » aux « droits culturels » dont on trouvait d’ailleurs déjà la trace à l’article 22 de la DUDD[330]. La référence aux « droits culturels » indique en creux que ce n’est plus seulement la culture « universelle » qui est en jeu, mais possiblement le droit à telle ou telle culture, le droit à sa propre culture ou même le droit à la différence culturelle[331].
58.— Tous les progrès qui ont été accomplis au cours des dernières décennies ont d’abord consisté à élargir la notion de culture jusqu’à permettre la prise en compte et la protection, par le droit international des droits de l’homme, de la diversité culturelle. Le chemin parcouru est d’ailleurs si considérable que la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle (2001) reconnaît aujourd’hui, par une puissante analogie qui n’est pas sans rappeler les fondements de la « bioculturalité », que la « diversité culturelle est, pour le genre humain, aussi nécessaire que l’est la biodiversité dans l’ordre du vivant »[332]. La préservation de l’intégrité des cultures – « l’originalité et la pluralité des identités qui caractérisent les groupes et les sociétés composant l’humanité » – à l’intérieur à la fois des cultures nationales et de la culture universelle, est donc désormais reconnue comme un « impératif éthique »[333], absolument indispensable aux échanges, à l’innovation et à la créativité[334]. Sous la poussée des textes internationaux adoptés en matière environnementale[335], la diversité des cultures se présente aussi comme un enjeu crucial de préservation des différents modes de vie et pratiques agroécologiques associés à l’entretien de la biodiversité. Enfin, signe incontestable d’une extension de la compréhension internationale de la culture, la reconnaissance de ce que la pluralité des identités passe aussi par la protection des modes de vie propres à certains groupes minoritaires, des activités économiques particulières qui leur sont liées et de ce qui en est souvent le support, à savoir la terre.
59.— Cette série de changements s’amorce dès le milieu des années 1960, période à partir de laquelle déclarations et recommandations élargissent à intervalles réguliers le contenu de la culture. À la vision érudite ou élitiste de la culture comme « capital » et activité « créatrice », s’ajoute une vision anthropocentrique qui met l’accent sur le « mode de vie »[336]. Après la référence nouvelle aux « modes de vie » dans la Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale du 4 novembre 1966[337], c’est la Recommandation concernant la participation et la contribution des masses populaires à la vie culturelle du 26 novembre 1976 qui vient l’approfondir en marquant une rupture nette avec le modèle patrimonial de la culture indéfectiblement lié aux arts et aux humanités[338]. Le concept de culture se trouve dès lors « élargi à toutes les formes de créativité et d’expression des groupes ou des individus, tant dans leurs modes de vie que dans leur activité artistique »[339]. À ce titre, les « traditions des groupes ruraux » relèvent de la culture, tandis que les États sont encouragés à les protéger, les garantir et les mettre en valeur[340]. Le mode de vie n’est pas seulement l’environnement ou le vecteur qui permet à une culture particulière de venir à la vie, mais c’est l’expression de la culture même. C’est, comme le note la Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles de 1982, l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui sont à l’origine d’une identité culturelle propre ; ce qui inclut non seulement les arts et les lettres, mais aussi « les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances »[341] ; on pourrait ajouter aussi les « visions du monde »[342]. Cette définition extensive se retrouve expressis verbis dans la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle du 2 novembre 2001[343], qui inaugure aussi le lien nouveau entre « les savoirs traditionnels, notamment ceux des peuples autochtones » (autrement appelés « connaissances traditionnelles » ou « savoirs locaux ») et la protection de l’environnement et la gestion des ressources naturelles[344]. Dans un texte ultérieur, la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée par l’UNESCO lors de la Conférence générale du 17 octobre 2003, c’est même un langage directement inspiré de la CDB qui est intégré au cadre international de protection de la culture, liant ainsi diversité culturelle et protection de l’environnement : les « connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers » y sont, en effet, appréhendées comme l’une des « manifestations » du « patrimoine culturel immatériel »[345].
60.— Il faut enfin mentionner les instruments internationaux qui rattachent expressément certaines activités économiques à la culture de certaines populations locales, tout en en soulignant l’importance pour l’économie des populations concernées, pour la conservation des paysages naturels et ruraux ou bien encore pour la préservation de l’environnement. La Convention n° 169 de l’OIT entre évidemment dans cette catégorie[346], de même que le Protocole d’application de la Convention alpine de 1991 dans le domaine de l’agriculture de montagne, du 20 décembre 1994[347], ainsi que la Convention des Carpates de mai 2003[348]. Ce qu’il y a sans doute de remarquable, c’est que ces activités économiques sont inséparables d’un mode de vie singulier – en quoi elles relèvent de la culture et participent de l’identité culturelle d’un groupe ; mais surtout, comme a essayé de le décrire le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, elles portent sur des « biens » et des « ressources » – qu’il s’agisse de la terre, de l’eau ou encore de la biodiversité – qui ont en eux-mêmes une valeur culturelle irréductible[349].
61.— Se dessine ainsi à l’échelle internationale, mais on verra aussi à l’échelle régionale, une double tendance. La première, que l’on doit à l’interprétation particulièrement dynamique que le Comité des droits de l’homme a pu livrer de l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques[350], consiste à étendre très nettement la culture – et donc la protection offerte par les textes – aux systèmes économiques et modes de vie dits « traditionnels ». Un certain nombre d’observations lui ont déjà permis d’inclure à l’article 27 l’autonomie à l’égard des institutions culturelles, les droits linguistiques, la protection des sites d’importance religieuse ou culturelle et la consultation concernant les moyens traditionnels de subsistance[351]. Le Comité s’est surtout signalé par ses constatations qui ont contribué à donner une grande extension à la notion de culture[352], incluant ce faisant les « activités économiques » qui « constituent un élément essentiel de la culture d’une communauté ethnique »[353] ou les activités économiques et sociales qui s’inscrivent dans la culture de leur communauté[354]. Il a du reste précisé, de manière décisive, que l’article 27 ne protège pas « uniquement les moyens de subsistance traditionnels des minorités nationales »[355], ce qui permet aux communautés de faire évoluer leurs pratiques et méthodes en intégrant des techniques modernes[356]. La seconde, qui n’est pas étrangère non plus au travail des organes onusiens de protection des droits humains, qui a consisté à faire de la terre et des ressources naturelles un élément même de la culture des peuples autochtones et groupes minoritaires[357], a tout le moins un lien indéfectible[358] qui existe entre l’intégrité culturelle d’une communauté et son territoire. On doit surtout la reconnaissance de ce lien spécifique à la jurisprudence de la Commission[359], puis de la Cour interaméricaine des droits de l’homme[360] qui exerce aujourd’hui une influence certaine sur la Commission[361] et la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.
62.— On n’interprétera pas ce qui précède comme l’affirmation de ce que les droits culturels des peuples autochtones et groupes minoritaires se limitent à la protection de leurs modes de vie, systèmes économiques et terres, territoires et ressources naturelles. La Déclaration sur les droits des peuples autochtones montre suffisamment, par une série d’articles détaillés, que les droits culturels couvrent désormais, en plus des droits précédents, le droit d’observer et de revivifier leurs traditions culturelles et leurs coutumes (art. 11(1)), les droits sur leur patrimoine matériel (art. 11(1)) et immatériel (art. 11(1) et 13), le droit de manifester, de pratiquer, de promouvoir et d’enseigner leurs traditions, coutumes et rites religieux et spirituels (art. 12), le droit à une éducation qui reflète « fidèlement la dignité et la diversité de leurs cultures, de leurs traditions, de leur histoire et de leurs aspirations » (art. 15), ainsi que le droit de promouvoir, développer et conserver leurs structures institutionnelles et leurs coutumes (art. 34)[362]. Mais il faut dire ici combien l’inclusion, dans les droits culturels, des rapports à la terre, au territoire et aux ressources, ainsi que les modes de vie et activités économiques, tend à renforcer l’approche intégrée qui constitue une dimension essentielle des droits bioculturels, tout en faisant écho au langage de la CDB : les « modes de vies traditionnelles » (art. 8(j)), « les pratiques culturelles traditionnelles » et « l’usage coutumier des ressources » (art. 10(c)), ou encore la dépendance étroite et traditionnelle à l’égard des « ressources biologiques » (Préambule). La proximité sémantique indique en creux que les peuples autochtones (auxquels il faut ajouter les groupes minoritaires) et les « communautés locales » partagent une conception commune de la culture qui devrait permettre aux secondes de bénéficier, à tout le moins, d’un certain nombre de droits culturels attachés au statut des premiers. Le rapprochement entre peuples autochtones et communautés locales a d’ailleurs été réalisé, on le sait, par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans les affaires Moiwana Village v. Suriname et Saramaka People v. Suriname[363]. Il pourrait être approfondi en jouant justement sur le levier des modes de vie et des rapports à la terre, ce qui ouvrirait tout un champ de protection des communautés locales à travers leur culture. C’est en tout cas, à l’heure actuelle, une piste bien plus prometteuse que la recherche d’une protection des communautés locales sur le fondement du droit des minorités qui se heurte encore à une acception trop étroite des concepts de culture et d’ethnicité[364] au cœur de la qualification de « minorité » en droit international.
Retour en haut
4) Le devoir d’intendance
63.— L’aspect sans doute le plus controversé des droits bioculturels porte sur l’inclusion d’un volet devoir. La difficulté tient à la fois à la place problématique et instable des devoirs dans la théorie moderne des droits fondamentaux, mais aussi spécifiquement à la relative indétermination du devoir d’intendance dans les travaux de Kabir Bavikatte et alii[365]. Il faudra, au paragraphe suivant, s’étendre sur le second de ces aspects, mais on doit d’ores et déjà donner quelques indications sur la manière dont pourrait être interprété le devoir d’intendance. Les premiers efforts doivent porter sur la terminologie et conduire à faire une première distinction entre les « devoirs » et les « obligations ». Les obligations font évidemment et naturellement partie des droits fondamentaux : ils constituent la « contrepartie des droits »[366], ce que l’on peut appeler, avec d’autres, les « obligations-réflexes »[367]. Au regard du premier fondement des droits bioculturels – la protection des populations locales elles-mêmes, leurs droits à la terre, au territoire et aux ressources naturelles, leur autodétermination et leurs droits culturels –, les communautés sont titulaires de droits et sont les sujets collectifs auxquels, de manière réflexe, des obligations sont dues[368]. La liste des débiteurs de ces obligations est plus ou moins large selon que l’on inclut, en plus des États, la communauté internationale et les entreprises[369]. Les États auraient ainsi l’obligation de reconnaître les droits fonciers ou les droits réels sur les ressources naturelles, de respecter les institutions locales, les procédures de prises de décision communautaires, les pratiques traditionnelles et les cosmovisions, de s’abstenir de toute mesure aboutissant à limiter l’usage des langues locales ou imposant des normes en matière de développement, de conservation ou d’éducation[370]. La communauté internationale devrait pareillement s’abstenir de porter des projets de développement ou de conservation susceptibles d’affecter les populations locales sans discussion et acceptation préalables des communautés et peuples concernés selon des conditions procédurales qui garantissent une bonne compréhension, l’absence de fraude, et qui permettent aux communautés d’opposer un droit de véto[371]. Enfin, s’agissant des exploitants, ils auraient l’obligation de respecter la volonté des peuples autochtones et communautés locales et de n’agir qu’après avoir obtenu leur consentement préalable et en connaissance de cause – étant précisé que les communautés et peuples concernés doivent conserver, là encore, le droit de dire « non »[372]. L’un des enjeux importants est bien entendu la justiciabilité, i.e. c’est la capacité intrinsèque du droit à être garanti par un juge et la possibilité formelle qu’il existe un juge pour en connaître[373].
64.— Le second fondement – la protection des communautés pour leur rôle dans l’intendance de la nature – nous conduit directement sur le terrain passablement mouvant des devoirs. Dans la théorie moderne des droits fondamentaux, les devoirs occupent une place marginale en ce qu’ils sont tenus pour ressortir avant tout à la morale et à l’éthique. Ce confinement – pour ne pas dire « refoulement »[374] – du devoir (et de la responsabilité) au champ de la morale et de l’éthique est le résultat d’une évolution longue et complexe que vient couronner un revirement complet dans la théorie des droits et que sanctionnent les révolutions américaines (1776) et françaises (1789) – ce que Norberto Bobbio a appelé « une révolution copernicienne »[375]. À travers le passage d’une logique de « devoirs » à une logique de « droits »[376], le droit moderne aurait du reste signé une victoire majeure sur la tyrannie avec laquelle nous ferait renouer tout mouvement inverse. Ainsi s’explique qu’il répugne tant à l’imaginaire juridique libéral de questionner la place des devoirs et responsabilités dans la théorie des droits fondamentaux[377]. Et pourtant, force est d’observer la progression, depuis une cinquante d’années, du nombre de textes sur les devoirs et responsabilités, certains à portée seulement symbolique[378], d’autres avec une plus large ambition[379], du nombre aussi de constitutions qui accueillent plus généreusement les devoirs[380], et de la fréquence des références aux devoirs de l’homme dans les débats autour du droit de l’environnement[381].
65.— Mais revenons à la question des devoirs dans le paradigme des droits bioculturels. Pour Kabir Bavikatte, qui n’a jamais totalement clarifié sa position sur les devoirs, les droits bioculturels semblent parfois reconnus aux communautés locales et autochtones afin de leur permettre de maintenir leur rôle d’intendant de l’environnement. Plus radicalement à d’autres endroits, les droits paraissent dépendre de l’observation de certaines pratiques ou de l’alignement à un certain mode de vie jugé pertinent du point de vue de la conservation de l’environnement ou de l’usage durable des ressources. Essayons de travailler autour de ces propositions entre lesquelles paraît osciller Kabir Bavikatte[382].
66.— La première s’exprime simplement : la reconnaissance de droits bioculturels est une condition préalable et indispensable au maintien, par les peuples autochtones et les communautés locales, de leurs modes de vie associés à la conservation de l’environnement, leurs pratiques traditionnelles durables, leurs cosmovisions, leur attachement à la terre, etc. Bien que Kabir Bavikatte ait pu parfois évoquer un « duty of care », c’est pourtant l’interprétation qui paraît la plus plausible à la lecture de l’ensemble de son travail. Il dit ainsi nettement, dans Stewarding the Earth, que « [s]tewardship of lands and waters is not an abstract concept but is embodied in a way of life that can only flourish if its cultural and material autonomy can be protected. The ethic of stewardship is rooted within a moral universe that will be crowded out if forced to fit within the dominant legal and material systems of the homo economicus »[383]. On pourrait dire autrement que, pour l’auteur, le stewardship est une certaine manière d’être au monde, une certaine manière de voir et respecter la « terre », et le seul moyen de préserver ces caractéristiques, c’est de reconnaître des droits bioculturels. Giulia Sajeva a critiqué cette interprétation. Pour elle, en effet, le second fondement des droits bioculturels, à savoir la conservation et l’usage durable de la biodiversité, mérite d’être pris au sérieux : « It is not enough to affirm, as Bavikatte et Bennett […] do, that a “definite empiriral proof that recognition and enforcement of biocultural rights promotes better environmental protection remains elusive”. The logic of biocultural rights within Bavikatte’s construction suggests that biocultural rights approaches either fall in the ideological trap of the noble savage, or explicitly need to incorporate a duty to remain sustainable […]. If indigenous peoples and local communities were entirely free to change sustainable lifestyles to suit their needs, they might potentially disregard the second foundation of biocultural rights, which is one of the (two) reasons for which were granted such rights »[384]. À partir de là, soit les populations locales ne satisfont par leur devoir d’intendance et il faut en tirer toutes les conséquences ; soit on considère, au contraire, que, une fois les droits bioculturels reconnus, les communautés maintiennent des pratiques « durables ». Évidemment, outre qu’elle est naïve, cette dernière branche de l’alternative repose sur la prémisse dangereuse selon laquelle les communautés locales et peuples autochtones vont à jamais maintenir un certain mode de vie ou certaines pratiques. Or, comme le rappelle Berkes[385], les pratiques, règles et savoirs des populations locales peuvent ne plus être « in line with conservation goals ». Présupposer le contraire revient à réactiver le sinistre « mythe du bon sauvage (écologique) » et à réifier les communautés[386].
67.— Cette aporie nous mène à la seconde proposition, beaucoup plus radicale : les populations traditionnelles supportent un devoir explicite d’intendance, i.e. un « duty of care and protection »[387]. Dans une vision purement statique des modes de vie des populations locales, ce devoir ne paraît pas problématique. Il semble, en effet, en harmonie avec la particularité des systèmes juridiques des communautés locales et peuples autochtones, à savoir qu’ils sont duty-based – fondés sur les devoirs plutôt que sur les droits[388]. Reste que, ainsi qu’on l’a dit, les représentations fixistes sont illusoires, et il faut donc, si on emprunte cette ligne interprétative, s’interroger sur le débiteur et le créancier de ce devoir, en même temps que sur son contenu et sa sanction. La question du contenu du devoir est épineuse et la définition retenue peut avoir des effets considérables sur les populations locales : s’agit-il de maintenir – en acceptant toujours les dynamiques d’évolution – une culture, des croyances spirituelles et des pratiques coutumières comme le donnent à penser le Code de conduite éthique Tkarihwaié:ri[389] et la décision de la Cour constitutionnelle de Colombie[390] ? Est-il plus étroitement question de « pratiques culturelles traditionnelles » et d’un « usage coutumier des ressources » en tant qu’ils sont « compatibles avec les impératifs de leur conservation ou de leur utilisation durable »[391] ? Faut-il, comme incite à le faire la formule précédente, s’intéresser au résultat des activités des populations locales, à savoir la conservation et l’usage durable des ressources (et dans ce cas, qui en juge et d’après quels critères) ? La question reste ouverte, mais on peut d’ores et déjà observer que la dernière proposition conduirait assurément à placer les communautés et peuples concernés sous la coupe de nouveaux experts[392].
68.— On conviendra sans peine que les peuples autochtones et communautés locales sont les débiteurs du devoir d’intendance. Mais qui en sont alors les créanciers ? On peut d’emblée convenir, avec la doctrine autorisée, que les devoirs fondamentaux ne devraient jamais pouvoir être imposés aux individus au bénéfice de l’État, et il convient d’étendre sagement cet enseignement aux devoirs imposés aux communautés[393]. Cette réserve faite, le nombre des créanciers va dépendre de l’approche – anthropocentrique, anthropocentrique-transgénérationnelle[394], biocentrique[395] ou écocentrique[396] – qui est privilégiée. S’agit-il de protéger l’environnement pour son service à l’humanité[397], diverses options sont alors envisageables selon que le système juridique prend en compte seulement un intérêt subjectif personnel ou plus largement un intérêt trans-individuel, diffus et indivisible[398], éventuellement transgénérationnel[399], dans la protection de l’environnement. Les créanciers ne sont pas les mêmes, puisqu’il s’agit, par exemple, de la victime individuelle dans le premier cas, de l’ensemble de collectivité dans le second, avec une extension possible aux générations futures[400]. Précisons que, dans le second cas, le modèle procédural est celui de l’actio popularis, telle qu’on la trouve par exemple dans le monde juridique lusophone[401] ou ibérico-américain. Précisons encore que, dans cette dernière hypothèse, et afin d’éviter efficacement le détournement du droit d’agir, il peut être opportun de réserver la qualité à agir à des associations chargées de défendre les intérêts des peuples autochtones ou communautés locales[402].
S’il s’agit, dans une approche écocentrique, de protéger les espèces ou même la « nature » (la « communauté biotique »[403]) en tant que tels – i.e. pour leur valeur propre –, il faut modifier notre raisonnement : en cette hypothèse, on admet l’existence d’un intérêt spécifique attaché à un collectif qui comprend toutes les espèces (espèce humaine comprise) ou à un collectif singulier associant humains et non-humains[404]. Se modifie surtout radicalement la nature l’action – et cela vaut a fortiori pour l’approche biocentrique –, puisqu’il ne s’agit plus seulement d’agir en défense d’un intérêt individuel ou diffus qui réside dans l’usage commun des biens environnementaux, mais de la défense de l’intérêt d’Autrui. On doit alors considérer que c’est un substitut qui agit dans l’intérêt d’une entité qui ne devient pas partie (et peu importe donc qu’elle n’ait pas la personnalité juridique), mais bénéficie des effets de l’action[405]. En d’autres termes, sur le plan procédural, l’action en justice prend la forme d’une action de substitution[406]. Une fois encore, et pour les mêmes raisons que celles déjà mises en avant, il serait opportun de limiter le nombre des substituts ayant qualité à agir.
69.— Si la personnalité juridique est reconnue à la « nature » (écocentrisme)[407] ou à certains éléments individuels de la nature (biocentrisme), le raisonnement doit être adapté : investis de droits et chargés d’obligations[408], la nature ou les éléments individuels de la nature bénéficient alors d’obligations‑réflexes dont certaines pourraient être mises à la charge des populations locales voisines. On pourrait même aller au-delà et mettre des devoirs particuliers à la charge d’une communauté locale ou d’un peuple autochtone érigé en « gardien ». La récente législation néo-zélandaise, qui a conduit à reconnaître la personnalité juridique au fleuve Whanganui, se rapproche le plus de cette hypothèse[409]. La loi reconnaît bien le rôle culturel de gardien de certaines tribus, i.e. les devoirs de soin et de protection qu’elles assument vis-à-vis du tout que représente le fleuve dans leur culture, mais sans qu’il en soit tiré des conséquences sur le plan de la responsabilité au-delà du système coutumier des tribus concernées. Le texte de la loi rappelle seulement, en effet, les « devoirs <responsibilities> des Whanganui iwi [les tribus] et hapū [sous-groupe] dans le soin et la protection qu’ils apportent au fleuve Whanganui, ainsi que dans la gestion et l’usage qu’ils en font, et ce conformément au kawa et au tikanga » [410], i.e. respectivement les valeurs intrinsèques du fleuve (Te Awa Tupua)[411] et le système coutumier et de valeurs des tribus[412]. C’est la transposition du principe maori dit « kaitiakitanga ». Selon le Māori Dictionary, kaitiakitanga est un substantif qui signifie « guardianship, stewardship, trusteeship, trustee »[413], mais qui a évidemment ici une forte dimension spirituelle[414]. Au regard de la loi néo‑zélandaise, l’intendant ou gardien est le bureau d’intendance spécialement institué, le Te Pou Tupuan qui constitue « le visage humain du Te Awa Tupua [le fleuve Whanganui] »[415]. Constitué de deux membres de « haute intégrité », dont l’un est nommé par la Couronne, l’autre collectivement par les tribus qui ont intérêt dans le fleuve, le Te Pou Tupuan prend toutes les décisions nécessaires pour protéger les intérêts du fleuve et agit en son nom et pour son compte[416]. Il répond des éventuels dommages causés par le Te Awa Tupua[417]. En revanche, le législateur a fait le choix, sans doute sage, de ne pas retenir la responsabilité des personnes nommées ès qualités d’intendants : « The persons appointed to Te Pou Tupua are not personally liable for any action taken or omission made in their capacity as Te Pou Tupua, but only if the action or omission relates to their powers and functions under this Act and they have acted in good faith ». Autrement dit, aussi longtemps que les gardiens agissent dans le cadre de leurs pouvoirs et fonctions et de bonne foi, ils ne peuvent être tenus responsables des actions et omissions qui leur seraient éventuellement imputables.
70.— Quelle que soit, en tout cas, la forme que prend le devoir d’intendance, il faut reconnaître qu’il soulève des problèmes de technique juridique qu’il appartiendra à chaque système juridique de surmonter, en répondant au préalable à la grande question de la gamme des intérêts (d’anthropocentriques à écocentriques) qu’il entend défendre. La question, il est vrai n’est pas totalement inédite, car elle rejoint celle que le droit de l’environnement pose aujourd’hui à la responsabilité civile. Ce qui est en revanche plus inédit, c’est la place centrale accordée au devoir dans une doctrine qui ambitionne pourtant aussi de mieux protéger les peuples autochtones et les communautés locales. Il y a là, comme on l’a déjà souligné, une véritable tension qui mérite d’être examinée au titre des défis des droits bioculturels.
Retour en haut
III. Les défis des droits bioculturels : du devoir d’intendance à la subjectivité juridique
![]()
<IMAGE 2 : https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/green-hills-red-soil-rice-traditional-169258994>
71.— Poussée jusqu’au bout de sa logique juridique, la catégorie des droits bioculturels pose un vrai problème de justice et de légitimité. En semblant imposer un devoir d’intendance à la charge des peuples autochtones et des communautés locales – et dont les créanciers seraient, selon l’éthique qui soutient le régime de responsabilité, la victime individuelle, l’ensemble de la collectivité (générations futures comprises), l’ensemble de la communauté biotique (humains et non-humains)[418] –, elle permettrait éventuellement de conditionner les droits de groupes humains historiquement exploités[419], encore en grande situation de précarité et qui sont déjà ou seront assurément parmi les premières victimes des changements climatiques et de l’érosion de la biodiversité[420]. La proposition peut sembler particulièrement inique dans son expression la plus rigoureusement positiviste, et elle l’est probablement plus encore pour les peuples autochtones dont le statut international et les droits ont été considérablement renforcés ces dernières décennies et pour lesquels l’adoption des droits bioculturels, selon la lecture extensive ici exposée, représenterait un singulier et dramatique retour en arrière. Raison pour laquelle des auteurs et activistes, initialement très proches des travaux et des entreprises de Kabir Bavikatte, ont, de longue date, proposé que la catégorie des droits bioculturels soit limitée aux seules communautés locales, les peuples autochtones continuant de bénéficier des droits qui leur sont déjà reconnus sans qu’il soit besoin d’établir de liens avec la conservation et l’usage durable des ressources naturelles[421]. Comme le résume Giulia Sajeva, « [i]ndigenous peoples’ rights are limited, like any other human rights, but only by conflicting human rights and by laws and regulations protecting very important aspects of public interest (for example, the right to self-determination of an indigenous people may be limited by state laws concerning toxic wastes and possession firearms). On the contrary, the right to self-determination that would be conferred as part of the biocultural rights basket is limited also by the duty to be and remain sustainable »[422]. L’extension des droits bioculturels aux peoples autochtones n’est toutefois pas à exclure totalement. Kabir Bavikatte, Daniel Robinson[423] et Giulia Sajeva[424] ont montré combien la catégorie pouvait aussi être utilisée stratégiquement pour convaincre les nombreux États que la terminologie des droits des peuples autochtones rend particulièrement nerveux, d’accorder plus de droits aux peuples autochtones en mettant l’accent sur l’environnement et la conservation de la biodiversité plutôt que sur l’autodétermination[425].
72.— Dans le prolongement de cette lecture stratégique, il faut s’efforcer, dans les lignes qui suivent, de déborder du tracé contraignant que nous impose la lecture strictement juridique, en nous plaçant cette fois-ci sur le terrain du discours et des pratiques. L’enjeu est de comprendre comment les catégories et concepts – dont certains sont en train de se charger normativement – se déploient et circulent, les transformations que les acteurs leur font subir et la manière dont ils peuvent les exploiter à travers l’action, les espaces de rêve, de créativité et d’innovation qu’ils rendent possibles. C’est à ce prix, nous semble-t-il, que l’on pourra véritablement évaluer – surtout à un moment comme celui-ci où les droits bioculturels offrent encore toute la plasticité inhérente aux catégories encore jeunes –, les promesses, les potentialités et les dangers des droits des bioculturels. Un point mérite une attention redoublée, il porte sur le cœur des droits bioculturels et interroge une rhétorique aujourd’hui globalisée : l’idée que les populations locales sont des « intendantes » de la nature. Quelle est l’origine de cette expression, et surtout, quel en est le sens, tel qu’il se laisse saisir en particulier dans les grands récits actuels autour de la gestion décentralisée des ressources et dans les travaux des éthiciens et des naturalistes ? Le concept d’« intendance » est-il mobilisé pour soumettre les communautés à des devoirs nouveaux ou est-il seulement utilisé pour mieux cerner des catégories sociales complexes à l’intérieur d’un espace discursif chargé de considérations sur la protection de l’environnement et l’avancement des droits des populations locales ? C’est à cette série de questions que tentent de répondre les développements qui suivent.
73.— On a déjà montré comment la formule « d’intendance de la nature » avait servi à décrire la manière dont les populations locales ont été progressivement appréhendées, à partir de la fin des années 1980, par les discours et les instruments juridiques[426]. Le lecteur aura sans doute compris que le concept s’alimente nettement de l’idée que les communautés locales et les peuples autochtones, en raison de leurs cosmovisions qui font souvent de la terre l’ancêtre commun, à tout le moins le support même d’un mode de vie, et des éléments de la nature des membres à part entière de la communauté biotique (en tout cas, la nature n’est pas réductible à une simple ressource à exploiter), en raison de leurs savoirs écologiques, mais aussi des institutions et des coutumes qui les soumettent à des obligations vis-à-vis de cette terre et de cette communauté biotique, sont en quelque sorte naturellement qualifiés pour prendre soin de l’environnement[427]. Le rapport déjà cité, Our Common Future, notait du reste, de manière frappante, que les « peuples qui vivent en tribus et les populations autochtones » offrent « des modes de vie qui d’ailleurs pourraient donner d’utiles leçons aux sociétés modernes en ce qui concerne la gestion des ressources présentes dans les écosystèmes complexes des forêts, des montagnes et des terres arides »[428]. Plus loin, le rapport soulignait aussi, par des formules tranchées : « Ces communautés sont les dépositaires d’un riche patrimoine de connaissances et d’expériences traditionnelles qui rattachent l’humanité à ses origines lointaines. Leur disparition est une perte pour toute la société, qui aurait beaucoup à apprendre de leur savoir-faire traditionnel à gérer rationnellement les systèmes écologiques très complexes. Par une ironie terrible, lorsque le développement s’enfonce dans des forêts pluviales, des déserts et d’autres environnements isolés, il tend à détruire les seules cultures qui aient réussi à prospérer dans ces environnements »[429]. Ces réflexions, on l’a dit, ont reçu le soutien appuyé des travaux d’Ostrom et de l’École de Bloomington[430]. Elles reflètent aussi les courants critiques du développement qui gagnent en visibilité à partir des années 1970[431]. Depuis plusieurs décennies, des travaux nombreux revalorisent les savoirs agroécologiques traditionnels et les innovations des peuples autochtones[432], et des études cherchent aussi à comprendre comment les systèmes coutumiers traditionnels ont permis de maintenir la grande résilience de certaines populations locales[433].
74.— La conversion de ces réflexions dans les instruments juridiques a pu semer le trouble dans l’esprit des juristes. Dans le texte aujourd’hui emblématique de l’article 8(j) de la CDB, les États paraissent n’être tenus de respecter, préserver et maintenir « les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels » que tout autant qu’elles « présentent un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique ». En d’autres termes, et à l’instar des parents qui ne jouissent des droits attachés à l’autorité parentale que s’ils s’acquittent de leurs devoirs, les communautés locales et peuples autochtones ne jouiraient de droits sur leurs connaissances, innovations et pratiques que s’ils se sont acquittés de leur devoir de conservation et d’utilisation durable de la biodiversité. Cette ligne interprétative, qui est toujours tracée depuis l’éthique centrale de stewardship, a parfois conduit Kabir Bavikatte à faire de « l’intendant » de la nature le débiteur d’un devoir « d’intendance » et Giulia Sajeva à s’interroger plus avant sur son contenu et devoir.
Une autre interprétation est toutefois possible et elle paraît devoir être privilégiée. Comme le montrent très bien à la fois le Code de conduite éthique Tkarihwaié:ri et la décision de la Cour constitutionnelle de Colombie dans l’affaire Tierra Digna, l’évocation des devoirs reste extrêmement ambiguë et rien ne permet de conclure de manière définitive que des devoirs doivent être mis à la charge des communautés locales et peuples autochtones. Le code de conduite éthique indique bien que « [l]’intendance/garde traditionnelle reconnaît les […] obligations et les responsabilités des communautés autochtones et locales de protéger et de conserver leur rôle traditionnel d’intendants et de gardiens de ces écosystèmes par le maintien de leur culture, de leurs croyances spirituelles et de leurs pratiques coutumières » [434] et la Cour constitutionnelle de Colombie énonce que « les droits bioculturels impliquent que les communautés doivent maintenir leur patrimoine culturel distinctif […] » (« estos derechos implican que las comunidades deben mantener su herencia cultural distintiva »)[435]. Mais les formules peuvent être comprises comme imposant avant tout à l’État de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux populations locales de préserver un certain nombre de traits distinctifs attachés à l’intendance de la nature.
75.— Les multiples références à l’intendance à la nature et la mobilisation de l’éthique n’ont en réalité d’autre objet que d’appréhender juridiquement le sujet des droits bioculturels, i.e. celui qui peut se prévaloir des droits qui forment le faisceau des droits bioculturels[436]. Ces références sont des points d’ancrage indispensables, les seuls qui permettent, avec l’appui de l’éthique, de donner des contours à ce qui ne peut jamais être saisi par les systèmes juridiques « modernes », à ce qui ne peut en tout cas jamais l’être sans référer immédiatement à son antithèse – le « traditionnel » – et prendre ainsi le risque de se nier ou de se renier. L’intendance de la nature offre ainsi au système juridique moderne le pouvoir de donner forme et vie à une nouvelle subjectivité qu’il a contribué à faire disparaître ou à rendre invisible, tout en lui permettant de déléguer la tâche d’en préciser le contenu à des disciplines extérieures. La plupart des textes qui ont servi à élaborer la catégorie des droits bioculturels sont, il faut bien le reconnaître, des pierres d’achoppement sémantiques et conceptuels. Dans le CDB, l’article 8(j) vise les « communautés autochtones et locales » qui « incarnent des modes de vies traditionnelles »[437], l’article 10(c) mentionne « les pratiques culturelles traditionnelles » et « l’usage coutumier des ressources »[438], tandis que le Préambule met en lumière le fait que les communautés locales et « peuples » autochtones « dépendent étroitement et traditionnellement des ressources biologiques » sur lesquelles sont d’ailleurs « fondées leurs traditions »[439]. La manière dont les textes s’efforcent de saisir les communautés et peuples autochtones est évidemment problématique, comme le rappelle le débat permanent des anthropologues autour de la définition des savoirs « traditionnels »[440]. Le croisement des textes – juridiquement et non juridiquement contraignants –, et de la jurisprudence montrent d’ailleurs, sinon le malaise, du moins les tâtonnements. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) a pu suggérer que « les modes de vie traditionnels » devaient être tenus pour synonyme de « non industrialisés ». Ainsi, dans un rapport publié en 2001, le HCDH a indiqué, interprétant la formule de l’article 8(j) de la CDB, qu’il fallait l’entendre comme incluant les « estimated 1.5 to 2 billion people around the world who have not adopted industrialized practices to exploit agricultural, forest, animal and fisheries resources » [441]. Font écho à cette définition les textes qui insistent sur la « subsistance », la nature « artisanale » des activités des peuples autochtones et communautés locales[442]. Les « pratiques culturelles traditionnelles » recouvriraient avant tout un lien particulier à la terre, au territoire et aux ressources biologiques. Ce lien particulier, qui relève de l’attachement, est un facteur crucial dans la cohésion des communautés et la formation de leur identité[443]. Il détermine un certain nombre de technologies, savoirs, innovations et pratiques qui, parce qu’ils sont informés par le statut spécifique de la terre et des ressources que reflètent des arrangements institutionnels complexes, sont jugés souvent protecteurs de l’environnement. Comme a pu le dire nettement la Cour interaméricaine des droits de l’homme : « the culture of the members of the indigenous communities directly relates to a specific way of being, seeing, and acting in the world, developed on the basis on their close relationship with their traditional territories and the resources therein, not only because they are their main means of subsistence, but also because they are part of their worldview, their [religiousness], and therefore, of their cultural identity »[444].
Quant à la référence à la dépendance étroite et traditionnelle à l’égard des ressources biologiques, elle recoupe semble-t-il en partie le contenu dégagé pour le mode de vie « traditionnel ». Il s’agit ici de souligner l’importance de l’économie de subsistance ou des activités (qualifiées encore de « traditionnelles ») telles que la chasse, la pêche, la chasse à la trappe et la cueillette, qui sont essentielles pour garantir l’autosuffisance et la culture des peuples autochtones et communautés locales[445].
76.— La mobilisation de l’intendance de la nature, notamment ce qu’on appelle la « stewardship ethics », permet ainsi de préciser le statut des nouveaux sujets – i.e. l’être de la persona à laquelle se rapportent les nouveaux droits[446] –, tout en rompant avec le jeu d’antinomies (moderne‑industriel/traditionnel) délétères dont le point de référence constitue toujours les sociétés « modernes » – et dont l’effet est de définir à rebours ce qui est moralement et juridiquement acceptable de la part des peuples autochtones et des communautés locales (ainsi, ce qui n’est plus « traditionnel » n’est plus digne d’intérêt). Le champ de réflexion ouvert par le stewardship a été nourri par deux décennies particulièrement riches en travaux de disciplines diverses – l’éthique, bien entendu, mais aussi la biologie de la conservation et la science de la durabilité (« sustainability science »)[447] –, qui ont aussi contribué à accuser l’indétermination originelle[448]. C’est d’abord au plan de l’éthique environnementale qu’il faut chercher à comprendre le stewardship, car c’est dans ce champ qu’il trouve, si ce n’est son origine, du moins son expression la plus complète, et il a assurément constitué le point de référence, conscient ou inconscient, des textes et décisions dont nous avons analysé le contenu aux paragraphes précédents[449]. L’étymologie donne déjà de précieuses indications en pointant un rapport particulier à la terre, à la maison, à la vie domestique : steward vient de sty-ward, i.e. le gardien de la maison ou la personne chargée de veiller sur les animaux (stig c’est aussi aussi l’enclos en bois, une porcherie – sty, vraisemblablement aussi une partie de la maison, un hall). Lui sont associés des mots comme le guard ou le warden[450], ce dernier étant justement celui qui garde les parcs ou réserves naturelles. La littérature spécialisée en souligne aussi l’origine religieuse et la présence dans les trois grands monothéismes. L’humanité y est ici décrite comme un steward : elle n’est pas propriétaire de la Terre qui ne lui a été confiée par Dieu qu’en qualité d’intendant, de preneur, de fiduciaire (« trustee ») ou de gardien[451]. Elle doit répondre de son usage et du soin qu’elle porte à la nature devant Dieu, au même titre que le garde d’un domaine doit répondre de sa gestion devant le propriétaire ou que le trustee qui est comptable devant la loi des biens qui lui ont été confiés en trust[452].
77.— L’éthique environnementale moderne conserve au stewardship ces principaux traits, même si on note souvent des emplois simplement métaphoriques et parfois aussi une instrumentalisation du terme[453]. C’est d’abord un rapport à la terre (« land ») qui est mis en évidence, ce qui est particulièrement vrai chez Leopold, représentant de ce qu’on appelle parfois « l’éthique de la terre » ou le « land stewardship »[454], et qui a contribué à populariser le concept de stewardship en éthique environnementale. La référence à la terre ne limite d’ailleurs pas le champ de l’éthique au sol et au paysage, puisque le rapport d’intendance s’étend généralement au-delà du sol pour embrasser aussi sa composition, ainsi que l’eau, les plantes et les animaux[455] –, ce qui permet de couvrir ce que les auteurs appellent « l’environnement naturel »[456], « l’écosystème »[457] et plus largement la « land community »[458] ou même la « communauté biotique ». Dans la version religieuse ou spirituelle du stewardship, le steward est nommé par une autorité qu’il « reconnaît », tandis que sa gestion doit normalement se conformer aux exigences et éventuels objectifs qui lui ont été fixés par l’autorité habilitante[459] devant laquelle il « répond » de ses actes – actes dont il « assume » par ailleurs les conséquences[460]. Dans l’acception plus moderne des éthiciens de l’environnement, il y a bien une forme d’autorité, ou du moins l’idée centrale du devoir-répondre devant quelqu’un ou une entité (answerability), mais le lien est souvent plus distant et l’autorité envisagée de manière plus diffuse : c’est toute la société, éventuellement étendue aux générations futures[461], ou l’assemblage que forment les humains et non‑humains. L’accent est mis moins sur la responsabilité dans un sens « passéiste » et « répressif ou réparateur » (ce qui place au premier plan les conséquences : « devoir répondre de… » ; « être comptable de… ») que sur la nature ancillaire de la fonction et du caractère prospectif de la charge qui s’y attache : le steward se charge de quelque chose ou de quelqu’un en trustee ou en fiduciaire pour quelqu’« un » d’autre. La responsabilité, comme chez Jonas et Ricœur, s’inscrit dans le temps de l’avenir[462] – c’est avant tout « l’aptitude à répondre » (la « response-ability » de Haraway[463]). Le steward se signale ainsi moins par ce qu’il lui appartient de faire (les devoirs sont souvent vagues) et ce dont il doit répondre, que par la charge qu’il accepte et l’univers axiologique particulier dans laquelle elle est définie. Le cadre moral peut conserver une dimension conséquentialiste, en ce sens que le « bien » qui définit les principaux fondamentaux d’une conduite acceptable sont jugés au plan des conséquences. Le « bon » steward est celui dont les actions accroissent le bien-être (de l’humanité)[464], qui ne compromettent pas les possibilités de vie bonne ou de développement des générations futures ou les dynamiques évolutives de la communauté biotique[465]. Mais il est, en son cœur même, non instrumental. En d’autres termes, ce qui est « gardé » ou pris « en charge », l’est avant tout pour sa valeur intrinsèque, i.e. par l’effet d’un souci moral qui détourne – fût-ce un instant de raison – le steward de valeurs purement instrumentales et anthropocentriques. Dans cette version, l’éthique d’intendance ouvre donc très largement le cercle de la considération morale au-delà des seuls êtres de volonté, de manière à inclure tout ou partie des êtres sensibles (et même des êtres non sensibles)[466], qui sont donc protégés non en raison de leur valeur anthropocentrique et instrumentale, mais en tant que tels (pour leur valeur intrinsèque).
78.— Pour ramasser ces riches considérations en quelques lignes, on peut dire que, pour les éthiciens (et surtout les éthiciens de l’environnement) : (i) le steward est dans un rapport d’attachement à la terre, i.e. qu’il y a chez lui le sentiment d’appartenance à un plus large écosystème[467] ; (ii) le steward n’est pas le propriétaire de ce qu’il utilise ou gère – la terre – il n’en est que le fiduciaire ou le gardien, ce qui fait, à notre sens, de la proposition d’un « proprietarial stewardship »[468] une contradictio in adjecto[469] ; (iii) il accepte de répondre (response-ability) de son usage ou de sa gestion devant une autorité ou la communauté (plus ou moins largement définie)[470], ce qu’il faut comprendre avant tout comme une charge de soin qu’il accepte et qui impose des limites à ce qu’il peut faire dans l’usage ou la gestion ; (iv) ce qu’il peut faire ou ne pas faire est défini par référence à un univers moral bio-écocentrique qui élargit le cercle de la considération morale aux humains et non-humains. Des considérations utilitaristes, instrumentales et anthropocentriques peuvent également être prises en compte, et certaines entrent nécessairement en conflits avec l’approche bio-écocentrique[471], ce qui impose alors des arbitrages[472]. De toute manière, comme le donne à penser María Puig de la Bellacasa, dans son exploration récente du « care » dans les pratiques de la permaculture, il y a probablement ici moins une éthique au sens traditionnel (i.e. un code d’obligations éthiques), qu’un ethos[473] qui fonde les principes éthiques plutôt qu’il ne les suit lui-même ; ce qui en fait une « éthique située »[474].
79.— Chacun de ces éléments est important, car il cherche à préciser les nouveaux sujets collectifs titulaires de droits bioculturels. Les références appuyées aux « gardiens de la diversité biologique »[475] ou aux « intendants »/« gardiens » donnent une assise éthique aux différentes caractéristiques associées aux communautés locales et peuples autochtones et permettent ainsi d’en préciser le statut éthico-politique. L’épaisseur morale potentielle des concepts mobilisés – trust, fiducie, communauté biotique, aptitude à répondre, charge, soin – permet de sortir des références peu articulées et stériles aux modes de vie, pratiques culturelles, la dépendance aux ressources biologiques, comme tente de le faire aussi le Groupe de travail spécial sur l’article 8(j) qui s’efforce de définir les communautés locales[476]. Les communautés peuvent dès lors être appréhendées par un mode de vie, mais construit à partir d’un rapport singulier d’attachement à la terre. Le lien d’interdépendance holistique entre la communauté et les écosystèmes fait naître aussi des cosmovisions et cosmologies qui ne sont généralement pas naturalistes, et qui permettent ainsi de définir des rapports non nécessairement hiérarchiques entre humains et non-humains et d’encadrer les types d’actes qui peuvent être accomplis sur la terre et les ressources[477]. Mais rien n’est ici romantisé[478].
80.— On pourra sans doute nous reprocher des généralisations et des simplifications. Mais l’enjeu n’est pas tant ici de saisir au plus près ce qu’on a appelé le statut éthico-politique des communautés locales et peuples autochtones au cœur des droits bioculturels, que de montrer que le débat doit être porté à ce niveau – en dépassant l’horizon en l’occurrence dangereux des devoirs –, et qu’il relève de ce qu’Arturo Escobar appelle « l’ontologie politique »[479]. Il faut alors reconnaître que ce qui se joue c’est à la fois une lutte politique[480] pour faire accepter d’autres visions du monde dans notre droit moderne d’inspiration largement occidentale (seul moyen de lui faire admettre une autre manière d’être sujet de droit)[481] et un combat pour produire un changement, à plus ou moins long terme, dans les pratiques à l’égard des écosystèmes. Un autre enjeu – étroitement lié au premier – est d’échapper à l’emprise du « traditionnel » qui bloque en effet toute réflexion ontologique avec une conséquence évidente : enfermer les peuples autochtones et communautés locales dans ce que Fikret Berkes a justement appelé le mythe dualiste du « Bon sauvage/Ange déchu »[482]. Le mythe s’articule autour de la dyade traditionnel/moderne. Peuples autochtones et communautés locales sont d’abord présentés comme de « bons sauvages écologiques »[483], i.e. qu’ils sont « close to the land and intrinsically attuned to nature, which makes it possible, in some vague way, to live “in balance” with their environment »[484]. Ensuite, comme leur « harmonie » avec la nature est réputée fondée sur un mode de vie ou des pratiques « traditionnels », ils ne sont pas censés changer ou évoluer[485]. Enfin, en cas d’évolution ou de changement – i.e., d’écart par rapport au modèle imaginé par les conservateurs –, ils deviennent alors une menace pour les écosystèmes dans lesquels ils vivent et des mesures drastiques, pouvant aller jusqu’à l’exclusion, peuvent être prises[486]. La vision est réductrice et dangereuse. Réductrice car, comme on le sait, les communautés locales et peuples autochtones n’agissent pas toujours comme de « sages intendants de l’environnement »[487]. Dangereuse, car elle condamne toute évolution et adaptation, et leur dénie même tout agentivité[488]. Surtout, le mythe ne permet pas de poser la bonne question, qui n’est pas de savoir si les peuples autochtones et communautés locales sont des « natural conservationists »[489], mais plutôt ce qu’il faut entendre par « conservation » de la biodiversité – question qui engage directement, comme Posey l’avait bien relevé, les visions du monde :
[…] the concepts of biodiversity and conservation are not indigenous and, indeed, are alien to Indigenous peoples. This does not mean they do not respect and foster living things, but rather that nature is an extension of society. Thus, biodiversity is not an object to be conserved. It is an integral part of human existence, in which utilization is part of the celebration of life.
[…]
The problem then is not one of whether indigenous and traditional peoples are or are not “natural conservationists”, but rather who (and how) are we to judge them? Different world-views make such judgements tenuous at best. And besides, whose scientific measuring stick is to be used to make the judgements? There are, for example, no universal, nor even standardized, indicators of sustainability, nor universal agreement on how to define, measure or monitor biodiversity. And what are the criteria for judging environmental health? And healthy environments for whom?[490].
81.— Dans certains endroits du monde, pour certains peuples ou communautés, la conservation de la biodiversité signifie la lutte contre les projets de développement impliquant des destructions à grande échelle (centrales hydroélectriques, projets miniers, infrastructures routières, etc.) et le maintien de niveaux « acceptables » de biodiversité n’empêchant pas la pratique de l’agriculture itinérante (abattis‑brûlis ou écorchage des arbres) destinée au marché, l’élevage de bovin, la coupe sélective pour le commerce, ainsi que la chasse de subsistance ou commerciale[491]. Certaines de ces activités permettent de conserver une partie de la composition, des fonctions et processus écologiques des systèmes biologiques à un ou plusieurs niveaux d’organisation, mais sans prévenir des phénomènes d’érosion et des atteintes, par endroits ou à certains niveaux, à la diversité du vivant[492]. Ailleurs, notamment chez les populations locales conservant des sites sacrés naturels, on pourra observer des pratiques qui « more closely match the broader goals espoused by many conservationists which recognize that most of the world’s biodiversity is found, and will continue to be found, in landscapes occupied by people »[493]. Ces deux visions de la conservation de la biodiversité, volontairement contrastées[494], montrent que, en dehors des cas extrêmes de pratiques destructrices, il est difficile voire impossible de se prononcer sur l’adéquation d’une pratique ou d’un ensemble de pratiques sans disposer d’un standard (de « stewardship »)[495] – qui n’est jamais donné[496]. Mais comme on le perçoit peut-être mieux à cet endroit, le problème est mal posé : l’enjeu n’est pas de déférer à des savoirs experts, de mesurer et de mettre en ordre. L’enjeu est de regarder les pratiques et de questionner éventuellement ce que signifient les obligations éthiques pour ceux qui les suivent.
82.— Il ne faut toutefois pas faire preuve d’une naïveté excessive. Les « experts globaux »[497] ne tarderont pas à ouvrir leurs fichiers d’indicateurs et chercheront bien assez tôt à mesurer et mettre en ordre. Faute de mieux, suggérons-leur quelques saines directives : peuples autochtones et communautés locales doivent participer à leur élaboration[498], au cas par cas, en ne perdant jamais de vue que des arbitrages doivent en toutes circonstances être réalisés (fût-ce avec le droit à l’alimentation, à la santé ou avec les enjeux d’atténuation des changements climatiques)[499], que l’un des objectifs des droits bioculturels est de mieux protéger les peuples autochtones et les communautés locales, et que la diversité des modes de vie, des cultures, des pratiques et des cosmovisions est un bien qui mérite d’être préservé pour lui-même et pour son lien étroit à la biodiversité[500].
Retour en haut
[1] Cette recherche a été réalisée dans le cadre du projet « BioCulturalis » financé par l’ANR (n° ANR-18-CE03-0003-01) et dirigé par F. Girard.
[2] V., parmi une riche littérature, C. Voigt (dir.), Rule of Law for Nature. New Dimensions and Ideas in Environmental Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2013 ; J.R. May, E. Daly, Global Environmental Constitutionalism, Cambridge University Press, Cambridge, 2015 ; L.J. Kotze, « Human rights and the environment in the anthropocene », Anthr. Rev., 2014, 1, p. 1-24 ; P.E. Taylor, « From environmental to ecological human rights: A new dynamic in international law? », Geo. Int’l Envtl. L. Rev. 1998, Vol. 10, p. 309-397.
[3] Cf. Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation à la Convention sur la diversité biologique, Nagoya, 29 octobre 2010 (entrée en vigueur 12 octobre 2014), UNEP/CDB/COP/DEC/X1, 27 octobre 2010, art. 12, para. 1 et para. 3, art. 21(i)
[4] Cour constitutionnelle colombienne, 10 déc. 2016, Sentencia T-622/16.
[5] V. aussi, de cette opinion, G. Sajeva, When Rights Embrace Responsibilities. Biocultural Rights and the Conservation of Environment, Oxford University Press, New Delhi, 2018, p. 80.
[6] Il en a donné l’expression la plus complète dans sa thèse de doctorat : K.S. Bavikatte, Stewarding the Earth:rethinking property and the emergence of biocultural rights, Oxford University Press, New Delhi, 2014.
[7] G. Filoche, V° Droits bioculturels, in F. Collart Dutilleul, V. Pironon, A. Van Lang (dir.), Dictionnaire juridique des transitions écologiques, 1re éd., Institut Universitaire Varenne, Paris, 2018, p. xxxx
[8] La CDB vise les « communautés autochtones » et non les « peuples autochtones ». Les représentants des peuples autochtones ont toutefois obtenu un changement terminologique, plus conforme au droit international, à l’occasion de la COP XXII, puisqu’il a été décidé d’utiliser l’expression « peuples autochtones et communautés locales » dans les futures décisions et documents secondaires (CBD, XII/12, CONFÉRENCE DES PARTIES À LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉBIOLOGIQUE, Douzième réunion Pyeongchang (République de Corée), 6-17 octobre 2014, Article, 8j) et dispositions connexes, Point 19 de l’ordre du jourUNEP/CBD/COP/DEC/XII/12, 13 octobre 2014, p. 19). On utilisera parfois, dans les lignes qui suivent, l’expression générique de « populations locales » pour englober peuples autochtones et communautés locales.
[9] A. Bessa, « Traditional Local Communities: What Lessons Can Be Learnt at the International Level from the Experiences of Brazil and Scotland? », RECIEL 2015, 24(3), p. 330-340.
[10] V. infra, n° 72 et s.
[11] Cette notion est plus largement étudiée dans les parties 2 et 3 : v. infra, n° 63-82.
[12] Convention sur la diversité biologique, Rio de Janeiro, 5 juin 1992, (entrée en vigueur 29 décembre 1993), Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1760, p. 79, art. 8(j) (c’est nous qui soulignons).
[13] A. Cassese, Self-determination of Peoples: A Legal Reappraisal, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, p. 101 : « the right to authentic self-government, that is, the right for a people really and freely to choose its own political and economic regime – which is much more than choosing among what is on offer perhaps from one political or economic position only. It is an ongoing right ».
[14] À partir de K.S. Bavikatte, Stewarding the Earth, op. cit., p. 234.
[15] V., par exemple, le Pacte de la Société des Nations, Partie I du traité de Versailles de 1919, art. 22, qui considéraient les peuples autochtones comme des « peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne ». En conséquence, le « bien être et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation », la meilleure méthode pour l’accomplir étant « de confier la tutelle de ces peuples aux nations développées qui, en raison de leurs ressources, de leur expérience ou de leur position géographique, sont le mieux à même d’assumer cette responsabilité ». V., dans le même ordre d’idée, la Pan-American Union, Resolution XI adopted during the Eighth International Conference of American States held on 21 December 1938 : « That the indigenous populations, as descendants of the first inhabitants of the lands which today form America, and in order to offset the deficiency in their physical and intellectual development, have a preferential right to the protection of the public authorities ». Plus loin, le texte ajoutait que ce droit préférentiel devait passer par leur « complete integration into the national life » des États existants (v. aussi : COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, Working Paper by the Chairperson-Rapporteur, Mrs. Erica-Irene A. Daes, on the concept of “indigenous people”, Distr. GENERAL E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2, 10 June 1996, para. 15)
[16] V. infra, n° 17-18.
[17] G. Filoche, V° Droits bioculturels, op. cit., p. xxx.
[18] A. Grear, « The closures of legal subjectivity: why examining “law’s person” is critical to an understanding of injustice in an age of climate crisis », in A. Grear, L.J. Kotzé (dir.), Research Handbook on Human Rights and the Environment, Edwar Elgar, Cheltenham, Northampton, MA, 2015, p. 79-101 ; R. Youatt, « Personhood and the Rights of Nature : The New Subjects of Contemporary Earth Politics », International Political Sociology, 2017, Vol. 11, p. 39-54.
[19] Comp. J.-B. Harelimana, La défragmentation du droit international de la culture. Vers une cohérence des normes internationales, L’Harmattan, Paris, 2016.
[20] V. supra, n° 3.
[21] Entretien semi-directif n° 1-2019-WP3-Natural-Justice (matériel recueilli par Reia Anquet dans le cadre du projet ANR “Bioculturalis”, n° ANR-18-CE03-0003-01).
[22] S’agissant de la place de Posey chez K. Bavikatte, v. Stewarding the earth: rethinking property and the emergence of biocultural rights, op. cit., p. 234-235 : « Posey inspired an entire generation of anthropologists and community activists to begin mapping the role of cultures of indigenous peoples and local communities in ensuring biodiversity. He was one of the first to highlight the need for a bundle of rights approach to conservation that would reflect the integrated nature of community life ». L’influence de Posey est beaucoup plus marquée chez deux auteurs qui ont aussi souvent pris la plume avec Kabir S. Bavikatte, à savoir Harry Jonas et Holly Shrumm (Recalling Traditional Resources Rights: An Integrated Approach to Biocultural Diversity, Natural Justice, Malaisie, 2012).
[23] FAO, Engagement international (EI) sur les ressources phytogénétiques (Résolution 8/83), art. 1er : « Cet Engagement se fonde sur le principe universellement accepté selon lequel les ressources phytogénétiques sont le patrimoine commun de l’humanité et devraient donc être accessibles sans restriction ».
[24] Cf. F. Girard, « Semences et agrobiodiversité : pour une lecture ontologique des bio-communs locaux », Développement durable et territoires [Online], Vol. 10, n°1 | Avril 2019, http://journals.openedition.org/developpementdurable/13339 ; DOI : 10.4000/developpementdurable.13339.
[25] Comme durant la période antérieure à l’Engagement international, l’utilisation sans contrepartie des ressources génétiques pour le développement de nouvelles technologies était jugée équivaloir, pour le fournisseur de la ressource, à « transférer la valeur d’usage du germoplasme au receveur, sans saisir l’opportunité de taxer ce que les économistes appellent la ‘rente de situation’ qui s’attache au contrôle monopolistique sur la ressource » (J.K. Kloppenburg, First the seed, 2e édition, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, p. 188). S’ajoutait également une forme d’injustice sociale : la large adoption des variétés commerciales par de petits agriculteurs à faible revenu était en effet de nature à ébranler les systèmes semenciers traditionnels dont les agriculteurs dans les PED tirent indépendance et résilience (O. De Schutter, « The Right of Everyone to Enjoy the Benefits of Scientific Progress and the Right to Food : From Conflict to Complementarity », Human Rights Quarterly, 2011, Vol. 33(2), p. 304-350, spéc. p. 312-313).
[26] C’est ce qu’accomplit notamment l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC, Annexe 1 C de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech, au Maroc, le 15 avril 1994), dont l’article 27, para. 1, impose aux États de reconnaître la brevetabilité de « […] toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle ».
[27] CDB, Préambule.
[28] Cf. R.-J. Dupuy, « Droit déclaratoire et droit programmatoire : de la coutume sauvage à la “soft law” », SFDI, L’élaboration du droit international public, Colloque de Toulouse, Pedone, Paris, 1975, p. 132-148.
[29] On peut signaler l’exception notable qu’a constituée le cadre mis en place par la Communauté Andine dès 1993 : Décision n° 345 sur le régime commun concernant la protection des droits des obtenteurs de variétés végétales (21 oct. 1993) et Décision n° 391 portant le régime commun de l’accès aux ressources génétiques (2 juill. 1996).
[30] Le texte ne dit rien de la manière dont les négociations doivent se conduire entre bioprospecteur (l’utilisateur final des ressources) et les communautés pour que ces dernières aient une bonne compréhension des enjeux de l’accord qu’elles sont en train de conclure et qu’elles ne se trouvent pas lésées : K.S. Bavikatte, H. Jonas, H. von Braun, « Traditional knowledge and economic development: The biocultural dimension », in S.M. Subramanian, B. Pisupati (dir.), Traditional knowledge in policy and practice: approaches to development and human well-being, United Nations University Press, Tokyo, New York, Paris, 2010, p. 294-326, spéc. p. 297. Le meilleur exemple de ce type de risque est fourni par le cas « San-Hoodia ». Sur lequel, S. Vermeylen, « Contextualizing “Fair” and “Equitable”: The San’s Reflections on the Hoodia Benefit-Sharing Agreement », Local Environment, 2007, Vol. 12(4), p. 423–436. V. aussi, R.Wynberg, « Making sense of access and benefit sharing in the rooibos industry : Towards a holistic, just and sustainable framing », South African Journal of Botany, 2017, Vol. 110, p. 39-51.
[31] V., toutefois, les remarques de L. Glowka, F. Burhenne-Guilmin, H. Synge, Guide de la Convention sur la diversité biologique, Environmental Policy and Law Paper No. 30, UICN, Gland, Cambridge, 1996, p. 78 (sous l’article 10(c) de la CDB).
[32] Ce terme est dû au chimiste américain Thomas Eisner (« Prospecting for Nature’s Chemical Riches », Issues in Science and Technology 1989, 6(2), p. 31-34). Kabir S. Bavikatte et Daniel Robinson (« Towards a people’s history of the law: Biocultural jurisprudence and the Nagoya Protocol on access and benefit sharing », LEADS 2011, 7(1), p. 35-51, spéc. p. 38) rappellent que la bioprospection s’est fondée sur le récit, qui imprègne largement la CDB, d’une activité qui, bien conduite, bénéficie mutuellement aux populations locales – à travers le partage des avantages – et à l’humanité toute entière – à travers les inventions mises au point grâce à l’accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels associés.
[33] Le terme a, semble-t-il, été forgé par l’activiste canadien, Pat Mooney, cofondateur avec Cary Fowler du Rural Advancement Foundation International, ONG devenue ETC Group, dont il est l’actuel directeur exécutif. Il doit sa popularité à l’activiste indienne, Vandana Shiva, qui l’a largement mobilisé dans ses ouvrages de plaidoyer (Biopiracy: The Plunder of Nature and Knowledge, Green Books, The Gaia Foundation, Dartington). Cf. J.M. Alter, « International biopiracy versus the value of local knowlege », Capitalism Nature Socialism, 2000, 11(2), p. 59-66 ; S.B. Brush, « Bioprospecting the Public Domain », Cultural Anthropology, 1999, 14(4), p. 535-555.
[34] Sur la définition de la biopiraterie, v. I. Mgbeoji, Global Biopiracy: Patents, Plants, and Indigenous Knowledge, Cornell University Press Ithaca, NY, 2006, p. 13 : « unauthorized commercial use of biological resources and/or associated traditional knowledge, or the patenting of spurious inventions based on such knowledge, without compensation ». Le terme doit être utilisé avec rigueur, ce qui n’est pas toujours le cas : C. Hamilton, « Biodiversity, Biopiracy and Benefits: What Allegations of Biopiracy Tell Us About Intellectual Property », Developing World Bioethics, 2006, Vol. 6(3), p. 158–173.
[35] C.M. Correa, « Sui Generis Protection for Farmers’ Varieties », in M. Halewood (dir.), Farmers’ Crop Varieties and Farmers’ Rights. Challenges in Taxonomy and Law, London and New York: Routledge, p. 155-183, spéc. p. 165.
[36] T. Greaves, « Tribal Rights », in S. Brush and D. Stabinsky (dir.), Valuing Local Knowledge : Indigenous People and Intellectual Property, Island Press, Washington D.C., 1996, p. 25-40.
[37] T.B.G. Egziabher, « A case of community rights », in Tilahun, E. Sue (dir.), The Movement for Collective Intellectual Rights, The Institute for Sustainable Foundation/The Gaia Foundation, Addis Ababa, 1996, p. 1-51.
[38] F. Girard, « Composing the common world of the local bio-commons in the age of the Anthropocene », in F. Girard, C. Frison (dir.), The Commons, Plant Breeding and Agricultural Research. Challenges for Food Security and Agrobiodiversity, Routledge, Oxon, 2018, p. 117-144, spéc. p. 134-135.
[39] D.A. Posey, G. Dutfield, Beyond Intellectual Property. Toward Traditional Resource Rights for Indigenous Peoples and Local Communities, International Development Research Centre, Ottawa, 1996.
[40] K.S. Bavikatte, H. Jonas, H. von Braun, « Traditional knowledge and economic development: The biocultural dimension », in S.M. Subramanian, B. Pisupati (dir.), op. cit., p. 294-297.
[41] CDB, art. 8(j).
[42] Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Action 21 (Agenda 21), A/CONF.151/26/Rev.1(Vol. I), Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992, p. 7.
[43] Agenda 21, Principe 26.1.
[44] Agenda 21, Principe 26.3 (iii).
[45] Agenda 21, Principe 26.3 (iv).
[46] Assemblée générale des Nations Unies, Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, A/CONF.151/26 (Vol. I), 12 août 1992, p. 2.
[47] D.A. Posey, « Traditional Resources Rights – De facto self-determination for indigenous peoples », reproduit in K. Plenderleith (dir.), Indigenous Knowledge and Ethics, Routledge, 2004, New York, Oxon, p. 155-168, spéc. p. 163 : « The language of the Rio Declaration, CBD, and Agenda 21 is vague and will be moulded by future political and economic actions. Given that indigenous and traditional peoples are recognized as having special rights and benefits, and that economic livelihood is linked to development and conservation of natural resources, it is definitely worthwhile that energies and efforts be directed toward pushing the relevant sections in the direction of indigenous rights […] ».
[48] D.A. Posey, op. cit., p. 156.
[49] D.A. Posey, op. cit., p. 165.
[50] Sur cet aspect multiforme des ressources et savoirs, cf. F. Girard, « Semences et agrobiodiversité : pour une lecture ontologique des bio-communs locaux », op. cit.
[51] K.S. Bavikatte, H. Jonas, H. von Braun, « Traditional knowledge and economic development: The biocultural dimension », op. cit., p. 296 : « The market inalienability of certain rights is based on an understanding that certain aspects of personhood or community cannot and should not owe their recognition to whether or not they are market-efficient […]. On the contrary, they should be placed outside the realm of the market since they are integral to human flourishing and well-being ».
[52] D.A. Posey, « Traditional Resources Rights – De facto self-determination for indigenous peoples », op. cit., p. 156.
[53] D.A. Posey, op. cit., p. 156 : « Control over cultural, scientific, and intellectual property is de facto self‑determination, although only after rights to land and territory are secured by law and practice (i.e. boundaries are recognized, protected, and guaranteed by law ».
[54] Ibid.
[55] V. infra, n° 18, 43-44.
[56] D.A. Posey, G. Dutfield, Beyond Intellectual Property. Toward Traditional Resource Rights for Indigenous Peoples and Local Communities, op. cit., p. 95 : « TRR [traditional resources rights] is an integrated rights concept that recognizes the inextricable link between cultural and biological diversity and sees no contradiction between the human rights of indigenous and local communities, including the right to development and environmental conservation. Indeed, they are mutually supportive since the destiny of traditional peoples largely determines, and is determined by, the state of the world’s biological diversity. TRR includes overlapping and mutually supporting bundles of rights ».
[57] Comme le résume Kabir Bavikatte à propos de Posey: « He was one of the first to highlight the need for a bundle of rights approach to conservation that would reflect the integrated nature of community life » (Stewarding the earth: rethinking property and the emergence of biocultural rights, op. cit., p. 234-235).
[58] Giulia Sajeva rappelle que les « droits sur les ressources traditionnelles » étaient, dans l’esprit de Posey, avant tout destinés à protéger les communautés locales et les peuples autochtones. La protection de l’environnement n’apparaît que de manière médiate et instrumentale : c’est ce qui doit être préservé pour assurer la continuité de la communauté. Posey et Dutfield notent ainsi, dans leur ouvrage de 1996, que « [k]nowledge and traditional resources are central to the maintenance of identity for indigenous peoples. Therefore, control over these resources is of central concern in their struggle for self-determination » (D.A. Posey, G. Dutfield, Beyond Intellectual Property. Toward Traditional Resource Rights for Indigenous Peoples and Local Communities, op. cit., p. 95). À l’inverse, dans le modèle des droits bioculturels, la conservation de l’environnement constitue la fondation, et la protection des communautés locales et des peuples autochtones prend une dimension instrumentale (Sajeva, When Rights Embrace Responsibilities, op. cit., p. 99 ; v. aussi K.S. Bavikatte, Stewarding the Earth, op. cit., p. 235).
[59] Ils ont été décrits de manière détaillée par K.S. Bavikatte, T. Bennett, « Community Stewardship : the Foundation of Biocultural Rights », Journal of Human Rights and the Environment, Vol. 6(1), p. 7-29.
[60] A. Escobar, Sentir-penser avec la Terre, Seuil, Paris, 2018, p. 39.
[61] Sur laquelle, v., not. S.B. Brush, Farmers’ Bounty : Locating Crop Diversity in the Contemporary World, Yale University Press New Haven, Londres, 2004 ; J. Harwood, Europe’s green revolution and others since : The rise and fall of peasant-friendly plant breeding, Routledge, Abingdon, 2012.
[62] A. Escobar, op. cit., p. 40-41.
[63] Ibid. Quelques auteurs majeurs, dont les publications s’étirent entre les années 1970 et nos jours, en sont les principaux représentants : I. Illich, Libérer l’avenir, Seuil, Paris, 1971 ; La Convivialité, Seuil, Paris, 1973 ; E.F. Schumarcher, Small is Beautiful: Economics as if People Mattered, Blond and Briggs, Londres, 1973 ; G. Esteva, Madhu Suri Prakash, Grassroots Post-modernism: Remaking the Soil of Culture, Zed Books, Londres, 1998 ; A. Escobar, Encountering Development: the Making and Unmaking of the Third World, Princeton University Press, Princeton, 2012
[64] Op. cit., p. 44.
[65] Dont les conséquences ont été dénoncées avec constance et vigueur par l’activiste indienne, Vandana Shiva. V. par ex. Monocultures of the Mind, Third World Network, Penang, 1993.
[66] Sur les raisons de cette prise de conscience, v. R.H. Grove, Green Imperialism. Colonial Expansion, Tropical Island Edens and the Origins of Environmentalism, 1600-1860, Cambridge University Press, 1995, p. 3, 12.
[67] R.H. Grove, op. cit., p. 12 ; R.H. Grove, « Colonial conservation, ecological hegemony and popular resistance: Towards a global synthesis », in J. Mackenzie (dir.), Imperialism and the natural world, Manchester University Press, Manchester, 1990, p. 15-51.
[68] A.A. Doolittle, V° Fortress conservation, in P. Robbins (dir.), Encyclopedia of Environment and Society, Sage, Thousand Oaks, Londres, 2007, p. 704-705.
[69] W.M. Adams, « Nature and the Colonial Mind », in W.M. Adams and M. Mulligan (dir.), Decolonizing Nature: Strategies for Conservation in Post-Colonial Era, Londres, Sterling, VA, Earthscan, p. 15-50, spéc. p. 30.
[70] G. Sajeva, op. cit., p. 62.
[71] UNGA, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les droits des peuples autochtones, Victoria Tauli-Corpuz, Vol. 1/71/229, 29 juillet 2016, p. 7, qui souligne qu’environ 50% des aires protégées existantes ont été créées sur les terres et territoires traditionnellement détenus par les peuples autochtones.
[72] Mais il est loin d’avoir disparu ; cf. A.A. Doolittle, op. cit.
[73] V., par ex., M.R Freeman, « Graphs and gaffs: A cautionary tale in the common-property resources debate », in F. Berkes (dir.), Common Property Resources: Ecology and Community-Based Sustainable Development, Belhaven Press, Londres, 1989, p. 92-109.
[74] Dès les années 1980, un premier infléchissement important est apporté à la théorie du développement : la participation locale devient un axiome complémentaire (v. not. R. Chambers, Rural Development : Putting the Last First, Prentice Hall, London, 1983) et accompagne un mouvement de décentralisation. D’abord, l’effrondrement économique qu’ont connu beaucoup d’États africain à la fin des années 1970, et qui a été accompagné d’une perte de contrôle effectif des ressources naturelles, a conduit, presque par la force des choses, à privilégier une approche décentralisée de la gestion des ressources (v., en particulier, dans le cas de Madagascar : J. Pollini, N. Hockley, F.D. Muttenzer et B.S. Ramamonjisoa, « The Transfer of Natural Resource Management Rights to Local Communities », in I.R. Scales (dir.), Conservation and Environmental Management in Madagascar, Routledge, London, New York, 2014, p. 172-192, spéc. p. 173). Ensuite, on réalise que les approches « fences and fines » ont aussi un coût considérable, puisqu’au coût du déplacement des populations, s’ajoute, le cas échéant, celui qu’implique le développement de mécanismes de compensation et la fourniture de moyens alternatifs de subsistance (K.E. Brandon, M. Wells, « Planning for people and parks : design dilemmas », World Development, 1992, Vol. 20, p. 557-570.). Par ailleurs, en raison des résistances que ces approches provoquent chez les populations affectées, leur mise en œuvre (à travers, par ex., des dispositifs de contrôle) est généralement très coûteuse (A. Agrawal, C. Gibson, « Enchantment and Disenchantment: the Role of Community in Natural Resource Conservation », World Development, 1999, 27(4), p. 629-649).- V. aussi : S. Stevens (dir.), Indigenous Peoples, National Parks and Protected Areas: A New Paradigm Linking Conservation, Culture and Rights, University of Arizona Press, Tucson, 2014.
[75] V., en plus des travaux Milton M. R. Freeman (supra, note (73)) et Fikret Berkes (F. Berkes, « Rethinking Community-Based Conservation », Conservation Biology, 2004, 18(3), p. 621-630) : A. N Songorwa, « Community-Based Wildlife Management (CWM) in Tanzania: Are the Communities Interested? », World Development, 1999, Vol. 27(12), p. 2061-2079 ; K.M. Homewood, « Policy, environment and development in African rangelands », Environmental Science & Policy, 2004, Vol. 7, 125–143.
[76] D.A. Posey, « Introduction: Culture and Nature – The Inextricable Link », in D.A. Posey, Cultural and Spiritual Values of Biodiversity, United Nations Environment Programme, Londres, 1999, p. 1-18.
[77] On doit semble-t-il le terme à Luisa Maffi, dont les travaux reçoivent une attention particulière à compter de sa participation à l’ouvrage collectif dirigé par Posey en 1999 (L. Maffi, « Linguistic Diversity », in D.A. Posey, Cultural and Spiritual Values of Biodiversity, op. cit., p. 19-57). Pour Maffi, « [t]he diversity of life is made up not only of the diversity of plants and animal species, habitats and ecosystems found on the planet, but also of the diversity of human cultures and languages.– These diversities do not exist in separate and parallel realms, but rather are different manifestations of a single, complex whole.– The links among these diversities have developed over time through the cumulative global effects of mutual adaptations, probably of a co-evolutionary nature, between humans and the environment at the local level » (L. Maffi, « Introduction », in L. Maffi et E. Woodley (dir.), Biocultural Diversity Conservation: A Global Sourcebook, Earthscan, London, Washington, DC, 2010, p. 5‑6).
[78] On sait, par exemple, que les territoires des peuples autochtones représentent, selon les estimations les plus faibles, 22% de la planète, mais ils contiennent 80% de la biodiversité totale (v. C. Sobrevila, The Role of Indigenous Peoples in Biodiversity Conservation: the Naturel but Often Forgotten Partners, The International Bank for Reconstruction and Development, Washington, DC, 2008).
[79] L. Maffi, « Biocultural Approach to Conservation and Development », in L. Maffi et D. Ortixia (dir.), Biocultural Diversity Toolkit, Terralingua, 2014, p. 4 ; v. aussi L. Maffi, « Introduction », op. cit., p. 4.
[80] D.A. Posey, « Introduction: Culture and Nature – The Inextricable Link, », in D.A. Posey, Cultural and Spiritual Values of Biodiversity, op. cit., p. 4-5. La plupart des études de ce recueil sont d’ailleurs une description du fondement et du fonctionnement de ce rôle d’intendance. On revient longuement sur l’intendance infra, n° 72 et s.
[81] Caracas, VE, 10-21 February 1992, 1992-02-10. V. infra, n° 30.
[82] IUCN – The World Conservation Union, Benefits Beyond Boundaries: Proceedings of the Vth IUCN World Parks Congress: Durban, South Africa, 8-17 September 2003, IUCN, Gland, Cambridge, 2005, p. 3 : « clear and strong message from the Congress was that indigenous peoples and local communities have to be more effectively involved in protected areas and that, specifically, the rights of indigenous peoples – including mobile indigenous peoples – must be fully respected. The involvement of indigenous peoples and local communities in PA management has increased during the past decade but there is still a long way to go. This is particularly important as many live in areas of exceptionally high biodiversity. The international community has acknowledged the vital role of indigenous peoples in the achievement of sustainable development and has also recognised the value and importance of their special knowledge in managing natural and modified landscapes and resources, specific sites, species, sacred areas and burial grounds ».
[83] Le propos se limite ici à évaluer l’apport de l’École de Bloomington, telle qu’elle s’est développée à partir des travaux d’Ostrom. On y inclut les travaux des néo-institutionnalistes, les représentants de la « science de la durabilité », ainsi que les théoriciens des systèmes socio-écologiques. On exclut l’approche dite des « biens communs », qui s’intéresse d’abord et avant tout à la conception d’une propriété individuelle plus « inclusive », ce qui intègre les travaux sur l’« open source » (J. Rochfeld, « Quel modèle pour construire des “communs” ? », in B. Parance, J. de Saint Victor (dir.), Repenser les biens communs, CNRS éd., Paris, 2014, p. 103-128, spéc. n° 17, p. 122-123; G. Van Overwalle, « Exclusive Ownership Versus Open Commons : The Case of Gene Patents », W.I.P.O.J, 2013, Vol. 4(2), p. 139-156), ainsi que le courant italien des « beni comuni » : S. Rodotà, « Vers les biens communs. Souveraineté et propriété au XXIe siècle », Tracés, 16/2016 ; A. Quarta, M. Spanò, Beni comuni 2.0. Contro-egemonia e nuove istituzioni, Mimesis, Milan-Udine 2016.
[84] Sur cet aspect et le contexte particulier de son œuvre et de celle d’Ostrom : F. Locher, « Third World Pastures. The Historical Roots of the Commons Paradigm (1965-1990) », Quaderni Storici, 2016/1, p. 303-333 ; « Historicizing Elinor Ostrom: Urban Politics, International Development and Expertise in U.S. Context (1970-1990) », Theoretical Inquiries in Law, Vol. 19(2), 2018, p. 533-558.
[85] G. Hardin, « The Tragedy of the Commons », Science, 1968, Vol. 162, p. 1243-1248.
[86] Frank van Laerhoven, Elinor Ostrom, « Traditions and Trends in the Study of the Commons », International Journal of the Commons, 2007, Vol. 1(1), p. 3-28.
[87] G. Hardin, « The Tragedy of the Commons », op. cit., p. 1244.
[88] S. von Ciriacy-Wantrup, R.C. Bishop, « Common property as a concept in natural resource policy », Natural Resource Journal, 1975, Vol. 15, p. 713-727.
[89] C’est ce qui bien été décrit dans le cas de l’Inde : « The state dominion and imperium approach had profound implications both physical—in terms of the use and abuse of the resource base, and social—in terms of the alienation, protest and conflict it engendered amongst forest dwellers. The devaluation of cultural, social rights to hold land in community with others led to the conversion of a well-organized culturally defined common property regime into an open access system » (L. Rajamani, « Community Based Property Rights and Resource Conservation in India’s Forests », op. cit., p. 457). V. aussi : J. Pollini et al., « The Transfer of Natural Resource Management Rights to Local Communities », in I.R. Scales (dir.), Conservation and Environmental Management in Madagascar, Routledge, London, New York, 2014, p. 172-192, spéc. p. 173 : « Following the economic collapse of the late 1970s […], state control over access to natural resources became weak or non-existent. According to Bertrand et al. (2009), in some areas decades of state intervention had weakened customary institutions to the point that when the state collapsed, noting remained to control access to natural resources. This often led to a situation of open access […]. Similar histories have been observed in many developing countries, where land tenure rights often became more rather the less centralized after independence from European powers […] ». V. encore J. Weber, « L’occupation humaine des aires protégées à Madagascar : diagnostic et éléments pour une gestion viable », Nature Sciences Sociétés, 1995, Vol. 3, p. 157-164. S’agissant de Madagascar, cette lecture a été contestée par F. Muttenzer, Déforestation et droit coutumier à Madagascar. Les perceptions des acteurs de la gestion communautaire des forêts, Karthala, Paris, 2010.
[90] Il ne faut pas oublier que la théorie des communs est avant tout bâtie sur l’idée d’un substrat : les common pool resources. Il s’agit des systèmes ou architectures de ressources « naturelles » (par ex., ressources halieutiques d’un lac, gibier d’une forêt) ou « faites par l’homme » (ce qui permet d’inclure, par ex., des systèmes d’irrigation) dont la spécificité est qu’il est très difficile, voire impossible d’exclure des prétendants de leur accès ou de leur bénéfice. À cette première caractéristique, appelée en économie la non-excluabilité, s’ajoute une seconde : les ressources en question sont rivales, ce qui veut dire que si la variable de flux (le prélèvement) dépasse la variable de stock (ce qui fait le cœur de la ressource), alors la ressource finit par s’épuiser. En cela, les common pool resources s’inscrivent dans une zone intermédiaire entre les biens privés et les biens publics (purs).
[91] E. Ostrom, « A Multi-Scale Approach to Coping with Climate Change and Other Collective Action Problems », Solutions 2010, Vol. 1(2), p. 27-36.
[92] E. Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, Cambridge, New York, 1999. Les principaux principes sont les suivants : Existence de limites clairement définies ; Adaptation aux conditions locales ; Existence de dispositifs de choix collectifs ; Existence de modalités de surveillance du comportement des utilisateurs ; Existence d’un système gradué de sanctions ; Existence de mécanismes de résolution des conflits rapides et peu coûteux ; Autodétermination minimale reconnue par les autorités extérieures.
[93] V., par ex. E. Ostrom, « A diagnostic approach for going beyond panaceas », PNAS September 25, 2007, Vol. 104(39), p. 15181-15187.
[94] I. Watson (dir.), Indigenous Peoples as Subjects of International Law, Routledge, Oxon, New York, 2017.
[95] Convention concernant la protection et l’intégration des populations aborigènes et autres populations tribales et semi-tribales dans les pays indépendants, Genève, 40e session CIT (26 juin 1957) (Entrée en vigueur: 02 juin 1959).
[96] S.J. Anaya, Indigenous Peoples in International Law, Oxford University Press, Oxford, New York, 2000, p. 44. Il poursuit (ibid.) : « [t]he thrust of Convention No. 107 of 1957, accordingly, is to promote improved social and economic conditions for indigenous populations generally, but within a perceptual scheme that does not seem to envisage a place in the long term for robust, politically significant cultural and associational patterns of indigenous groups. Convention No. 107 is framed in terms of members of indigenous populations and their rights as equals within the larger society. Indigenous peoples or groups as such are only secondarily, if at all, made beneficiaries of rights or protections. The convention does recognize indigenous customary laws and the right of collective land ownership ».
[97] S.J. Anaya, op. cit., p. 46.- V. aussi, plus largement, sur cette période : F. Wilmer, The Indigenous Voice in World Politics: Since Time Immemorial, Sage, Newbury Park, Londres, 1993.
[98] S.J. Anaya, op. cit., p. 46.
[99] Convention concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, Genève, 76e session CIT (27 juin 1989) (Entrée en vigueur: 05 sept. 1991).
[100] Le Convention définit les peuples « tribaux » comme les populations « dans les pays indépendants qui se distinguent des autres secteurs de la communauté nationale par leurs conditions sociales, culturelles et économiques et qui sont régis totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale » (art. 1(1)(a)). Quant aux peuples indigènes, il s’agit des peuples qui, dans les pays indépendants, sont considérés comme indigènes parce qu’ils « descendent des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à laquelle appartient le pays, à l’époque de la conquête ou de la colonisation ou de l’établissement des frontières actuelles de l’État, et qui, quel que soit leur statut juridique, conservent leurs institutions sociales, économiques, culturelles et politiques propres ou certaines d’entre elles ». Le sentiment d’appartenance, « indigène » ou « tribale », est le critère fondamental dans la délimitation des deux catégories (art. 1(2)).
[101] C’est nous qui soulignons.
[102] Convention n° 169 de l’OIT, art. 13(1).
[103] Convention n° 169 de l’OIT, art. 14(1). Le même article ajoute qu’une attention toute particulière doit être portée, à cet égard, à la situation des peuples nomades et des agriculteurs itinérants.
[104] Convention n° 169 de l’OIT, art. 15(1).
[105] Convention n° 169 de l’OIT, art. 4(1).
[106] Convention n° 169 de l’OIT, art. 5(a).
[107] Convention n° 169 de l’OIT, art. 5(b).
[108] Convention n° 169 de l’OIT, art. 8(2).
[109] V. infra, n° 28-29.
[110] Résolution adoptée par l’Assemblée générale, 61/295
[111] Cf. C. Lennox, D. Short (dir.), Handbook of Indigenous Peoples’ Rights, Routledge, Abingdon, New York, 2016, spéc. chapitres 25 (Asie), 26 (Afrique), 27 (Amérique latine) et 28 (pays Nordiques). Concernant le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis (dits États « CANZUS »), cf. K. Gover, « Settler–State Political Theory, “CANZUS” and the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples », European Journal of International Law, 2015, Vol. 26(2), p. 345–373.
[112] V. infra, n° 49 et s.
[113] Nettement de cette opinion, J. Amaya, S. Wiessner, « The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples : Towards Re-empowerment », Jurist, 3 octobre 2007, https://www.jurist.org/commentary/2007/10/un-declaration-on-rights-of-indigenous-2/ ; pour une appréciation critique, S. Allen, « The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and the Limits of the International Legal Project », in Stephen Allen, A. Xanthaki (dir.), Reflections on the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and International Law, Hart Publishing, 2011, p. 225-258, spéc. p. 225.
[114] Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 19 décembre 2011, Soixante sixième session Point 66, a, de l’ordre du jour, A/RES/66/142, Distr. générale, 30 mars 2012, 61/295, Préambule.
[115] V. supra, n° 3, 8.
[116] V. infra, n° 41-46.
[117] K.S. Bavikatte, Stewarding the earth, op. cit.
[118] G. Sajeva, When Rights Embrace Responsibilities, op. cit., p. 80 : « The concept of biocultural rights is more than an opinio de iure condendo. It is the result of legal argumentation which waves an imaginary wire that connects heterogeneous facts and words that have developed and are developing in the rhetoric, treaties, declarations, and court decisions concerning indigenous peoples and local communities and conservation of the environment. His voice is the voice of the doctrine, of a public law scholar who sees a coherent and rational, though implicit, design in international documents, and his hope is that by telling and retelling the story of biocultural rights, and through the elaboration of doctrines and theories, “biocultural rights will come alive” ».
[119] K.S. Bavikatte, op. cit., p. 2.
[120] Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, Transmitted to the General Assembly as an Annex to document A/42/427 – Development and International Co-operation: Environment, 1987 (version française : https://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/5/rapport_brundtland.pdf).
[121] Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, op. cit., : « L’isolement de bon nombre de ces populations signifie qu’elles ont conservé un mode de vie traditionnel en étroite harmonie avec l’environnement naturel. Leur survie même a dépendu de leur prise de conscience de l’écologie et de la manière dont elles s’y sont adaptées. Mais la contrepartie de leur isolement est que peu d’entre elles ont profité du développement économique et social du pays. Cette situation peut se refléter dans la médiocrité de leur santé, de leur nutrition et de leur éducation » (para. 71). Au paragraphe 74, le rapport ajoutait : « Ces communautés sont les dépositaires d’un riche patrimoine de connaissances et d’expériences traditionnelles qui rattachent l’humanité à ses origines lointaines. Leur disparition est une perte pour toute la société, qui aurait beaucoup à apprendre de leur savoir-faire traditionnel à gérer rationnellement les systèmes écologiques très complexes ».
[122] Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, op. cit., para. 75.
[123] K.S. Bavikatte, D. Robinson, « Towards a people’s history of the law: Biocultural jurisprudence and the Nagoya Protocol on access and benefit sharing », op. cit., p. 50.
[124] Assemblée générale des Nations Unies, Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, A/CONF.151/26 (Vol. I), 12 août 1992 (ci-après : Déclaration de Rio).
[125] Déclaration de Rio, Principe 22.
[126] Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Action 21 (Agenda 21), A/CONF.151/26/Rev.1(Vol. I), Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992, para. 26.1, 26.3 et 26.4.
[127] Convention sur la Diversité Biologique, Rio de Janeiro, 5 juin 1992 (entrée en vigueur le 29 décembre 1993).
[128] CDB, art. 8(j) et 10(c).
[129] V. supra, n° 11.
[130] CDB, art. 3.
[131] L. Glowka, F. Burhenne-Guilmin, H. Synge, Guide de la Convention sur la diversité biologique, op. cit., p. 12 : « L’usage du mot “leurs” ne se rapporte pas ici à des droits de propriété: il s’agit plutôt d’un moyen de faire référence, d’une manière abrégée, aux ressources biologiques relevant de la juridiction de tel ou tel État ».
[132] C’est nous qui soulignons.
[133] Cf. J. Foyer, A. Viard-Crétat, V. Boisvert, « Néolibéraliser sans marchandiser ? La bioprospection et les mécanismes REDD dans l’économie de la promesse », in D. Compagnon, E. Rodary (dir.), Les politiques de biodiversité, Presses de Sciences Po, Paris, p. 225-249.
[134] K.S. Bavikatte, D.F. Robinson, « Towards a people’s history of the law…», op. cit., p. 38-39. V. aussi, supra, n° 11.
[135] D. Posey, « Indigenous peoples and Traditional Resource Rights. A base for equitable relationships? », reproduit in K. Plenderleith (dir.), op. cit., p. 172-194, spéc. p. 173.
[136] Dans une logique dite « propriétaire », la philosophie sous-jacente est que « la conversion de la biodiversité en une activité rentable » est « […] le moyen le plus sûr de promouvoir la préservation des écosystèmes et des espèces qu’ils supportent » (V. Boisvert, A. Caron, « The convention on biological diversity : an institutionalist perspective of the debates », Journal of Economic Issues, 2002, 36 (1), p. 151-166, p. 153). C’est, en d’autres termes, la promesse que l’établissement de « droits individuels ou collectif de propriété sur les ressources génétiques a un important effet incitatif sur la sélection ainsi que la conservation et l’utilisation durable » de la diversité. Par ailleurs, en reconnaissant de tels droits, on gage que les titulaires pourront échanger leurs ressources sur le marché et bénéficier du partage des avantages (v. R. Andersen, Governing Agrobiodiversity: Plant Genetics and Developing Countries, Ashgate, Aldershot, 2016 [2008], p. 141).
[137] Sur le droit au développement et la protection de la biodiversité, cf. T. Eisner, « Prospecting for nature’s chemical riches », Issues in Science and Technology, 1990, 6(2), p. 31-34 ; W. Reid et al. (dir.), Biodiversity Prospecting: Using Genetic Resources for Sustainable Development, WRI, Washington, DC, 1993.
[138] Topique est, en ce sens, la Déclaration de Stockholm, proclamée à l’issue de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, du 5 au 16 juin 1972, qui exprime, Principe 9, la « conviction commune » que les déficiences de l’environnement sont aussi imputables à des conditions de sous-développement et que le meilleur moyen d’y remédier est « d’accélérer le développement par le transfert d’une aide financière et technique substantielle pour compléter l’effort national des pays en voie de développement et l’assistance fournie en tant que besoin ».
[139] V. aussi : R. Andersen, « “Stewardship” or “ownership”: how to realise Farmers’ Rights? », in D. Hunter, L. Guarino, C. Spillane, P. McKeown (dir.), Routledge Handbook of Agricultural Biodiversity, Routledge, Oxon, 2017, p. 449-470.
[140] V., par exemple, la Recommandation 6 du Caracas Action Plan 1992, adopté lors de la 4e édition du Congrès Mondial des Parcs de l’UICN (Caracas, VE, 10-21 February 1992, 1992-02-10) : « Human communities, especially those living in and around protected areas, often have important and long-standing relationships with those areas. Local and indigenous communities may depend on the resources of these areas for their livelihood and cultural survival. Increasingly, the resources which justify establishment of protected areas include cultural landscapes and adapted natural systems created by long-established human activity. These relationships embrace cultural identity, spirituality and subsistence practices, which frequently contribute to the maintenance of biological diversity. […] In many cases, the continuation and development of human activities in protected areas should be accepted, insofar as they are compatible with conservation objectives » (v. J.A. McNeely (dir.), Parks for life: report of the fourth World Congress on National Parks and Protected Areas, 10-21 February 1992, IUCN, Protected Areas Programme; WWF, IUCN, Gland, 1993, p. 35).
[141] Selon le texte, cette catégorie d’aire protégée doit être « free of significant direct intervention by modern humans that would compromise the specified conservation objectives for the area » (IUCN, Guidelines for Protected Area Management Categories. CNPPA with the assistance of WCMC, IUCN, Gland, Cambridge, UK, 1994). V. désormais, les lignes directrices révisées : N. Dudley (dir.), Lignes directrices pour l’application des catégories de gestion aux aires protégées, UICN, Gland, 2008 : https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAPS-016-Fr.pdf. La catégorie « Ia » est toujours la « Réserve naturelle intégrale » (« Strict nature reserve »). Là encore, le texte admet la présence humaine, mais dans des conditions très strictes : « L’aire pourrait avoir une importance religieuse ou spirituelle (comme un site naturel sacré) pour autant que la conservation de la biodiversité soit identifiée comme un objectif premier. Dans ce cas, l’aire peut contenir des sites qui peuvent être visités par un nombre limité de personnes engagées dans des activités liées à leurs croyances et qui respectent les objectifs de la gestion de l’aire ».
[142] TIRPAA, Rome 03/11/2001 (entrée en vigueur 29 juin 2004), Recueil 2400 (p. 303).
[143] TIRPAA, Préambule.
[144] Les RPGAA sont une sous-catégorie de ressources génétiques. Selon le TIRPAA (art. 2), il s’agit du « matériel génétique d’origine végétale ayant une valeur effective ou potentielle pour l’alimentation et l’agriculture ».
[145] FAO, Resolution 5/89, Farmer’s Rights (Adopted 29 November 1989), Report of the Conference of FAO Twenty-fifth Session, Rome, 11-29 November 1989, para. 108. La catégorie apparaît pour la première fois dans autre résolution du même jour : FAO, Resolution 4/89 Agreed Interpretation of the International Undertaking (Adopted 29 November 1989), Report of the Conference of FAO Twenty-fifth Session, Rome, 11-29 November 1989, para. 108.
[146] V. aussi, C.M. Correa, Concrétiser le droit des agriculteurs relatif à l’utilisation des semences, Document de recherche n° 75, Centre Sud, Genève, 2017, https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2017/09/RP75_Implementing-Farmers-Rights-Relating-to-Seeds_FR.pdf, p. 3-4 ; K. Peschard, « Seed wars and farmers’ rights: comparative perspectives from Brazil and India », The Journal of Peasant Studies, 2017, 44(1), p. 144-168 ; M. Halewood (dir.), Farmers’ Crop Varieties and Farmers’ Rights: Challenges in Taxonomy and Law, Routledge, Routledge, London, New York, 2016.
[147] TIRPAA, art. 9.1.
[148] TIRPAA, art. 9.2(a).
[149] TIRPAA, art. 9.3 (c’est nous qui. soulignons). Une nouvelle fois, la stipulation est particulièrement restrictive, puisque le droit est reconnu « sous réserve des dispositions de la législation nationale et selon qu’il convient ». Sur l’importance du droit de conserver, d’utiliser, d’échanger et de vendre des semences, cf. F. Girard, « Composing the Common World of the Local Bio-Commons », op. cit., p. 134.
[150] Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation à la Convention sur la diversité biologique, Nagoya, 29 octobre 2010 (entrée en vigueur 12 octobre 2014), UNEP/CDB/COP/DEC/X1, 27 octobre 2010.
[151] C’est à travers son rôle de conseil auprès du « groupe africain » qu’il a réussi à diffuser ces idées : K.S. Bavikatte, D. Robinson, « Towards a people’s history of the law: Biocultural jurisprudence and the Nagoya Protocol on access and benefit sharing », op. cit. ; Entretien semi-directif n° 1-2019-WP3.
[152] Il ne faut pas non plus sous-estimer l’influence de la Loi-Modèle de l’OUA pour la protection des droits des communautés locales, des agriculteurs et des sélectionneurs et la réglementation de l’accès aux ressources biologiques, préparée en 1997 par ce qui est devenu l’Union Africaine et des Lignes directrices Akwé: Kon, adoptées lors de la CdP-7 en 2004 (CONFERENCE OF THE PARTIES TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY, Seventh meeting Kuala Lumpur, 9-20 and 27 February 2004, Agenda item 19.8, UNEP/CBD/COP/DEC/VII/16 13 April 2004, decision VII/16F) (v. K.S. Bavikatte, T. Bennett, « Community stewardship : the foundation of biocultural rights », Journal of Human Rights and the Environment, 2015, Vol. 6(1), p. 7-29, spéc. p. 25 ; K.S. Bavikatte, H. Jonas et H. von Braun, « Traditional knowledge and economic development: The biocultural dimension », in S.M. Subramanian et B. Pisupati (dir.), op. cit., p. 308-311. Sur la Loi-Modèle, cf. M.-A. Hermitte, « L’intégration des pays en développement dans la mondialisation par l’adaptation du droit de la propriété intellectuelle. Analyse de la loi-modèle de l’OUA », in M.-A. Hermitte, Ph. Kahn (dir.), Les ressources génétiques et le droit dans les rapports Nord-Sud, Bruylant, Bruxelles, 2004, p. 293 et s.).
[153] Sur lesquels, Natural Justice (dir.), Biocultural Community Protocols: A toolkit for community facilitators, Natural Justice, Cape Town, 2012 ; L. Parks, « Challenging power from the bottom up? Community protocols, benefit-sharing, and the challenge of dominant discourses », Geoforum, 2018, Vol. 88, p. 87-95 ; N.A. Delgado, « Community Protocols as Tools for Resisting Exclusion in Global Environmental Governance », Revista de Administração de Empresas, 2016, Vol. 56(4), p. 395-410.
[154] R. Chandra, The Cunning of Rights: Law, Life, Biocultures, Oxford University Press, Oxford, 2016, p. 92.
[155] G. Sajeva, When Rights Embrace Responsibilities, op. cit., p. 83.
[156] Protocole de Nagoya, Préambule ; CDB, art. 3.
[157] Protocole de Nagoya, art. 7 : « Conformément à son droit interne, chaque Partie prend, selon qu’il convient, les mesures appropriées pour faire en sorte que l’accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques détenues par les communautés autochtones et locales soit soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause ou à l’accord et à la participation de ces communautés autochtones et locales, et que des conditions convenues d’un commun accord soient établie ».
[158] Protocole de Nagoya, art. 6.2 : « Conformément à son droit interne, chaque Partie prend, selon qu’il convient, les mesures nécessaires pour s’assurer que le consentement préalable donné en connaissance de cause ou l’accord et la participation des communautés autochtones et locales sont obtenus pour l’accès aux ressources génétiques, dès lors que leur droit d’accorder l’accès à ces ressources est établi ».
[159] Pour les ressources génétiques, la première limitation tient à ce que l’obligation que l’article 6 met à la charge des États suppose que le droit des communautés « d’accorder l’accès à ces ressources [soit] établi ». Deux interprétations sont évidemment possibles. Selon la première, étroite, le terme « établi » renvoie uniquement à des situations où une communauté particulière peut démontrer que ses droits sur les ressources génétiques sont établis par la législation nationale, ce qui donne toute latitude à l’État pour développer ou non des procédures locales de consentement préalable et informé et de partage des avantages. Une autre interprétation, large cette fois-ci, est toutefois possible, et elle paraît devoir être privilégiée, à la fois au regard des objectifs du Protocole et des standards de droit international des droits de l’homme, en raison aussi de la profonde interdépendance entre ressources génétiques et savoirs traditionnels qui ne sauraient donc être soumis à des régimes distincts. En vertu de cette lecture, il y a « an obligation for Parties to map customary rights at the domestic level, in consultation with the concerned communities, provide for their legal recognition, and enact domestic measures to ensure community PIC in case communities’ customary rights are ascertained » (E. Morgera, E. Tsioumani, M. Buck, Unraveling the Nagoya Protocol. A Commentary on the Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing to the Convention on Biological Diversity, Brill, Leiden, Boston, 2015, p. 125). Seconde difficulté, même si le texte utilise une formulation impérative (« Conformément à son droit interne, chaque Partie prend <shall>, selon qu’il convient, les mesures nécessaires » – nous soulignons), il introduit une double réserve (« Conformément à son droit interne » et « selon qu’il convient ») qui ne laisse aucun doute quant à la volonté des Parties de conserver un pouvoir discrétionnaire dans la mise en place des procédures locales d’APA. Cela étant, on peut convenir avec la doctrine autorisée que, si les Parties conservent une certaine liberté dans le choix du type de mesures pour la mise en œuvre de l’obligation de consentement préalable et éclairé local, ils n’ont en revanche aucune marge de manœuvre en ce qui concerne la mise en place de ces mesures lorsque des communautés locales ou autochtones sont présentes sur leur territoire et que des droits sur les ressources sont établis (E. Morgera, E. Tsioumani, M. Buck, op. cit., p. 146-7). Ainsi qu’on l’a observé, « [a]s for other provisions in the Protocol that relate to indigenous peoples and local communities, Article 6(2) is to be interpreted and implemented in the light of relevant international human rights standards, and with due consideration of communities’ customary laws, protocols and procedures » (op. cit., 147).
[160] Protocole de Nagoya, Préambule.
[161] Protocole de Nagoya, art. 5.2 et 5.5.
[162] Protocole de Nagoya, Préambule qui fait du partage des avantages le mécanisme incitatif destiné à maintenir ce rôle de gardien. La formule rappelle la philosophie derrière la bioprospection (v. supra, n°…). Mais, elle est contrebalancée par la « […] the recognition (for the first time at the global level) of the substantive environmental rights of indigenous peoples and local communities to their genetic resources and to their traditional knowledge associated with genetic resources. Such recognition is based on established international human rights in their collective dimension to indigenous peoples’ self-determination, ownership and cultural identity. It can further be argued that the Protocol points to an expansion of these rights to local communities, whose status in international human rights law remains underdeveloped » (E. Morgera, E. Tsioumani, M. Buck, op. cit., p. 382).
[163] Protocole de Nagoya, art. 12.
[164] Code de conduite éthique Tkarihwaié:ri, (CONFÉRENCE DES PARTIES À LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE, DÉCISION ADOPTÉE PAR LA CONFÉRENCE DES PARTIES À LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE À SA DIXIÈME RÉUNION, Dixième réunion Nagoya, Japon, 18–29 octobre 2010, UNEP/CBD/COP/DEC/X/42, 27 octobre 2010, décision X/42) (ci-après : Code de conduite éthique Tkarihwaié:ri).
[165] On pourrait encore mentionner dans ce panorama : – la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, 1994, art. 3(a) ; – L’Accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, art. 5(i) ; l’Accord international de 2006 sur les bois tropicaux, art. 1er. Les directives volontaires adoptées par la FAO montrent aussi la progressive prise en compte de la notion d’intendance des populations locales. V., par ex., – Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, 1.2, 5.6, 6.5, 6.6, 7.3, 7.4, 8.2, 8.4, 8.7, 8.9, 9.1-9.12, 10.1-10.6, 11.2, 12.4, 12.7, 12.9, 15.4, 15.6, 16.8, 17.1, 17.2, 20.2, 20.3, 20.4, 22.2, 23.1, 23.3, 24.5, 25.4, 25.5, 25.6. Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l’éradication de la pauvreté, 5.5, 5.15, 6.1, 6.7, 10.2, 11.4, 11.6, 11.7, 12.3.
[166] Code de conduite éthique Tkarihwaié:ri, para. 5.
[167] V. aussi, en ce sens, K.S. Bavikatte, H. Jonas et H. von Braun, « Traditional knowledge and economic development: The biocultural dimension », in S.M. Subramanian et B. Pisupati (dir.), op. cit., spéc. p. 310.
[168] Code de conduite éthique Tkarihwaié:ri, para. 20.
[169] K.S. Bavikatte, Stewarding the Earth, op. cit., spéc. p. 145-169 (chapitre 7).
[170] V. infra, n° 50.
[171] V. infra, n° 62.
[172] Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group (on behalf of Endorois Welfare Council) v. Kenya, African Commission on Human and Peoples’ Rights, ACHPR Communication No 276/2003, 2009 AHRLR 75 (4 February 2010) (ci-après : Aff. Endorois).
[173] Report of the African Commission’s Working Group of Experts, submitted in accordance with the “Resolution on the Rights of Indigenous Populations/Communities in Africa”, adopted by the African Commission on Human and Peoples’ Rights at its 28th Ordinary Session (2003).
[174] Aff. Endorois, para. 150.
[175] Aff. Endorois, para. 150.
[176] Aff. Endorois, para. 152-153.
[177] Aff. Endorois, para. 154.
[178] Aff. Endorois, para. 157.
[179] Aff. Endorois, para. 151.
[180] Cf. B. Saul, Indigenous Peoples and Human Rights. International and Regional Jurisprudence, Hart Publishing, Oxford, Portland, 2016, p. 45.
[181] Aff. Endorois, para. 184. Il est à noter que le gouvernement kenyan n’a pas contesté, en l’occurrence, que la zone constituait la terre des ancêtres des Endorois.
[182] Aff. Endorois, para. 186.
[183] Aff. Endorois, para. 212. « Le “critère d‘utilité publique” se trouve à un seuil supérieur en cas d’empiètement des terres autochtones, plutôt qu‘une propriété individuelle. Dans ce sens, le test est plus rigoureux lorsqu’il s’applique aux droits à la terre des ancêtres chez les autochtones. En 2005, ce point a été souligné par le Rapporteur spécial de la Sous-Commission des Nations Unies pour la promotion et la protection des droits de l’homme qui a publié la déclaration suivante : — “Les limitations, le cas échéant, du droit des autochtones à leurs ressources naturelles, doit découler uniquement de l’intérêt le plus urgent et le plus absolu de l’État. Très peu de limitations sont justifiées en matière des droits aux ressources des autochtones, parce que la propriété indigène des ressources est liée aux Droits de l’homme les plus importants et les plus fondamentaux, y compris le droit à la vie, à la nourriture, à l’autodétermination, à l’habitat et le droit d’exister en tant que peuple” ».
[184] Aff. Endorois, para. 235.
[185] Sur le contrôle de proportionnalité, Aff. Endorois, para. 215-219.
[186] V. Aff. Endorois, para. 178.
[187] C’est nous qui soulignons.
[188] Aff. Endorois, para. 235.
[189] K.S. Bavikatte, Stewarding the Earth, op. cit., p. 167.
[190] Ibid.
[191] K.S. Bavikatte, op. cit., p. 168.
[192] AfCHPR, ACHPR v. Republic of Kenya, Application No. 006/2012 (26 May 2017), para. 127 (ci-après : Aff. Ogiek).
[193] V., plus largement, sur cette affaire : L. Claridge, « Litigation as a Tool for Community Empowerment: The Case of Kenya’s Ogiek », Erasmus Law Review, 2018, Vol. 11(1), p. 57-66; R. Rösch, « Indigenousness and peoples’ rights in the African human rights system: situating the Ogiek judgement of the African Court on Human and Peoples’ Rights », Verfassung in Recht und Übersee, 2017, Vol. 50(3), p. 242-258.
[194] Aff. Ogiek, para. 130.
[195] Orissa Mining Corporation Ltd. v. Ministry of Environment & Forests & Others (2013) Writ Petition (Civil) No. 180 of 2011 (ci-après : Aff. Orissa).
[196] R. Chandra, « Understanding change with(in) law: The Niyamgiri case », Contributions to Indian Sociology, 2016, Vol. 50(2), p. 1–26, p. 10 : « One of the reasons why the Niyamgiri mountains are heavily forested, in particular the Niyam Dongar, is the Dongaria Kondh taboo on cutting trees on the summit, seeing it as the abode of the Niyam Raja, and their awareness of a “magnetic force” which the forest exerts on the whole region’s fertility from up there » (qui s’appuie sur les travaux de P. Padel et S. Das, Out of This Earth, Orient Blackswan, New Delhi, 2010, p. 140).
[197] Sur l’obligation de saisir la Cour Suprême pour les demandes de conversion, cf. T.N. Godavarman Thirumulpad v. Union of India, Judgment of the Supreme Court of India in W.P. (c) No. 202/1995.
[198] CENTRAL EMPOWERED COMM., REPORT IN I.A. NO. 1324 REGARDING THE ALUMINA REFINERY PLANT BEING SET UP BY M/S VEDANTA ALUMINA LTD. AT LANJIGARH IN KALAHANDI DISTRICT, ORISSA (2015), http://www.indiaresource.org/issues/globalization/2005/CECSep2005cancellicense.html
[199] M. Menon, « India’s First Environmental Referendum: How Tribal People Protected the Environment », Envtl. L. Rep. News & Analysis 2015, Vol. 45, p. 10656 et s., p. 10657.
[200] Orders of the Supreme Court of India in I.A. No. 2166 in 1413 in W.P. (c) No. 202/1995
(Aug. 8, 2008), http://cecindia.org/sc_documents/(25)I.A.no.2166%20in%C201413%20W.P.(c)no.202%201995%2008.08.2008.pdf ; I.A. Nos. 1324 & 1474 in W.P. (c) 202 of 1995 (Nov. 23, 2007), http://cecindia.org/sc_documents/(34)I.A.no.1324,1474%20W.P.(c)no.202%201995%2023.11.2007.pdf.
[201] MINISTRY OF ENV’T AND FORESTS (MOEF), REPORT OF THE FOUR MEMBER COMMITTEE FOR INVESTIGATION INTO THE PROPOSAL SUBMITTED BY ORISSA MINING COMPANY FOR BAUXITE MINING IN NIYAMGIRI (2010), http://envfor.nic.in/sites/default/files/Saxena_Vedanta-1.pdf
[202] Aff. Orissa.
[203] Aff. Orissa, para. 58-62.
[204] Aff. Orissa, para. 42.
[205] R. Chandra, « Understanding change with(in) law: The Niyamgiri case », op. cit., p. 2.
[206] Ibid.
[207] Selon la loi « other traditional forest dweller » signifie « any member or community who has for at least three generations prior to the 13th day of December, 2005 primarily resided in and who depends on the forest or forests land for bona fide livelihood needs » (Chapter 1.2).
[208] The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, Act No. 2 of 2007, chap. II.3 (ci-après : Forest Rights Act, 2006).
[209] Forest Rights Act, 2006, chap. III.5(c).
[210] Forest Rights Act, 2006, chap. III.5(d).
[211] Forest Rights Act, 2006, chap. II.3(i).
[212] Aff. Orissa, para. 42 (v. supra, note (204)).
[213] Cf. G. Sajeva, When Rights Embrace Responsibilities, op. cit., p. 91.
[214] Forest Rights Act, 2006, chap. III.5.
[215] Corte Constitucional de Colombia, Noviembre 10 de 2016, Tierra Digna y Otros v Presidencia de la República y otros, Sentencia T-622/16 (ci-après : Aff. Tierra Digna).
[216] Corte Suprema de Justicia, Abril 4 de 2018, Dejusticia y otros v Presidencia de la República y otros, Sentencia STC4360-2018.
[217] En 2010, la Colombie présentait le taux de pollution au mercure par habitant le plus élevé au monde issu d’exploitations aurifères artisanales et semi-mécanisées : cf. ABColombia, « A River with Rights: Community Response to Illegal Gold Mining in Chocó, Colombia », 8/02/2019, https://www.abcolombia.org.uk/a-river-with-rights-community-response-to-illegal-gold-mining-in-choco-colombia/
[218] ABColombia, op. cit.
[219] Ce recours a été introduit par la Constitution de Colombie de 1991, art. 86.
[220] Sur cet aspect, on consultera P. Villavicencio Calzadilla, « A Paradigm Shift in Courts’ View on Nature : the Atrato River and Amazon Basin Cases in Colombia », LEAD 2019, Vol. 15/0, p. 1-11, spéc. p. 4.
[221] On retrouve d’ailleurs dans les paragraphes pertinents un certain nombre d’éléments communs, dont la définition générale des droits bioculturels.
[222] Aff. Tierra Digna, para. 5.11.
[223] Aff. Tierra Digna, para. 9.30.
[224] Aff. Tierra Digna, para. 5.11.
[225] Aff. Tierra Digna, para. 5.12.
[226] Ibid. La Cour renvoie à K.S. Bavikatte, T. Bennett, « Community stewardship: the foundation of biocultural rights », op. cit.
[227] Aff. Tierra Digna, para. 5.13. Le concept de bioculturalité est d’ailleurs exploré dans le détail par la Cour qui se réfère aux travaux de Dutfield et alii sur les « traditional resource rights » (D.A. Posey et al., Traditional resource rights: International instruments for protection and compensation for Indigenous peoples and local communities, International Union for the Conservation of Nature, Gland, 1996). Pour la Cour : i) les multiples modes de vie qu’exprime la diversité culturelle sont inextricablement liés à la diversité des écosystèmes et des territoires ; ii) la diversité des cultures lato sensu est le résultat de la coévolution des communautés humaines avec leur environnement ; iii) les relations des cultures ancestrales avec les plantes, les animaux, les microorganismes et l’environnement contribuent à la biodiversité ; iv) la diversité bioculturelle comprend aussi les conceptions spirituelles et culturelles de la nature que l’on trouve chez les peuples autochtones et communautés locales ; v) la conservation de la diversité culturelle contribuant à la conservation de la diversité biologique, de bonnes politiques publiques devraient donc intégrer le concept de bioculturalité (Aff. Tierra Digna, para. 5.17).
[228] Aff. Tierra Digna, para. 5.13. La Cour renvoie ici à C. Chen, M. Gilmore, « Biocultural Rights: A New Paradigm for Protecting Natural and Cultural Resources of Indigenous Communities », The International Indigenous Policy Journal, 2015, Vol. 6(3), p. 1-17, spéc. p. 9 : « the concept connects the past, the present and the future. It is a concept that takes into consideration of the past, the present and the future in the sense that it is premised on the distinctive histories and wrongs that Indigenous groups have experienced, the examination of the present system, and the very need to help and empower these groups to conserve their distinct biocultural diversity for future generations ».
[229] Aff. Tierra Digna, para. 5.13. V. aussi, C. Chen, M. Gilmore, op. cit., p. 9 : « […] this concept considers the “special” element of Indigenous communities and the “universal” interest ».
[230] Boaventura de Sousa Santos, Toward a new legal common sense : law, globalization, and emancipation, 2e éd., Butterworths, Londres, 2002, p. 14-15.
[231] Cette dernière lecture est confirmée par les développements que la Cour consacre, au paragraphe 5.15, à Arturo Escobar. On sait que l’universitaire et intellectuel colombien, déjà mentionné plus haut dans son rôle de structuration du champ du post-développement (v. supra, n° 16, 80), a un été un contempteur infatigable du développement. Il a notamment bien montré dans son ouvrage classique de 1995, (Encountering Development: The making and unmaking of the third world, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1995, spéc. p. 44), combien les politiques de développement, et notamment la stratégie de développement durable lancée officiellement en 1987, et fondée sur le double objectif de réduction de la pauvreté et de la protection de l’environnement, a pu échouer. En cause, principalement, une approche politique centralisatrice, hiérarchique, ethnocentrique, technocratique qui ne voit dans les populations et la culture que des objets abstraits et des statistiques saisis uniquement au prisme du progrès. Or, comme l’a bien montré Escobar, il existe évidemment des alternatives au développement. Pour le voir, il faut tout d’abord admettre que le modèle du développement occidental – qui est basé sur la croissance économique – est la pire option pour les communautés locales et peuples autochtones. Par ailleurs, il faut permettre aux communautés locales d’expérimenter des stratégies de production alternatives et développer simultanément une sémiotique de résistance à la configuration moderne des rapports nature et société. En d’autres termes, ainsi qu’on le comprend, les droits bioculturels offrent aussi un espace d’expérimentation et de négociation, un espace contre-hégémonique qui permet de penser de nouvelles « politiques ontologiques » (v. infra, n° 80), et d’en proposer une insertion dans le discours universel sur la protection de la nature. Le cosmopolitisme réside ici dans la prétention au local, à la singularité, qui ne renonce pas pour autant à faire partie d’un monde commun, fût-il ontologiquement divers.
[232] Aff. Tierra Digna, para. 5.14 (c’est la Cour qui souligne).
[233] K.S. Bavikatte, T. Bennett, « Community Stewardship: the Foundation of Biocultural Rights », op. cit., p. 8.
[234] Et ces modes de vie et pratiques dépendent elles-même du régime foncier, des droits sur la terre et les ressources, ainsi que des droits sur la culture et les savoirs agro-écologiques traditionnels. Aff. Tierra Digna, para. 5.14.
[235] Aff. Tierra Digna, para. 5.14 : « estos derechos implican que las comunidades deben mantener su herencia cultural distintiva » (c’est la Cour qui souligne).
[236] K.S. Bavikatte, D. Robinson, « Towards a people’s history of the law: Biocultural jurisprudence and the Nagoya Protocol on access and benefit sharing », op. cit.
[237] Aff. Tierra Digna, para. 5.14.
[238] K.S. Bavikatte, D. Robinson, op. cit., p. 50.
[239] V. infra, n° 71.
[240] Aff. Tierra Digna, para. 5.17. C’est ce que la Cour réaffirme également plus loin, après avoir reconnu la personnalité juridique de la rivière Atrato (para. 9.32).
[241] G. Sajeva, When Rights Embrace Responsibilities, op. cit., p. 99.
[242] G. Sajeva, op. cit., p. 100 : « Cultural identity and self-identification have been and still are the cornerstone of indigenous peoples’ struggles for their rights, as they have been regarded as the very building material to construct the realization and protection of all other interests. As in any account of group rights, the intrinsic value of the individual group members is coupled with the intrinsic value recognized to the group itself. It is argued that a certain interest of the group and its members is very significant for their survival, well-being, and development and is, hence, important enough to hold somebody under duties ».
[243] La jurisprudence souligne ainsi assez souvent que, compte tenu de la grande dépendance des populations locales à l’égard de leur environnement, la protection de celui-ci est, pour elles, une question de survie. V., par ex., Inter‑American Court of Human Rights : Nicaragua, Case of te Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v/ Nicaragua, Series C No. 79 (31 August 2001), para. 149. V. aussi : G. Sajeva, op. cit., p. 101-102.
[244] Claire Charters (Indigenous Peoples’ Rights to Lands, Territories, and Resources in the UNDRIP. Articles 10, 25, 26, and 27, in J. Hohmann et M. Weller (dir.), The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Oxford University Press, Oxford, 2018, p. 395-424, p. 396) note que « [t]he importance to Indigenous peoples of their lands, territories and resources is difficult to overstate. It formed the basis of Indigenous peoples’ arguments and justifications for strong Articles on lands, territories, and resources in the Declaration, which have been accurately described as its “heart and soul” » (le cœur et l’âme est une référence à UN Commission on Human Rights (UNCHR), Report of the Working Group Established in Accordance with Commission on Human Rights Resolution 1995/32 of 3 March 1995, UN Doc E/CN.4/1996/84 (4 January 1996). Dans l’affaire Mayagna (note précédente) la Cour interaméricaine des droits de l’homme notait : « the close ties of Indigenous peoples with the land must be recognized and understood as the fundamental basis for their cultures, their spiritual life, their integrity, and their economic survival. For Indigenous communities [their relationship with] the land is not merely a matter of possession and production but a material and spiritual element, which they must fully enjoy […] to preserve their cultural legal and transmit it to future generations » (para. 149).
[245] G. Sajeva, op. cit., p. 100-101.
[246] V. supra, n° 28-32, 41-46.
[247] K.S. Bavikatte, T. Bennett, « Community Stewardship: the Foundation of Biocultural Rights », op. cit., p. 27.
[248] K.S. Bavikatte, Stewarding the Earth, op. cit., p. 10.
[249] On verra qu’on peut concevoir deux approches différentes, qui n’ont pas les mêmes répercussions sur le plan des devoirs : la première est classiquement anthropocentrique, même si elle intègre les générations actuelles et futures. La seconde est biocentrique/écocentrique et élargit le cercle de la considération morale aux non-humains : v. infra, n° 68-70.
[250] V., par ex., Aff. Tierra Digna, para. 5.14 (supra, n° 41-46) ; K.S. Bavikatte, D.F. Robinson, op. cit., p. 50.
[251] Code de conduite éthique Tkarihwaié:ri, para. 20.
[252] K.S. Bakikatte, Stewarding the Earth, op. cit., p. 235 ; G. Sajeva, When Rights Embrace Responsibilities, op. cit., p. 104.
[253] G. Sajeva, op. cit., p. 105.
[254] G. Sajeva, op. cit., p. 105 : « although heterogeneous and dynamic, the basket of biocultural rights can be said to be filled with three categories of rights, which encompass all the different rights needed to preserve a stewardship relationship with the environment ».
[255] C. Charters, « Indigenous Peoples’ Rights to Lands, Territories, and Resources in the UNDRIP. Articles 10, 25, 26, and 27 », op. cit., p. 397.
[256] UNCHR, Indigenous Open-Ended Inter-Sessional Working Group on a Draft United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Consideration of a Draft United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples “information Received from Non-Governmental and Indigenous Organizations”, UN Doc 3/CN.4/1995/WG.15/4 (10 October 1995).
[257] Ibid. Cité par C. Charters, op. cit., p. 397.
[258] V. infra, n° 75.
[259] Ce qui n’est pas négligeable compte tenu de l’état d’extrême pauvreté dans lequel les peuples autochtones sont maintenus à travers le monde.
[260] Convention n° 169 de l’OIT.
[261] Convention n° 169 de l’OIT, art. 13.
[262] Convention n° 169 de l’OIT, art. 14.
[263] Convention n° 169 de l’OIT, art. 16 (des exceptions existent, mais sont soumises à des conditions extrêmement strictes).
[264] Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale New York, 7 mars 1966, (entrée en vigueur 4 janvier 1969), Recueil des Traités, vol. 660, p. 195.
[265] Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Recommandation générale no. 23, Les droits des populations autochtones, (Cinquante et unième session, 1997), U.N. Doc.A/52/18, annexe V, para. 5.
[266] Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Décision (2) 54 sur l’Australie, Doc. ONU A/54/18 (1999) ; Comité pour l’élimination de la discrimination, Décision 1 (66) sur la loi néo-zélandaise sur l’estran et les fonds marins, Doc. ONU CERD/C/DEC/NZL/1 (2005).
[267] C. Charters, op. cit., note (18), p. 399.
[268] Cf. CDH, Observation générale 23, Article 27: Protection des minorités, Compilation des commentaires généraux et Recommandations générales adoptées par les organes des traités, U.N. Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 (1994), para. 7.
[269] V., par ex., CDH, Observations finales, Mexico, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.109 (1999), para. 19 : recommandant que le Mexique respecte « leurs coutumes et leurs cultures [des peuples autochtones] ainsi que leurs formes traditionnelles de vie, leur permettant d’avoir la jouissance de leurs terres et de leurs ressources naturelles » (cité par C. Charters, op. cit., p. 399).
[270] Le Comité a fait sans doute preuve d’un peu plus de volontarisme dans ses constatations sur les communications faites par les peuples autochtones (dans le cadre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques). Par exemple, dans l’affaire La bande du lac Lubicon c. Canada , le Comité s’est prononcé sur la communication présentée par le chef Bernard Ominayak et la bande du lac Lubicon faisant état de violations, par le Gouvernement canadien, du droit que possède la bande du lac Lubicon de disposer d’elle-même et, en vertu de ce droit, de déterminer librement son statut politique et poursuivre son développement économique, social et culturel, ainsi que de son droit de disposer de ses richesses et ressources naturelles et de ne pas être privée de ses propres moyens de subsistance. Le Comité a jugé que le Canada avait violé l’article 27 (CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L’HOMME (ARTICLE 5, PARAGRAPHE 4, DU PROTOCOLE FACULTATIF CONCERNANT LE PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES) -TRENTE-HUITIEME SESSION concernant La communication No 167/1984, CERD/C/54/D/8/1996, para. 2.3).
[271] Les avancées les plus grandes ont été accomplies par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans les affaires Moiwana Village v. Suriname (Inter-Am. C.H.R., No. 124, Ser. C (2005)) et Saramaka People v. Suriname (Inter-Am. C.H.R. No. 172, Ser. C (2007)). On doit également signaler les ressources que pourraient offrir, à l’avenir, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et d’autres personnes travaillant dans les zones rurales, Soixante-treizième session Troisième Commission Point74 b) de l’ordre du jour, 30 octobre 2018, A/C.3/73/L.30, spéc. art. 17.
[272] A. Xanthaki, Indigenous Rights and United Nations Standards, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, p. 8.
[273] D.A. Posey, Cultural and Spiritual Values of Biodiversity: A Complementary Contribution to the Global Biodiversity Assessment, Intermediate Technology Publication, Nairobi, p. 4 : l’autodétermination « symbolizes not just the basic human rights to which all individuals are entitled, but also land, territorial and collective rights, subsumed under the right to self-determination ».
[274] Pacte relatif aux droits civils et politiques, New York, 16 décembre 1966 (entrée en vigueur 23 mars 1976) Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999, p. 171 et vol. 1057, p. 407 art. 1er ; Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, GA Res 2200A (XXI), 21 UN GAOR Supp (No 16), p. 49, UN Doc A/6316 (1966) (entrée en vigueur 3 janv. 1976), Recueil des Traités, vol. 993, p. 3, art. 1er .
[275] I. Schulte-Tenckhoff, Treaties, Peoplehood, and Self-determination, in E. Pulitano (dir.), Indigenous Rights in the Age of the UN Declaration, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, spéc. p. 77.
[276] Dans le contexte colonial, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes inclut le droit à la session unilatérale, i.e. le droit à l’indépendance de la colonie : Résolutions 1514 (XV) du 14 décembre 1960 et 1541 (XV) du 15 décembre 1960. V. aussi, M. Weller, « Self-Determination of Indigenous Peoples. Articles 3, 4, 5, 18, 23, and 46(1) », in J. Hohmann et M. Weller (dir.), The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Oxford University Press, Oxford, 2018, p. 115-149, p. 146.
[277] Convention n° 169 de l’OIT, art. 1.3.
[278] M. Weller, op. cit., p. 147, qui note que le Groupe de travail comptait jusqu’à 150 représentants des peuples autochtones et des ONG dotés du capital intellectuel, social et financier suffisant pour mener la bataille.
[279] Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Résolution de l’Assemblée générale, 61/295.
[280] A. Xanthaki, Indigenous Rights and United Nations Standards, op. cit., p. 146 ; v. aussi S.J. Anaya, Indigenous Peoples in International Law, op. cit., p. 49.
[281] M. Weller, op. cit., p. 147.
[282] A. Cassese, Self-determination of Peoples : A Legal Reappraisal, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.- Contra, S.J. Anaya, Indigenous Peoples in International Law, op. cit., p. 81.
[283] Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies de 1970, Résolution AGNU, 2625 (XXV).
[284] H. Quane, « The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples : New Directions for Self-Determination and Participatory Rights ? », in S. Allen and A. Xanthaki (dir.), Reflections on the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Hart Publishing, Oxford, Portland, p. 259-287, p. 260.
[285] A. Cassese, Self-determination of Peoples : A Legal Reappraisal, op. cit., p. 101.
[286] V. Bogota Accord, 9 December 1984, art 1(3)(a),; v. aussi Basic Preliminary Accord between Government of Nicaragua and YATAMA, 2nd February 1988, Art 1; IACtHR, Case of the Saramaka People v Suriname (Preliminary Objections, Merits, Reparations, and Costs), Judgement (28 November 2007), IACtHR Series C No 172, para 93.- V. aussi, en Afrique, AfCHPR, ACHPR v. Republic of Kenya, Application No. 006/2012 (26 May 2017), para. 199 ; AfCommHPR, Case No 266/03, Kevin Mgwanga Gunme and Others/Cameroon.
[287] CDH, Observation générale no 12. Article premier (Droit à l’autodétermination), Vingt et unième session, 13 mars 1984, HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I). Toujours concernant le Comité des droits de l’homme, et son travail d’interprétation de l’art. 1er du Pacte relatif aux droits civils et politiques : cf. B. Saul, Indigenous Peoples and Human Rigths. International and Regional Jurisprudence, Hart, Oxford et Portland, 2016, p. 55-59. S’agissant du Comité des droits économiques, sociaux et culturels et son interprétation du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, cf. B. Saul, op. cit., p. 85-87.— Adde, Cour Suprême du Canada, Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217 ; 161 D.L.R. (4th) 385 ; 55 C.R.R. (2d) 1.
[288] V. l’étude détaillée de M. Weller, M. Weller, « Self-Determination of Indigenous Peoples. Articles 3, 4, 5, 18, 23, and 46(1) », op. cit., p. 140-143.
[289] M. Weller, op. cit., p. 124.
[290] Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, art. 7, 8 et 10.
[291] Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, art. 9.
[292] J. Anaya, op. cit., 97.
[293] Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, art. 11-16, 25, 31.
[294] J. Anaya, op. cit., p. 99-100.
[295] J. Anaya, op. cit., p. 104-105 ; et v. supra, n° 49-50.
[296] O. Mazel, « The Evolution of Rights : Indigenous Peoples and International Law », Australian Indigenous Law Review, 2009, 12, p. 140-158, spéc. 152.
[297] M. Weller, op. cit., p. 143 ; v. aussi C. Dessanti, « Indigenous Peoples’ Right to Self-Determination in International Law », Intra Vires 2015, 1.1, p. 45-55, spéc. p. 51.
[298] L’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, qui ont dans un premier temps voté contre la Déclaration, sont depuis revenus sur leur position : C. Dessanti, op. cit., p. 50.
[299] L’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis ne l’ont pas ratifiée.
[300] C. Dessanti, op. cit., p. 51.
[301] A. Tomaselli, « Indigenous right to and forms of (legally recognized) “autonomy” », Red Multidisciplinar sobre Pueblos Indígenas, 2017, https://redempi.wordpress.com/2017/01/17/indigenous-right-to-and-forms-of-legally-recognized-autonomy/, p. 84, qui rappelle la racine grecque : auto et nomos. Elle rapporte aussi que, en théorie du droit, l’autonomie renvoie souvent à self-government, self-management, self-administration, home rule et self‑government. V. aussi, A. Tomaselli, Indigenous Peoples and their Rights to Political Participation, Nomos, Francfort, 2015, p. 254-259.
[302] Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, 18 décembre 1992, résolution 47/135, art. 2(1) et 2(2).
[303] Commentaire sur la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, par Asbjørn Eide, Président du Groupe de travail sur les minorités de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, COMMISSION DES DROITS DE L’HOMME, Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, Cinquante-troisième session, Groupe de travail sur les minorités, Septième session 14-18 mai 2001, UN Doc E/CN.4.SUB.2/AC.5/2001/2 (2 avril 2001), para. 38 et s. (cité par M. Weller, op. cit., p. 143, note (111).
[304] Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, Strasbourg, février 1995, H (95) 10. À la différence des dispositions correspondantes de la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, la référence assez prudente à des décisions affectant les « régions où elles vivent » a été supprimée de la version finale de l’article 15 de la CCPMN. Toutefois, note Weller, dans le rapport explicatif qui suit la Convention, les gouvernements sont encouragés à prendre en compte « les formes décentralisées ou locales d’administration », afin de créer les conditions nécessaires à la participation effective de personnes appartenant à des minorités nationales à la vie culturelle, sociale et économique, ainsi qu’aux affaires publiques, en particulier celles les concernant (M. Weller, op. cit., p. 144). V. Conseil de l’Europe, CONVENTION-CADRE POUR LA PROTECTION DES MINORITÉS NATIONALES ET RAPPORT EXPLICATIF, (février 1995), H (95)10, para. 80. V. aussi la Charte européenne de l’autonomie locale, Strasbourg, 15.X.1985, Série des traités européens – n° 122, qui énonce, à l’article 4(3), que « [l]’exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber, de préférence, aux autorités les plus proches des citoyens » (cité par M. Weller, op. cit., p. 144).
[305] Comme l’a aussi noté S. Wiessner, « [t]he claim to indigenous sovereignty is founded upon the aspiration to preserve their inherited ways of life, to change those traditions as they see necessary, and to make their culture flourish. That goal drives the claim for independent decision-making on the structures and functions of decision‑making within the indigenous community. Internal autonomy thus asks of modern nation states to recognize formally “democratic” as well as formally “non-democratic” forms of indigenous government – as long as they are essential to the traditional ways of life. This would include the recognition of law-making and -applying powers by traditional leaders in their various spheres of authority – peace chiefs, war chiefs, shamans, elders, and so on. An obligation to have indigenous peoples accede to modern formal processes of periodic election and change of leaders runs against the spirit of preservation of the innermost core of their culture – that is, decisions about how their decisions are made. […] On the other hand, indigenous peoples themselves might want to change the way decisions have been made. But that decision should be theirs, and theirs alone, not forced upon them by the outside world. A good intellectual tool to analyze the parallel legal sphere established by such notions of self-government is the understanding of law as a process of authoritative and controlling decision within a community. […] Law is thus made in a variety of diverse communities, including, but not limited to, the state. This is a key insight that predates, but essentially agrees with, modern legal pluralism, as applied to indigenous peoples or with the idea of parallel sovereignty » (S. Wiessner, « Indigenous self-determination, culture, and land: a reassessment in light of the 2007 UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples », in E. Pulitano, Indigenous Rights in the Age of the UN Declaration, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, p. 31-63, spéc. p. 45-46).
[306] J. Anaya, op. cit., p. 110.
[307] Op. cit., p. 110, qui ajoute : « In general, autonomous governance for indigenous communities is considered instrumental to their capacities to control the development of their distinctive cultures, including their use of land and resources ». V. aussi les remarques de M. Weller, op. cit., p. 144.
[308] V., par ex., CDH, Observations finales : Canada, UN Doc A/54/40 (1999), vol I, para. 230 ; CDH, Observations finales : Australia, UN Doc A/55/40 (2000), vol I, para. 506-507 ; CDH, Observations finales : Finlande, UN Doc A/60/40 (2004), vol I, para. 81(17).
[309] M. Weller, op. cit., p. 145.
[310] Comp. avec CDH, Observations finales : Mexico, UN Doc CCPR/C/MEX/CO/5 (2010), para. 22 et CDH, Observations finales, Mexico, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.109 (1999), para. 19 (qui n’évoquent que la « consultation » et la « participation »).
[311] M. Weller, op. cit., loc. cit.
[312] Ibid.
[313] Economic and Social Council, COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, Fifty-second session, Item 8 of the provisional agenda, Working paper on the relationship and distinction between the rights of persons belonging to minorities and those of indigenous peoples, Distr.GENERALE/CN.4/Sub.2/2000/10, 19 July 2000 (Erika-Irene Daes et Asbjørn Eide), para. 8.
[314] J. Waldron, « Indigeneity? First Peoples and Last Occupancy », New Zealand Journal of Public and International Law, 2003, Vol. 1(1), p. 55-82, spéc. p. 61 : « Indigeneity calls for a more radical approach – not just remedial measures to address maldistribution, but a restoration to the descendants of indigenous peoples of some or all of the rights – rights of sovereignty, rights of property – that were once held by their ancestors ».
[315] L. Maffi, « Biocultural Approaches to Conservation and Development », in L. Maffi et D. Ortixia (dir.), Biocultural Diversity Toolkit, Terralingua, p. 9.
[316] Ibid.
[317] J. Anaya, Indigenous Peoples in International Law, op. cit., p. 110 ; P.M. Schmidt et M.J. Peterson, « Biodiversity Conservation and Indigenous Land Management in the Era of Self-Determination », Conservation Biology, 1996, Vol. 23(6), p. 1458-66.
[318] L. Breckenridge, « Protection of Biological and Cultural Diversity: Emerging Recognition of Local Community Rights in Ecosystems Under International Environmental Law », Tennessee Law Review, (1991-1992), Vol. 59, p. 735-785, p. 783.
[319] T. Loaiza, U. Nehren, G. Gerold, « REDD+ implementation in the Ecuadorian Amazon: Why land configuration and common-pool resources management matter », For. Pol. Econ. 2016, Vol. 70, p. 67-79, spéc. p. 77 qui soulignent : « […] the importance looking back into customary rules and decision-making community institutions rather than creating new precepts and structures that might not work on the ground. The enforcement of the still strong intra- and intercommunal social capital as well as traditional forms of cooperation […] can greatly support REDD+ achievements. Furthermore, recovering expertise on managing forest resources can ensure long-term sustainability and livelihood improvements under the REDD+ umbrella. Traditional knowledge is especially important for benefit-sharing and monitoring activities » ; v. aussi, M. Bayrak, L.M. Marafa, « Ten years of REDD+ : A critical review of the impact of REDD+ on forest-dependent communities », Sustainability, 2016, Vol.8(7), p. 6 qui indiquent de manière cursive : « Because rulemaking autonomy in forest management matters, REDD+ needs to devise appropriate local institutional architectures and effectively nest community engagement in forest conservation within broader national governance regimes ».
[320] Sur la question de la nature de ce « lien » dans la jurisprudence, v. infra, n° 60-62.
[321] L. Westra, Environmental Justice & the Rights of Indigenous Peoples, Earthscan, Oxon, 2008, p. 20.
[322] Jugement qui nous paraît hâtif et sur lequel il nous faudra revenir : v. infra, n° 79.
[323] L. Westra, op. cit., loc. cit., citant J.K. Asiema, F.D.P. Situma, « Indigenous peoples and the environment: the case of the pastoral Maasai of Kenya », Colorado journal of international environmental law and policy, 1994, Vol. 5(1), p. 149-171.
[324] Il convient également de noter des évolutions locales. Au Pérou, par ex., les campesinos (communautés paysannes) disposent des mêmes droits que les peuples autochtones, avec une reconnaissance des droits communaux sur la terre et un certain degré d’autonomie sur leurs territoires (M. Kania, « The Rights of Indigenous Peoples in Peru: From Socio-political Marginalization to the Modern Principles of Multiculturalism », Ad Americam. Journal of American Studies, 2016, Vol. 17, p. 11-32). Mais c’est une question complexe qui met en jeu la définition de l’autochtonie (cf. L. Cloud, V. Gonzalez, L. Lacroix, « Catégories, nominations et droits liés à l’autochtonie en Amérique latine. Variations historiques et enjeux actuels », in I. Bellier (dir.), Peuples autochtones dans le monde. Les enjeux de la reconnaissance, L’Harmattan, Paris, 2013, p. 41-74 ; S. Huarcaya, Land Reform, « Historical Consciousness and Indigenous Activism in Late Twentieth-Century Ecuador », Journal of Latin American Studies, 2018, Vol.50(2), p. 411-440). Au Brésil et en Colombie, la loi prescrit la création de réserves paysannes qui ont pour double objectif de règlementer l’occupation de zones particulièrement riches en biodiversité tout en protégeant les systèmes socio-économiques des communautés contre des usages concurrents de la terre (sur la situation au Brésil, A. Bessa, « Traditional Local Communities: What Lessons Can Be Learnt at the International Level from the Experiences of Brazil and Scotland? », RECIEL 24 (3) 2015, p. 330-340, p. 336 ; en Colombie, la loi a créé les « zonas de reserva campesina » (aires de réserve paysanne) ; sur lesquelles, cf. J. Tocancipá Falla, C.A. Ramírez Castrillón, « Las nuevas dinámicas rurales en las zonas de reserva campesina en Colombia », Perspectiva Geográfica, 2018, Vol. 23(1), p. 31-52).
[325] Y. Donders, « Do cultural diversity and human rights make a good match? », International Social Science Journal, 2010, Vol. 61(199), p. 15-35 ; F. Francioni, « Culture, Heritage and Human Rights: An Introduction », in F. Francioni and M. Scheinin (dir.), Cultural Human Rights, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2008, p. 1-15.
[326] H. Faes, « Droits de l’homme et droits culturels », Transversalités, 2008, Vol. 108(4), p. 85-99, spéc. p. 88.
[327] Déclaration universelle des droits de l’homme, Assemblée générale des Nations Unies, résolution 217 (III) A du 10 décembre 1948.
[328] H. Faes, op. cit., loc. cit.
[329] Ibid.
[330] DUDD, art. 22 : « Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays ».
[331] Même si, comme le résume Hubert Faes (op. cit., loc. cit.), « [q]uand l’article 27 parle d’un droit de prendre part à la vie culturelle de la communauté, il n’envisage pas que la communauté puisse être multiculturelle ou simplement une communauté culturelle particulière » .
[332] Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle, Résolution adoptée sur le rapport de la Commission IV à la 20e séance plénière, le 2 novembre 2001, UNESCO. General Conference, 2001, 31st [35010], 31 C/Resolutions + CORR. (only in Eng), art. premier.
[333] Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle, art. 4 : « [l]a défense de la diversité culturelle est un impératif éthique, inséparable du respect de la dignité de la personne humaine ».
[334] Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle, art. premier.
[335] V. supra, n° 27-32.
[336] Sur ces distinctions, cf. R. Stavenhagen, « Cultural Rights : A social Science Perspective », in A. Eide, C. Krause, A. Rosas (dir.), Economic, Social and Cultural Rights. A Textbook, 2e éd., Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, Boston, London, 2001, p. 85-118, spéc. p. 89. D’après l’acception anthropologique, la « culture is […] seen as a coherent self-contained system of values, and symbols as well as a set of practices that a specific cultural group reproduces over time and which provides individuals with the required signposts and meanings for behavior and social relationships in everyday life ».
[337] Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale 4 novembre 1966, art. IV.2, UNESCO. General Conference, 1966, 14th [35010], 14 C/Resolutions, CFS.67/VII.4/A/F/S/R : « La coopération culturelle internationale, sous ses formes diverses – bilatérale ou multilatérale, régionale ou universelle – aura pour fins : […] 2. De développer les relations pacifiques et l’amitié entre les peuples et de les amener à mieux comprendre leurs modes de vie respectifs ».
[338] Recommandation concernant la participation et la contribution des masses populaires à la vie culturelle du 26 novembre 1976, UNESCO. General Conference, Nairobi, 1976, 19th [35010], 19 C/Resolutions + CORR., Préambule : « […] la culture n’est plus seulement une accumulation d’œuvres et de connaissances qu’une élite produit, recueille et conserve pour les mettre à la portée de tous, ou qu’un peuple riche en passé et en patrimoine offre à d’autres comme un modèle dont leur histoire les aurait privés ; que la culture ne se limite pas à l’accès aux œuvres d’art et aux humanités, mais est tout à la fois acquisition de connaissances, exigence d’un mode de vie, besoin de communication ».
[339] Recommandation concernant la participation et la contribution des masses populaires à la vie culturelle du 26 novembre 1976, art. 1.3(a).
[340] Recommandation concernant la participation et la contribution des masses populaires à la vie culturelle du 26 novembre 1976, art. 1.4(g).
[341] Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles, Conférence mondiale sur les politiques culturelles, Mexico City, 26 juillet – 6 août 1982. La Déclaration est à l’origine du concept d’« identité culturelle » : « 1. Toute culture représente un ensemble de valeurs unique et irremplaçable puisque c’est par ses traditions et ses formes d’expression que chaque peuple peut manifester de la façon la plus accomplie sa présence dans le monde. 2. L’affirmation de l’identité culturelle contribue donc à la libération des peuples. Inversement, toute forme de domination nie ou compromet cette identité ».
[342] Recommandation sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire, 15 novembre 1989, UNESCO. General Conference, 1989, 25th [35010], 25 C/Resolutions + CORR. in fre, spa, para. D(a).— Adde, Commission mondiale de la culture et du développement, Notre diversité créatrice: rapport de la Commission mondiale de la culture et du développement, CLT.96/WS/6 REV., 1996, spéc. p. 14, p. 40-41.
[343] Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle, UNESCO. General Conference, 2001, 31st [35010], 31 C/Resolutions + CORR. (only in Eng).
[344] Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle, Annexe II. V. aussi, Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, 20 octobre 2005, CLT.2005/CONVENTION DIVERSITE-CULT REV.2, qui reconnaît, dans le préambule, « l’importance des savoirs traditionnels en tant que source de richesse immatérielle et matérielle, et en particulier des systèmes de connaissance des peuples autochtones, et leur contribution positive au développement durable, ainsi que la nécessité d’assurer leur protection et promotion de façon adéquate ».
[345] Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, MISC/2003/CLT/CH/14, art. 2.2(d).
[346] Convention n° 169 de l’OIT, art. 23.1.
[347] Protocole d’application de la Convention alpine de 1991 dans le domaine de l’agriculture de montagne, du 20 décembre 1994, Journal officiel n° L 271 du 30/09/2006 p. 0063 – 0070 http://www.alpconv.org/fr/convention/protocols/Documents/tourisme_fr.pdf, art. 4 : « Il y a donc lieu de reconnaître le rôle essentiel des agriculteurs, en raison de leurs tâches multifonctionnelles, aujourd’hui et demain dans la conservation du paysage naturel et rural et de les associer aux décisions et mesures pour les régions de montagne » ; V. aussi, art. 10.1.
[348] The Framework Convention on the Protection and Sustainable Development of the Carpathians (Carpathian Convention), 22 mai 2003, http://www.carpathianconvention.org/text-of-the-convention.html, art. 11 : « The Parties shall pursue policies aiming at preservation and promotion of the cultural heritage and of traditional knowledge of the local people, crafting and marketing of local goods, arts and handicrafts. The Parties shall aim at preserving the traditional architecture, land-use patterns, local breeds of domestic animals and cultivated plant varieties, and sustainable use of wild plants in the Carpathians ».
[349] Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale no. 21, Droit de chacun de participer à la vie culturelle (art. 15, par. 1 a), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Quarante-troisième session, Genève, 2-20 novembre 2009, E/C.12/GC/21, para. 15(b).
[350] Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art. 27.1 : « Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue ». V. aussi art. 15 ; Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, GA Res 47/135, Annex, 47 UN GAOR Supp (No 49), p. 210, UN Doc 1/47/49 (1993), art. 2.1. Et sur le rôle joué par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, v. Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale no. 21, op. cit. ; sur celui joué par le Comité sur l’élimination de la discrimination raciale, cf. Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Recommandation générale no. 23, Les droits des populations autochtones, (Cinquante et unième session, 1997), U.N. Doc. A/52/18, annexe V, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004) ; v. aussi : A. Xanthaki, « Culture. Articles 11(1), 12, 13(1), 15, and 34 », in J. Hohmann et M. Weller (dir.), The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Oxford University Press, Oxford, 2018, p. 273‑298, spéc. p. 276-277.
[351] A. Xanthaki, op. cit., p. 276.
[352] V. aussi : Apirana Mahuika et consort c. Nouvelle-Zélande, CCPR/C/70/D/547/1993, Communication No 547/1993 ; Francis Hopu et Tepoaitu Bessert c. France, Communication No. 549/1993, U.N. Doc. CCPR/C/60/D/549/1993/Rev.1 (1997) ; Sandra Lovelace c. Canada, Communication No. 24/1977: Canada 30/07/81, UN Doc. CCPR/C/13/D/24/1977.
[353] Ivan Kitok c. Suède, Communication No. 197/1985, U.N. Doc. CCPR/C/33/D/197/1985 (1988), para. 9.2. Ilmari Länsman et consorts c. Finlande, Communication No. 511/1992, U.N. Doc. CCPR/C/52/D/511/1992 (1994), para. 9.2 : « le Comité rappelle que des activités économiques peuvent relever de l’article 27 si elles constituent un élément essentiel de la culture d’une communauté ethnique ».
[354] La bande du lac Lubicon c. Canada, Communication No. 167/1984, U.N. Doc. CCPR/C/38/D/167/1984 (1990), para. 32.2, 33.
[355] Ilmari Länsman et consorts c. Finlande, para. 9.3 (c’est le Comité qui souligne).
[356] Ilmari Länsman et consorts c. Finlande, para. 9.3 : « En conséquence, le fait que les auteurs ont peut-être adapté leurs méthodes d’élevage du renne au fil des ans et le pratiquent en utilisant des techniques modernes ne les empêche pas de se prévaloir de l’article 27 du Pacte ».
[357] Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale no. 21, Droit de chacun de participer à la vie culturelle (art. 15, par. 1 a), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, op. cit. ; Ilmari Länsman et consorts c. Finlande, para. 9.3.
[358] E.I. Daes, Study on the Protection of Cultural and Intellectual Property of Indigenous Peoples, Sub‑Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, Commission on Human Rights, E/CN.4/Sub.2/1993/28, 1993, para. 1 et 4 ; E.I. Daes, Indigenous Populations and their Relationship with the Land, Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, Commission on Human Rights, E/CN.4/Sub.2/2000/25, 2000.
[359] IACommHR, Brazil, Comunidad Yanomani, Case No. 7615, Report No. 12/85 (5 March 1985), para. 2 et 7 ; IACommHR, May and Carrie Dann v. United States, Case No. 11.140, Report No. 75/02 (27 December 2002), para. 128 ; May and Carrie Dann v. United States, Belize, Maya indigenous community of the Toledo District v. Belize, Case 12.053, Report No. 40/04 (12 October 2004), para. 154-155.
[360] IACtHR, Nicaragua, Case of te Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v/ Nicaragua, Series C No. 79 (31 August 2001), para. 149 ; IACtHR, Case of the Moiwana Community v. Suriname, Series C No. 124 (15 June 2005), para. 133 : « In this way, the Moiwana community members, a N’djuka tribal people, possess an “all-encompassing relationship” to their traditional lands, and their concept of ownership regarding that territory is not centered on the individual, but rather on the community as a whole. Thus, this Court’s holding with regard to indigenous communities and their communal rights to property under Article 21 of the Convention must also apply to the tribal Moiwana community members: their traditional occupancy of Moiwana Village and its surrounding lands – which has been recognized and respected by neighboring N’djuka clans and indigenous communities over the years – should suffice to obtain State recognition of their ownership » ; IACtHR, Paraguay, Case of the Indigenous Community Yakye Axa v. Paraguay, Series C No. 125 (17 July 2005), para. 131 et 135 ; IACtHR, Paraguay, Case of the Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay, Series C No. 146 (29 March 2006), para. 131 ; IACtHR, Case of the Xákmok Kásek Indigenous Community v. Paraguay, Series C No. 214 (24 August 2010), para. 282 ; IACtHR, Kichwa Indigenous People of Sarayaku v. Ecuador, Series C No. 245 (27 June 2012), para. 149 ; IACtHR, Case of the Kaliña and Lokono Peoples v. Suriname, Series C, No. 309 (25 November 2015), para. 139 ; IACtHR, Case of the Garífuna Punta Piedra Community and its members v. Honduras, Series C No. 304 (8 October 2015), para. 210 ; IACtHR, Case of the Community Garifuna Triunfo de la Cruz and its members v. Honduras, Series C No. 305 (8 October 2015), para. 100-109 ; IACtHR, Case of the Xucuru Indigenous People and its members v. Brazil, Series C No. 346 (5 February 2017), para. 115 et s.
[361] Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group (on behalf of Endorois Welfare Council) v. Kenya, African Commission on Human and Peoples’ Rights, ACHPR Communication No 276/2003, 2009 AHRLR 75 (4 February 2010).
[362] V. aussi, sur ces points, A. Xanthaki, « Culture. Articles 11(1), 12, 13(1), 15, and 34 », op. cit., p. 283-297.
[363] V. supra, n° 50- Mais v., toutefois, infra, note suivante.
[364] Sur la définition du terme « minorité » au sens de l’article 27 du Pacte internationale relatif aux droits civils et politiques, v. F. Capotorti, Étude des droits des personnes appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques, New York, ONU, doc. E/CN.4/Sub.2/1979/384/Rev.1, 1979, p. 102 : une minorité est « […] un groupe numériquement inférieur au reste de la population d’un État, en position non dominante, dont les membres ressortissant de l’État possèdent du point de vue ethnique, religieux ou linguistique des caractéristiques qui diffèrent de celles du reste de la population et manifestent, même de façon implicite, un sentiment de solidarité, à l’effet de préserver leur culture, leurs traditions, leur religion ou leur langue ». Les caractéristiques ethniques, religieuses ou linguistiques sont déterminantes et elles font souvent défaut aux communautés locales. D’ailleurs, pour le CDH, le critère le plus important reste l’« ethnicité » (cf. Ivan Kitok c. Suède, Communication No. 197/1985, U.N. Doc. CCPR/C/33/D/197/1985 (1988)) qui, même entendue de manière « culturelle » et non « biologique », est appréhendée apparemment de manière trop étroite pour permettre à des groupes multi-ethniques de se prévaloir seulement de pratiques économiques spécifiques liées à un certain usage de la terre (en l’occurrence élevage et utilisation de terres pastorales depuis 124 ans) : Feu J. G. A. Diergaardt et consort c. Namibie, Communication No. 760/1997, U.N. Doc. CCPR/C/69/D/760/1997 (2000). Dans leur opinion individuelle concordante, les membres du comité Evatt et Quiroga ont précisé que : « En l’espèce, les auteurs ont défini leur culture exclusivement en termes d’activité économique consistant à faire paître le bétail. Ils ne peuvent pas démontrer qu’ils ont une culture distincte, qui serait intimement liée à ces terres ou tributaire de l’utilisation de ces terres, sur lesquelles ils se sont installés il y a un peu plus d’un siècle, ni que la restriction faite à l’accès à cette terre a porté atteinte à leur culture. Leur grief est essentiellement d’ordre économique et n’a rien de culturel ; il n’appelle donc pas l’application de l’article 27 » (Y. Diergarten, « Indigenous or Out of Scope? Large-scale Land Acquisitions in Developing Countries, International Human Rights Law and the Current Deficiencies in Land Rights Protection », Human Rights Law Review, 2019, 00, p. 1-16, spéc. p. 12-14). Comp. avec la jurisprudence du système interaméricain des droits de l’homme qui est bien moins protectrice des populations rurales qui n’ont ni le statut de peuple autochtone ni celui de population afro-descendante. Dans ce cas, les populations en question ne peuvent généralement se prévaloir des traits culturels exigés par la Cour ou la Commission, et le seul lien « économique » avec la terre est jugé insuffisant : cf. A.E. Dulitzky, « When Afro-Descendants Became “Tribal Peoples”. The Inter-American Human Rights System and Rural Black Communities », UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs, 2010, Vol. 15, p. 29-81, spéc. p. 45 et note (68).
[365] V. aussi G. Sajeva, When Rights Embrace Responsibilities, op. cit., p. 114
[366] J. Rivero, Les libertés publique. I. Les droits de l’homme, PUF, Pris, 1987, p. 74 : « la contrepartie des droits, au point de vue juridique, ce ne sont pas des devoirs, mais des obligations ».
[367] F. Ost, S. van Drooghenbroeck, « La responsabilité, face cachée des droits de l’homme », in H. Dumont, F. Ost, S. van Drooghenbroeck (dir.), La responsabilité, face cachée des droits de l’homme, Bruylant, Bruxelles, 2005, p. 1-49, p. 7.
[368] G. Sajeva, op. cit., p. 111.
[369] Il faut entendre par entreprise ce que, par exemple, l’article L. 160-1, al. 2, C. environ. désigne par « exploitant » : « L’exploitant s’entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative ».
[370] V. décision de la Cour constitutionnelle colombienne, supra, n° 41-46 ; v. aussi les Lignes directrices facultatives Mo’otz Kuxtal.
[371] V. par exemple les Lignes directrices facultatives Akwé: Kon pour la conduite d’études sur les impacts culturels, environnementaux et sociaux des projets d’aménagement ou des aménagements susceptibles d’avoir un impact sur des sites sacrés et sur des terres ou des eaux occupées ou utilisées traditionnellement par des communautés autochtones et locales.
[372] G. Sajeva, op. cit., p. 111. V. aussi les Lignes directrices facultatives Mo’otz Kuxtal et les Lignes directrices facultatives Akwé: Kon.
[373] Sur cette question, en doctrine française : D. Roman, « La justiciabilité des droits sociaux ou les enjeux de l’édification d’un État de droit social », La Revue des droits de l’homme [Online], 1 | 2012, URL : ; DOI : 10.4000/revdh.635. Comme le note aussi G. Sajeva, « At times, other interested parties could speak on their behalf, as might be the case with non-governemental organizations or community-based organizations, but such parties would always need to be legitimated by the relevant communities or peoples » (op. cit., p. 111).
[374] F. Ost, S. van Drooghenbroeck, op. cit., p. 2.
[375] N. Bobbio, « Il primato dei diritti sui doveri », in N. Bobbio, Teoria generale della politica, Einaudi, Turin, 1988, p. 916.
[376] Avant cette rupture, rappelait Bobbio, l’histoire politique a toujours été marquée par le primat des devoirs sur les droits. À l’origine, « il y a toujours un code de devoirs (ou d’obligations), et non de droits. De tout temps, les codes moraux ou légaux sont essentiellement composés de règles impératives, positives ou négatives, d’ordres ou d’interdictions ». Ce que l’État prescrit ou proscrit s’adresse d’ailleurs à la société dans son ensemble, plutôt qu’à l’individu, car « [à] l’origine, les codes moraux et juridiques sont mis en place afin de protéger le groupe social dans son ensemble plutôt que ses membres individuels. La fonction originelle du précepte de ne pas tuer n’est pas tant de protéger l’individu que d’empêcher la désintégration du groupe » (N. Bobbio, op. cit., p. 916).
[377] V., en particulier, pour examen récent, E.R. Boot, Human Duties and the Limits of Human Rights Discourse, Springer, Cham, 2017, p. 17-38 (chapitre 2).
[378] V., par ex., Parliament of the World’s Religions, Declaration Toward a Global Ethic, 4 septembre 1993, https://parliamentofreligions.org/pwr_resources/_includes/FCKcontent/File/TowardsAGlobalEthic.pdf ; InterAction Council, Déclaration universelle des obligations de la personne, 1 septembre 1997, https://www.interactioncouncil.org/sites/default/files/fr_udhr.pdf. (sur la portée seulement « morale » de ce texte, cf. H. Küng, « Human Responsibilities Reinforce Human Rights: The Global Ethic Project », in B. Van der Heijden, B. Tahzib-Lie (dir.), Reflection of the Universal Declaration of Human Rights: A Fiftieth Anniversary Anthology, Kluwer Law International, La Haye, 1998, 165-168, p. 168, qui parle de « voluntary self-obligation ») ; v. encore la Déclaration des devoirs et des responsabilités de l’homme, Valencia 1998 adoptée sous les auspices de l’UNESCO, http://globalization.icaap.org/content/v2.2/declare.html (en anglais).
[379] Commission des droits de l’homme, Promotion et protection des droits de l’homme. Droits et responsabilités de l’homme, E/CN.4/2003/105 17 mars 2003, https://digitallibrary.un.org/record/491708/files/E_CN.4_2003_105-FR.pdf (sur ce texte et son ambition, cf. E.R. Boot, Human Duties and the Limits of Human Rights Discourse, op. cit., p. 15-16) ; Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire, Droits fondamentaux et responsabilités fondamentales, Rapport | Doc. 12777 | 24 octobre 2011, http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=12965&lang=FR. V. aussi, Lord Chancellor and Secretary of State for Justice, Rights and Responsibilities: Developing Our Constitutional Framework, mars 2009, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/228938/7577.pdf ; la Charte de la Terre, 2000, http://chartedelaterre.org/decouvrir/la-charte/.
[380] F. Berdion Del Valle, K. Sikkink, « (Re)discovering Duties : Individual Responsibilities in the Age of Rights », Minnesota Journal of Int’l Law, Vol. 26(1), p. 189-245. V., tout spécialement en Inde, B.K. Chakravarty, « Environmentalism : Indian Constitution and Judiciary », Journal of the Indian Law Institute, 2006, Vol. 48(1), p. 99-105.
[381] Entre de nombreuses références : S. Besson, « The Bearers of Human Rights’ Duties and Responsibilities for Human Rights: A Quiet (R)Evolution? », Social Philosophy and Policy, 2015, Vol. 32(1), p. 244-268.
[382] À certains endroits de Stewarding the Earth, les droits bioculturels sont nettement destinés à permettre à la communauté de maintenir son rôle d’intendant : « […] biocultural rights are those rights that are essential for a community to look after the ecosystems they inhabit » (op. cit., p. 141). Un peu plus loin, ils viennent en quelque sorte sanctionner (et visent à préserver) la relation de soin que la communauté a développé à l’égard des eaux et des terres – ce qui implique que cette relation ait pu être préalablement établie : « [biocultural rights] aspire towards a “better view of community or peoplehood” by arguing that communities that have stewarded territories have rights to use and manage these lands and waters simply by virtue of having cared for them. It is the ethic of care for Nature that is the cornerstone of biocultural rights: Communities that have historically cared for their ecosystems should have the rights to use and manage their lands and waters irrespective of whether or not they have a formal title to it » (op. cit., p. 143 ; v. aussi, op. cit., p. 168). Ailleurs, les droits bioculturels paraissent fondés sur un certain mode de vie dont dépend l’éthique d’intendance : « Stewardship of lands and waters is not an abstract concept but is embodied in a way of life that can only flourish if its cultural and material autonomy can be protected. The ethic of stewardship is rooted within a moral universe that will be crowded out if forced to fit within the dominant legal and material systems of the homo economicus » (op. cit., 168-169 ; v. aussi, op. cit., p. 164 : « The bond between the community and its territory is not just a bond established through historical occupation of land but a biocultural bond whose content is defined by culture, religion, and spirituality of the community. This bond includes the duty of stewardship and thereby contains the very essence of what “flourishing” means to the community » ; c’est ce qu’il appelle aussi « l’attachement », op. cit., p. 149). Les droits bioculturels ont alors pour fonction de préserver ce mode de vie, ce qui rejoint la première proposition. Exceptionnellement, Kabir Bavikatte paraît aussi viser un certain résultat : « For example, if there was widespread evidence of the aforementioned communities selling or leasing parts of their lands for strip mining and themselves engaged in ecologically destructive practices, then clearly they would not have been able to establish an “all‑encompassing relationship” with the land. The land would be treated as a fungible asset and at best the courts would have asked the governments to compensate the community » (op. cit., p. 168). On revient sur ces questions infra, n° 71 et s.
[383] K.S. Bavikatte, Stewarding the Earth, op. cit., p. 168-169.
[384] G. Sajeva, When Rights Embrace Responsibilities, op. cit., p. 113.
[385] F. Berkes, Rethinking Community-Based Conservation, Conservation Biology, Vol. 18(3), p. 612-630, p. 625.
[386] T. Ellingson, The Myth of the Noble Savage, University of California Press, Londres, 2011 ; K. Redford, « The Ecologically Noble Savage », Cultural Survival Quarterly, 1991, 15(1), p. 46-48.
[387] K.S. Bavikatte, T. Bennett, « Community stewardship: the foundation of biocultural rights », op. cit., p. 21
[388] G. Sajeva, op. cit., p. 117 : « Customary laws impose duties and limits to ensure the protection of the community as a whole, future generations, and the individual subject herself or himself ».
[389] Code de conduite éthique Tkarihwaié:ri, décision X/42, UNEP/CBD/COP/DEC/X/42, 27 octobre 2010, para.20.
[390] Aff. Tierra Digna, para. 5.14.
[391] CDB, art. 10(c)
[392] Sur cette question, v. infra, n° 71 et s.
[393] G. Sajeva, op. cit., p. 120, note pertinemment que : « States’ pratices, although having improved over the last few years, cannot as yet create full trust […] as they have a colonial and postcolonial history of disregarding indigenous peoples’ and local communities’ rights and have often shown the “lack of the necessary capacity, resources, or political will” […] to properly achieve conservation outcomes ».
[394] Cette approche fait des droits environnementaux des droits fondamentaux et intègre aussi bien l’intérêt des générations actuelles que celui des générations futures. L’approche reste anthropocentrique, en ce sens que la nature est protégée pour les services qu’elle rend à l’humanité, y compris dans sa dimension transgénérationnelle. On insiste, toutefois, nécessairement sur la dépendance de l’homme à son milieu : cf. C. Larrère, R. Larrère, Du bon usage de la nature; pour une philosophie de l’environnement, Flammarion, Paris, 1997, p. 265 ; M.-P. Camproux Duffrène, « Pour une approche socio-écosystémique de la dette écologique : une responsabilité civile spécifique en cas d’atteintes à l’environnement », VertigO – La Revue électronique en sciences de l’environnement [Online], Hors-série 26 | septembre 2016, http://journals.openedition.org/vertigo/17493 ; DOI :10.4000/vertigo.17493
[395] Le biocentrisme conduit à accorder une valeur intrinsèque aux éléments individuels de la nature (les êtres vivants) (C. Larrère, « Les éthiques environnementales », Natures Sciences Sociétés 2010/4 (Vol. 18), p. 405-413, spéc. p. 406-408). Dans une vision maximaliste, la personnalité juridique peut être reconnue à certains de ces éléments individuels de la nature, tel un glacier, une rivière, une montagne. Cf. S. Knauß, « Conceptualizing Human Stewardship in the Anthropocene: The Rights of Nature in Ecuador, New Zealand and India », Journal of Agricultural and Environmental Ethics, Vol. 31, n° 6, p. 703-722. Cette reconnaissance, qui renforce la protection de certains éléments individuels, crée une tension au cœur même de la doctrine, puisque le biocentrisme est une éthique qui accorde une valeur égale à toutes les entités vivantes.
[396] L’écocentrisme porte sur les entités collectives, comme les espèces ou les écosystèmes, auxquelles il reconnaît une valeur intrinsèque (i.e. non instrumentale) (V. Maris, Philosophie de la biodiversité : petite éthique pour une nature en péril, Buchet Chastel, Paris, 2016, p. 168). Toutes ces entités dites « supa-individuelles » (qui ne correspondent pas à la somme des organismes individuels qui les composent : V. Maris, op. cit., p. 174) ont un « bien propre » qu’il est possible de promouvoir ou bien d’entraver par nos actions – ce qui devrait permettre d’inférer des obligations pesant sur les agents moraux (J.B. Callicott, « Intrinsic Value in Nature: A Metaethical Analysis », Electronic Journal of Analytic Philosophy, 1995, Vol. 3(5), http://ejap.louisiana.edu/ejap/1995). Les espèces, les écosystèmes, les océans, l’atmosphère – la communauté biotique – peuvent aussi bien se voir attribuer une valeur morale « pour ce qu’ils sont en eux-mêmes » (op. cit., n° 68), et nous ne devons donc pas compromettre leur adaptation et leur survie, ainsi que leurs stratégies de reproduction. C’est ce courant qui a conduit à reconnaître à la « nature » la qualité de sujet de droit. V., par exemple, la nouvelle Constitution de l’Équateur, adoptée en 2008, art. 71 : « La nature ou Pacha Mama, où se s’accomplit et se reproduit la vie, a le droit au respect intégral de son existence, ainsi qu’au maintien et à la régénération de ses cycles vitaux, sa structure, ses fonctions et ses processus évolutifs. Toute personne, communauté, peuple ou nationalité pourra exiger des autorités publiques de faire respecter les droits de la nature […] ». Cf. S. Knauß, op. cit. ; L. Kotzé, P. Villavicencio Calzadilla, « Somewhere between Rhetoric and Reality: Environmental Constitutionalism and the Rights of Nature in Ecuador », Transnational Environmental Law, 2017, Vol. 6(3), p. 401-433.
[397] L’environnement comme « bien d’usage commun » non exclusif que l’on trouve dans la doctrine lusophone. Cf. A. Aragão, « Les intérêts diffus, instruments pour la justice et la démocratie environnementale », VertigO – la revue électronique en sciences de l’environnement [En ligne], Hors-série 22 | septembre 2015, mis en ligne le 10 septembre 2015 : http://journals.openedition.org/vertigo/16284, para. 8 « En termes d’usage, l’environnement est un bien d’utilisation en commun par toute la communauté, c’est-à-dire un bien d’usage non exclusif. Depuis 1988, la Constitution brésilienne est exemplaire à ce titre. Selon l’article 225 de la Constitution, “tous ont le droit à un environnement écologiquement équilibré, [lequel est un] bien d’usage commun du peuple, et essentiel à une qualité de vie saine, s’imposant aux pouvoirs publics et à la collectivité qu’ils ont le devoir de défendre et de préserver pour les générations présentes et futures”. Les atteintes contre ce patrimoine affectent globalement l’ensemble des individus à court et à long terme, mais aussi dans la durée, les générations présentes et futures ». L’auteur indique aussi : « Bien que la doctrine des intérêts diffus puisse s’appliquer à d’autres objets, l’environnement est le bien diffus par excellence. L’environnement est qualifié de patrimoine universel, c’est-à-dire, un bien collectif appartenant à tous de façon égale. Selon Antonio Gidi, il n’appartient ni à un individu, ni à une association, ni au gouvernement » (op. cit., para. 7).
[398] A. Aragão, op. cit., para. 10. L’intérêt « diffus » se distingue de l’intérêt « collectif ». Ce dernier affecte les « membres d’un groupe non occasionnel, un groupe de personnes liées par un lien juridique stable. Par exemple, il peut s’agir de membres d’un syndicat, d’actionnaires d’une société, de contribuables du même impôt, de contractants d’une agence d’assurances, d’étudiants d’une école. Ce sont donc des groupes délimités caractérisés comme des associations avec une dimension corporative. C’est le cas des associations civiques, des associations de voisinage, des coopératives de production, des syndicats de travailleurs, des partis politiques ou des abonnés de contrats collectifs » (A. Aragão, op. cit., para. 16).
[399] On peut dire que les biens environnementaux mettent également en jeu, en eux-mêmes, un intérêt à dimension transgénérationnelle : A. Aragão, op. cit., para. 9.
[400] Dans le cas des générations futures, il faut également prévoir un mécanisme de substitution : v. infra, même paragraphe.
[401] A. Aragão, op. cit.
[402] Cf. N. Rühs, A. Jones, « The Implementation of Earth Jurisprudence through Substantive Constitutional Rights of Nature », Sustainability, 2016, Vol. 8(2), p. 174.
[403] A. Leopold, Sand County Almanac: and Sketches here and there, Oxford University Press, Oxford, 1949, p. 224-225.
[404] V. Ph. Descola, « De la Nature universelle aux natures singulières : quelles leçons pour l’analyse des cultures ? », in Ph. Descola (dir.), Les Natures en question, Collège de France, Odile Jacob, Paris, 2018, p. 121‑135, spéc. p. 128 et s.
[405] La rigueur voudrait que l’on distingue l’approche « biocentrique » de l’approche « écocentrique ». L’approche « biocentrique », qui conduit à reconnaître un intérêt à des éléments individuels (une rivière, un animal, une montagne, un glacier, etc.), met véritablement et totalement en jeu l’intérêt d’Autrui. L’action qui permet d’agir est donc une action de substitution stricto sensu. Avec l’hypothèse écocentrique, qui mêle humains et non‑humains, se trouvent associés intérêt diffus de l’humanité et intérêt d’Autrui : l’action en justice a semble-t-il alors, un caractère hybride : à la fois action en défense d’un intérêt collectif et action de substitution. Comme celui qui agit fait partie de la communauté biotique, il agit en représentation d’un intérêt diffus et indivisible que partagent tous les êtres de la Terre (c’est le « tout » dont les éléments sont interdépendants – Autrui). Et, dans le même temps, il donne voix à ceux qui n’en ont pas et qui ont besoin d’un substitut.
[406] Action que l’on trouve par exemple en droit français au cœur de l’action de groupe, et dont Emmanuel Jeuland a récemment décelé la trace dans l’action déclarée recevable du trustee qui agit pour le compte d’un trust (Aix, 4 fév. 2004, RG n°98/5533, LPA 12 oct. 2004, p. 11 note Zulian). Rappelons que le trust n’a pas de personnalité morale distincte du trustee. V. E. Jeuland, « L’être naturel, une personne morale comme les autres dans le procès civil? », https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01990141v2/document, p. 9-10.
[407] Cf. Constitución de la República del Ecuador, 28 septembre 2008, art. 71.
[408] N. Naffine, Law’s Meaning of Life Philosophy, Religion, Darwin and the Legal Person, Hart Publishing, Oxford, Portland, 2009.
[409] Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017. Cette loi est le résultat d’un long processus qui débute dans les années 1975, ainsi que du travail remarquable du « Waitangi Tribunal ». Sur ces différents aspects, v. G. Byrnes, The Waitangi Tribunal and New Zealand History, Oxford University, Press, Melbourne, 2004 ; C. Iorns Magallanes, « Reparations for Maori Grievances in Aotearoa New Zealand », in F. Lenzerini (dir.), Reparations for Indigenous Peoples, Oxford University Press, Oxford, 2008, p. 523-564. Sur la loi de 2017, v. C. Iorns Magallanes, « From Rights to Responsibilities using Legal Personhood and Guardianship for Rivers », in B. Martin, L. Te Aho, M. Humphries-Kil (dir), ResponsAbility: Law and Governance for Living Well with the Earth, Routledge, London, 2019, p. 216-239 ; C. Rodgers, « A new approach to protecting ecosystems: The Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017 », Environmental Law Review, 2017, Vol. 19(4), p. 266‑279 ; V. David, « La nouvelle vague des droits de la nature. La personnalité juridique reconnue aux fleuves Whanganui, Gange et Yamuna », Revue juridique de l’environnement, 2017, Vol. 42(3), p. 409-424 ; K. O’Bryan, « Giving a voice to the river and the role of indigenous people: The Whanganui river settlement and river management in Victoria », Australian Indigenous Law Review, Vol. 20, 2017, p. 48-77 ; C.J. Iorns Magallanes, « Nature as an Ancestor: Two Examples of Legal Personality for Nature in New Zealand », VertigO – la revue électronique en sciences de l’environnement [Online], Hors-série 22 | septembre 2015, http://journals.openedition.org/vertigo/16199 ; DOI : 10.4000/vertigo.16199.
[410] Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017, section 69(2).
[411] Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017, s. 13.
[412] Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017, s. 7. V. aussi s. 8(2) : « customary rights and responsibilities means rights, interests, and responsibilities exercised in relation to the Whanganui River and its catchment according to tikanga Māori, including rights, interests, and responsibilities in relation to the use and occupation of the Whanganui River and its catchment ».
[413] V° kaitiakitanga, https://maoridictionary.co.nz/.
[414] Dans la cosmogonie maorie, les dieux et les esprits habitent le monde naturel, des montagnes, mers, cieux et vents aux rivières et forêts en passant par les plantes et les animaux. Tous les « élements naturels et physiques du monde sont liés les uns aux autres et chacun est contrôlé et dirigé par les très nombreux assistants spirituels des dieux » (Department of Conservation, « Report and Recommandations of the Board of Inquiry into the New Zealand Coastal Policy Statement », 14 February 1994 (cité par D. Nolan (dir.), Environmental and Resource Management Law, 4e éd., LexisNexis NZ, Wellington, 2011, para. 14.2)). Humains et non-humains sont liés entre eux par un lien de parenté (« whanaungatanga ») qui fonde « un ensemble d’obligations réciproques, et celles-ci sont comprises dans le concept de kaitiakitanga – l’obligation de nourrir et de prendre soin. Le terme de Kaitiakitanga est souvent traduit par “stewardship”, mais ce dernier terme ne rend pas compte de sa dimension spirituelle qui est doit être comprise comme le devoir de nourrir le mauri [l’esprit] du peuple, de la flore et de la faune, des reliefs et des fleuves et rivières, lesquels forment ensemble un whakapapa [une généalogie] […]. [K]aitiakitanga est un concept de nature communautaire. Ce n’est pas l’obligation d’un individu mais de l’ensemble de la commuanuté tribale. Tant que la communauté existe, l’obligation perdure » (Waitangi Tribunal, Ko Aotearoa Tēnei – tuarua, Te Taumata Tuarua, WAI 262 (Volume 1), 2011 : https://forms.justice.govt.nz/search/Documents/WT/wt_DOC_68356416/KoAotearoaTeneiTT2Vol1W.pdf, p.237 (cité par C.J. Iorns Magallanes, « Nature as an Ancestor: Two Examples of Legal Personality for Nature in New Zealand », op. cit., para. 8)).
[415] Il doit, selon la loi, « promote and protect the health and well-being of Te Awa Tupua » (Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017, s. 19(1)(c)), « act and speak for and on behalf of Te Awa Tupua » (s. 19(1)(a)) et « act in the interests of Te Awa Tupua and consistently with Tupua te Kawa » (s. 19(2)(a)).
[416] Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017, section 18.
[417] La proposition n’a rien de fantasque. Comme le notait Christopher Stone, « [r]ivers drown people, and flood over and destroy crops » (C. Stone, « Should Trees Have Standing? ‒ Toward Legal Rights for Natural Objects », Southern California Law Review, 1972, Vol. 45, p. 450-501, spéc. p. 481, cité par K. O’Bryan, op. cit., p. 66). Rappelons que la propriété du lit de la rivière, des accroissements, ainsi que des terres qui appartenaient au domaine public en vertu du Public Works Act 1981 et qui ne sont plus nécessaires pour la conduite de travaux publics, est transférée au Te awa Tupua en vertu de la loi (Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017, s.41(1), s. 53, s. 55). Le Te Pou Tupua en est le steward et répond des dommages que le fleuve, l’héritage accru ou les terres peuvent causer. Le Te Pou Tupua peut d’ailleurs demander l’assistance de la Couronne pour faire face à sa responsabilité civile (Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017, Schedule 5, clause 3).
[418] V. supra, n° 68.
[419] Cf. G. Sajeva, When Rights Embrace Responsibilities, op. cit., p. 121-122.
[420] A. Grear, « The discourse of “biocultural” rights and the search for new epistemic parameters: moving beyond essentialisms and old certainties in an age of Anthropocene complexity? », Journal of Human Rights and the Environment 2015, Vol. 6(1), p. 1-6, spéc. p. 2 : « Climate vulnerability – notwithstanding its universal salience – remains differentially distributed, and the patterns of climate injustice point unerringly to the profound precarity of the historically most exploited human sub-groups. In short, if there is a new Anthropocenic “humanity”, it is marked by savagely predictable hierarchies in which the very communities currently envisaged at the heart of biocultural rights discourse (“indigenous peoples and local communities”) stand systemically disadvantaged by the international legal order itself ».
[421] H. Jonas, EL.J. Makagon, H. Shrumm, The Living Convention : A Compendium of Internationally Recognised Rights That Support the Integrity and Resilience of Indigenous Peoples’ and Local Communities’ Territories and Other Socio-Ecological Systems, Natural Justice, 2013, spéc. p. 23, 26.
[422] G. Sajeva, op. cit., p. 124.
[423] K.S. Bavikatte, D. Robinson, « Towards a people’s history of the law: Biocultural jurisprudence and the Nagoya Protocol on access and benefit sharing », LEADS 2011, 7(1), p. 35-51, p. 50.
[424] G. Sajeva, op. cit., p. 126 : « Biocultural rights rhetoric can sound more politically neutral and hence be more widely accepted […] ».
[425] Giula Sajeva propose également de mettre constamment en balance les deux fondations des droits bioculturels – les droits fondamentaux des peuples autochtones et des communautés locales, d’une part, et la protection de l’environnement, de l’autre – de manière à préserver au mieux les intérêts de toutes les populations locales titulaires de ces droits. La mise en balance permet d’appliquer avec souplesse le devoir d’intendance et de limiter les cas dans lesquels des sanctions sont prises contre les communautés : « For example, if a community which was recognized as the holder of biocultural rights guarantees a good conservation of the local ecosystem but not the best level of conservation possible – which could otherwise be reached through a typical protected area – such an increase in environmental conservation would not justify the eviction and consequent decrease in the protection of the community’s rights. On the contrary, if a community or people revert to unsustainable practices in order to safeguard its traditional rites of passage or the worship of a sacred natural site (a certain rite requires the hunt of a threatened species, once more abundantly present, or the enter an area highly threatened by the very presence of humans), a balance would need to be struck with conservation of the environment » (op. cit., p. 128).
[426] V. supra, n° 27 et s.
[427] Sur les critiques de cette vision (qui a néanmoins quelques vertus), v. les références infra, n° 79.
[428] Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, Transmitted to the General Assembly as an Annex to document A/42/427 – Development and International Co‑operation: Environment, 1987 (version française : https://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/5/rapport_brundtland.pdf).
[429] Ibid.
[430] V. supra, n° 19-20.
[431] V. supra, n° 16-18.
[432] La littérature est considérable. En plus des travaux de Posey déjà cités, on peut mentionner l’ouvrage de Fikret Berkes, Sacred Ecology, 4e éd., Routledge, New York, Abingdon, 2018.
[433] V., en particulier, B. Tobin, Indigenous Peoples, Customary Law and Human Rights – Why Living Law Matters, Routledge, Oxon, 2014.
[434] Code de conduite éthique Tkarihwaié:ri, op. cit., para. 20.
[435] Aff. Tierra Digna, para. 5.14 : « estos derechos implican que las comunidades deben mantener su herencia cultural distintiva » (c’est la Cour qui souligne).
[436] C’est d’ailleurs ce que perçoit K. Bavikatte lui-même lorsqu’il évoque, avec Robinson, le « peoplehood » des « biocultural communities », ajoutant qu’il est « integrally linked to the rights to stewardship of their lands and concomitant traditional knowledge through a complex system of customary use rights and fiduciary duties » (K.S. Bavikatte, D. Robinson, op. cit., p. 50) (v. aussi K.S. Bavikatte, Stewarding the Earth, op. cit., p. 149). Ils évoquent également plus loin « […] a community whose peoplehood is integrally tied to their traditional stewardship role and fiduciary duties vis-à-vis their lands and concomitant knowledge » (K.S. Bavikatte, D. Robinson, op. cit., p. 50). Autrement dit, ce qui définit le fait de faire peuple ou de faire communauté (ce qu’il faut comprendre par « peoplehood » qui est calqué sur « personhood » – v. K.S. Bavikatte, Stewarding the Earth, op. cit., p. 145 qui renvoie au travail de Radin), c’est cette éthique particulière de stewardship. Les droits bioculturels ont également pour fonction de faire exister ces sujets (comme chez Posey). La Cour constitutionnelle de Colombie, qui se réfère expressément à ce passage de l’article, en transforme sensiblement le sens au cours de la traduction et passe à côté de la question – dont on sent pourtant le caractère central dans sa réflexion – de la subjectivité juridique : Aff. Tierra Digna, para. 5.14 (v. supra, n° 45-46).
[437] Nous soulignons.
[438] Nous soulignons.
[439] CDB, Préambule (nous soulignons) ; v. aussi, Code de conduite éthique Tkarihwaié:ri, para. 20 ; TIRPAA, art. 9(2).
[440] Cf. F. Berkes, Sacred Ecology, op. cit., p. 4 et s. ; v. aussi D.A. Posey, « Introduction: Culture and Nature – The Inextricable Link », in D.A. Posey, Cultural and Spiritual Values of Biodiversity, United Nations Environment Programme, Londres, 1999, p. 1-18, spéc. p. 4.
[441] HCDH, Leaflet No. 10: Indigenous Peoples and the Environment, https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideIPleaflet10en.pdf, p. 6.
[442] V., en ce sens, L’ACCORD aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, dont l’article 5(i) impose aux États de prendre « en compte les intérêts des pêcheurs qui se livrent à la pêche artisanale et à la pêche de subsistance » ; article 24, 2(b), il est question de « pêche de subsistance » et de « petites pêches commerciales ».
[443] V., not., Economic and Social Council, COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, Fifty-second session, Item 8 of the provisional agenda, Working paper on the relationship and distinction between the rights of persons belonging to minorities and those of indigenous peoples, Distr.GENERALE/CN.4/Sub.2/2000/10 19 July 2000 (Erika-Irene Daes et Asbjørn Eide), para. 39.
[444] IACtHR, Case of the Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay, Series C No. 125 (17 July 2005), para. 135 ; v. aussi IACtHR, IACtHR, Paraguay, Case of the Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay, Series C No. 146 (29 March 2006), para. 118.
[445] Convention n° 169 de l’OIT, art. 23.1 : « L’artisanat, les industries rurales et communautaires, les activités relevant de l’économie de subsistance et les activités traditionnelles des peuples intéressés, telles que la chasse, la pêche, la chasse à la trappe et la cueillette, doivent être reconnus en tant que facteurs importants du maintien de leur culture ainsi que de leur autosuffisance et de leur développement économiques » ; CDESC, Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Fédération de Russie, U.N. Doc. E/C.12/1/Add.94 (2003), para. 39 : « Le Comité, rappelant le droit à l’autodétermination consacré à l’article premier du Pacte, exhorte l’État partie à redoubler d’efforts pour améliorer la situation des peuples autochtones et s’assurer qu’ils ne sont pas privés de leurs moyens de subsistance. Le Comité encourage aussi l’État partie à garantir l’application effective de la loi sur les territoires traditionnellement occupés par les peuples autochtones » ; IACtHR, Kaliña and Lokono Peoples v. Suriname, Series C, No. 309 (25 November 2015), para. 130.
[446] Y. C. Zarka, « L’invention du sujet de droit », Archives de Philosophie, 1997, Vol. 60(4), p. 531-550.
[447] R. Worrell, M.C. Appleby, « Stewardship of Natural Resources: Definition, Ethical and Practical Aspects », Journal of Agricultural and Environmental Ethics 2002, 12: 263-277.
[448] Des publications récentes témoignent d’une volonté d’apporter un peu de clarté à la matière : N.J. Bennett et al., « Environmental Stewardship : A Conceptual Review and Analytical Framework », Environmental Management, 2018, Vol. 61, p. 597-614 ; R. Mathevet, F. Bousquet, C.M. Raymond, « The concept of stewardship in sustainability science and conservation », Biological Conservation, 2018, 217, p. 363-370.
[449] Ce sont probablement les éthiciens de l’environnement qui ont fait le lien entre la notion spirituelle/religieuse de stewardship, les savoirs écologiques traditionnels et les ontologies des Suds. Les travaux de Posey ont été importants, de même que ceux de Callicott (Earth’s insights : a survey of ecological ethics from the Mediterranean basin to the Australian outback, University of California Press, Berkeley, London, 1994), Berkes et Freeman (supra, n° 18).
[450] Warden vient du français anglo-normand warden, variante de l’ancien français : guarden.
[451] Cf. R. Attfield, The Ethics of Environmental Concern, University of Georgia Press, Athens and London, 1991, p. 49-50.
[452] R. Attfield, op. cit., p. 47.
[453] C.M. Roach et al., « Ducks, Bogs, and Guns: A Case Study of Stewardship Ethics in Newfoundland », Ethics and the Environment, 1996, Vol. 11(1), p. 43-70.
[454] A. Leopold, Sand County Almanac: and Sketches here and there, Oxford University Press, Oxford, 1949 (Almanach d’un comté des sables, trad. A. Gibson, Flammarion, Paris, 2010).
[455] A. Leopold, Almanach d’un comté des sables, op. cit., p. 258 : « L’éthique de la terre élargit simplement les frontières de la communauté de manière à y inclure le sol, l’eau, les plantes et les animaux ou, collectivement, la terre » ; A. Leopold, « Conservation: In Whole or in Part? » [1944], in S.L. Flader, J.B. Callicott, The River of the Mother of God and Other Essays by Aldo Leopold, The University of Wisconsin Press, Madison, Londres, 1991, p. 310-319, spéc. p. 310 : « The land consists of soil, water, plants, and animals, but health is more than a sufficiency of these components. It is a state of vigorous self-renewal in each of them, and in all collectively ».
[456] W. Lucy, C. Mitchell, « Replacing Private Property: The Case for Stewardship », The Cambridge Law Journal, 1996, Vol. 55(3), p. 566-600, spéc. p. 583.
[457] E. Meidinger, « Laws and Institutions in Cross-Boundary Stewardship », in R. Knight, P. Landres (dir.), Stewardship Across Boundaries, Island Press, Washington, 1998, p. 87-110.
[458] A. Leopold, « Conservation: In Whole or in Part? », op. cit., p. 311 : « Land, to the average citizen, is still something to be tamed, rather than something to be understood, loved, and lived with. Resources are still regarded as separate entities, indeed, as commodities, rather than as our cohabitants in the land-community ».
[459] R. Worrell, M.C. Appleby, op. cit., p. 265-266.
[460] Étudiant le principe « bimeekumaugaewindes » (gérance) des Anichinabés Ojibwés, peuple amérindien réparti entre le Canada et les États-Unis, John Borrows identifie quatre principes, de reconnaissance, de réalisation, de responsabilité et d’approbation : « The Ojibway’s acknowledgement of a Creator and an appreciation of their reliance on their relationship to the world is the first principle of bimeekumaugaewin within Ojibway society. As these stories progress, the second principle of bimeekumaugaewin emerges: how to accomplish the Creator’s vision in setting life in motion. The stories convey the manner in which plants, animals and humans should relate to and respect one another. They contain important teachings about the preparation that is necessary for living a good life. And they talk of principles that must be followed so that all the orders of creation can live together in peace and friendship. The stories continue on to explore the third principle of bimeekumaugaewin: accountability. Ceremonies are often performed in conjunction with these stories to communicate to the Creator and acknowledge before others how one’s duties and responsibilities have been performed. Dancing, feasting and singing sometimes accompany these rituals. Finally, the stories finish by talking about the consequences of living in accordance with or contrary to these principles […]. The idea of approbation received for proper performance of duty, or disapprobation flowing from failure to fulfill a responsibility, complete the Ojibway circle of bimeekumaugaewin » (J. Borrows, « Stewardship and the First Nations Governance Act », Queen’s L.J., 2003, Vol. 29, p. 103-132, spéc. p. 105-106).
[461] R. Worrell et M.C. Appleby, op. cit., p. 266.
[462] H. Jonas, Le principe de responsabilité, trad. J. Greisch, Le Cerf, Paris, 1990 ; P. Ricoeur, « Postface au temps de la responsabilité », in Lectures I. Autour du politique, Le Seuil, Paris, 1991, p. 270 et s.
[463] D. Haraway, When Species Meet, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2008.
[464] Comp. R. Worrell et M.C. Appleby, op. cit., p. 267.
[465] Comp. V. Maris, Philosophie de la biodiversité…, op. cit., 179-180 et C. Larrère, « Les éthiques environnementales », op. cit., p. 409.
[466] R. Worrell, M.C. Appleby, op. cit., p. 267
[467] V. E.C. Hargrove, V° Environmental Stewardship, in. J.B. Callicott, R. Frodeman (dir.), Encyclopedia of Environmental Ethics and Philosophy, Vol. 1 & 2, Macmillan, Farmington Hills, MI, 2009, p. 323-325, spéc. p. 323 : « Environmental citizenship is the idea that each of us is an integral part of a larger ecosystem and that our future depends on each of us embracing the challenge and acting responsibly and positively toward our environment ».- Adde, B. Latour, Face à Gaïa, Les Empêcheurs de Penser en Rond, La Découverte, Paris, 2015, p. 23 et s.
[468] E. Barritt, « Conceptualising Stewardship in « Environmental Law », Journal of Environmental Law, 2014, Vol. 26, p. 1-23, spéc. p. 180.
[469] W. Lucy, C. Mitchell, « Replacing Private Property: The Case for Stewardship », op. cit., p. 586 ; K.A. Carpenter, S.K. Katyal, A.R. Riley, « In Defense of Property », The Yale Law Journal, 2009, Vol. 118(6), p. 1022‑1125, spéc. p. 1028-1029.
[470] C’est un point qui est jugé déterminant en éthique : R. Worrell, M.C. Appleby, op. cit., p. 268 : « Stewards accept a degree of answerability to a higher authority or authorities such as society or God » ; R. Attfield, op. cit., p. 57.
[471] Worrel et Appleby indiquent ainsi que le « [s]tewardship places a steward in a wider community and accepts that trade-offs will need to be made among community members » (op. cit., p. 268). Sur cette question, v. aussi infra, n° 81-82.
[472] V. F. Girard, « Composing the common world of the local bio-commons in the age of the Anthropocene », in F. Girard, C. Frison (dir.), The Commons, Plant Breeding and Agricultural Research. Challenges for Food Security and Agrobiodiversity, Routledge, Oxon, 2018, p. 117-144, spéc. p. 128.
[473] M. Puig de la Bellacasa, Matters of Care. Speculative Ethics in More Than Human Worlds, University of Minnesota Press, Minneapolis, Londres, 2017, p. 127.
[474] Op. cit., p. 150.
[475] V. supra, n° 32.
[476] CDB, Groupe de travail spécial intersessions à composition non limitée sur l’article 8j) et les dispositions connexes de la Convention sur la diversité biologique, Rapport de la réunion du groupe d’experts composé de représentants des communautés locales dans le cadre de l’article 8j) et des dispositions connexes de la convention sur la diversité biologique, UNEP/CBD/WG8J/7/8/Add.1*, 4 septembre 2011, qui donne, en annexe, une liste de caractéristiques qui pourraient servir à définir les communautés locales. Comme on l’a remarqué, ces critères sont très proches de ceux utilisés pour identifier les peuples autochtones (dont l’auto-identification ou droit de s’identifier) (G. Sajeva, When Rights Embrace Responsibilities, op. cit., p. 46-47). Parmi ceux-ci, on retiendra les suivants qui font écho à la définition de l’intentant proposée au texte : b) Modes de vie liés à des traditions associées aux cycles naturels (relations symboliques ou dépendance), à l’utilisation et la dépendance des ressources biologiques, et à l’utilisation durable de la nature et de la diversité biologique ; c) La communauté occupe et/ou utilise traditionnellement un territoire définissable de façon permanente ou périodiquement. Ces territoires sont importants pour la préservation des aspects sociaux, culturels et économiques de la communauté ; d) Traditions (évoquant souvent une histoire, une culture, un langage, des rites, des symboles et des coutumes communs) dynamiques et qui peuvent évoluer ; e) Technologie / savoir / innovations / pratiques associés à l’utilisation durable et à la conservation des ressources biologiques ; k) Exécution et maintien traditionnels d’activités économiques, notamment à des fins de subsistance, de développement durable et/ou de survie ; l) Patrimoine biologique (y compris génétique) et culturel (patrimoine bioculturel) ; m) Valeur spirituelle et culturelle de la diversité biologique et des territoires ; p) La biodiversité est souvent incorporée dans les noms traditionnels de localités ; q) Les aliments et les méthodes de préparation des aliments sont souvent liés à la biodiversité ; u) Les systèmes de convictions et de valeurs sont souvent liés à la diversité biologique ; v) Propriété collective des terres et des ressources naturelles.
[477] V., F. Berkes, Sacred Ecology, op. cit., p. 75-79.
[478] Un point particulièrement important est que le stewardship ne postule pas une « intention conservatrice » ou une « éthique de la conservation » au sens des sciences de la conservation. Ce qui importe c’est l’ethos de soin qui découle de l’attachement, la continuité nature-culture, l’absence de dominion ; ethos qui se convertit ensuite en obligations diverses et situées, mais sans que l’on puisse toujours les mettre en lien avec un dessein de conservation : v. les remarques de G. Filoche, « Formaliser l’informel, capter l’évanescent ? Juridicisation des normes indigènes et gestion de l’environnement en Amérique du Sud », in C. Gros, D. Dumoulin-Kervran (dir.), Le multiculturalisme au concret. Un modèle latino-américain, Presses Sorbonne Nouvelle, Paris, 2012, p. 199‑201, para. 16 : « […] ce n’est pas parce que les Amérindiens ont développé des pratiques tendant à ne pas surexploiter et à entretenir leurs écosystèmes que l’on peut leur attribuer une éthique de la conservation à l’occidentale, ni qu’ils adoptent des règles visant expressément à la conservation. En revanche, des tabous explicites concernent des espèces bien précises. Des comportements – d’autolimitation pour la chasse et de soin particulier aux boutures de manioc par exemple – découlent de l’inclusion des espèces animales et végétales dans les rapports humains, de la nécessité de s’attirer leurs faveurs ou de mettre à distance leur puissance, ou du simple plaisir affectif » ; v. aussi F. Pinton, P. Grenand, « Savoirs traditionnels, populations locales et ressources globalisées », in Catherine Aubertin, Florence Pinton et Valérie Boisvert (dir.), Les marchés de la biodiversité, Paris, IRD Éditions, Paris, 2007, p. 165-194, spéc. p. 186. K. Bavikatte, qui n’est pas toujours clair sur cette question, note pourtant : « Both Radin and Riley et al. point out that there are deep relations that people have with certain kinds of property that take it outside the realm of what is fungible, and place it squarely within the realm of personal. Within the latter realm, the relationship between a territory and a people is one of stewardship, where the flourishing of the people is tied to the well-being of the property. It is submitted, that the people care for this land not because they are conscious environmentalists but rather because their very selfhood is tied to the land:they feel that the land belongs to them and they belong to the land. The ethic of care for the land then is a natural by-product » (K.S. Bavikatte, Stewarding the Earth, op. cit., p. 152, nous soulignons).
[479] A. Escobar, Sentir-Penser avec la Terre, op. cit., p. 25-26 : « Ce concept cherche à mettre en lumière à la fois la dimension politique de l’ontologie et la dimension ontologie de la politique. Si toute ontologie ou vision du monde engendre une vision et une pratique politique particulières, réciproquement, tout conflit politique renvoie à un ensemble de prémisses fondamentales sur ce que sont le monde, le réel et la vie, à une ontologie.— Le concept d’ontologie politique permet donc d’appréhender le fait que tout ensemble de pratiques instaure nécessairement un monde. […] L’une des interrogations fondamentales de l’ontologie politique consiste alors à se demander quel type de monde s’instaure à travers tel ou tel type de pratiques, et quelles en sont les conséquences pour tel ou tel groupe donné, qu’il soit humain ou non-humain ».
[480] V., en ce sens, I. Bellier, « “We Indigenous Peoples…”. Global Activism and the Emergence of a New Collective Subject at the United Nations », in B. Müller (dir.), The Gloss of Harmony. The Politics of Policy‑Making in Multilateral Organisations, Pluto Press, Londres, 2013, p. 177-201.
[481] Sous ce regard, le débat sur la reconnaissance des droits de la nature relève également de l’ontologie politique.
[482] F. Berkes, op. cit., p. 73.
[483] T. Ellingson, The Myth of the Noble Savage, op. cit. ; K. Redford, « The Ecologically Noble Savage », op. cit.
[484] F. Berkes, op. cit., p. 249 ; G. Sajeva, op. cit., p. 73.
[485] Comme le rappelait Posey : « All human societies – even the most traditional – are enmeshed in change, and always have been. Human evolution is about adaptation and change, and as cultures and environments adapt to different conditions there will inevitably practices and customs that become unadaptive and must be modified to fit the new circumstances » (D.A. Posey, « Introduction : Culture and Nature – The Inextricable Link », op. cit., p.7).
[486] V. les analyses de J.B. Alcorn, « Noble Savage or Noble State? Northern Myths and Southern Realities in Biodiversity Conservation », op. cit. ; v. aussi P.R. Wilshusen et al., « Reinventing a Square Wheel : Critique of a Resurgent “Protection Paradigm” in International Biodiversity Conservation », Society & Natural Resources, 2002, Vol. 15, p. 17-40, p. 32 ; F. Lu Holt, « The Catch-22 of Conservation : Indigenous Peoples, Biologists and the Cultural Change », Human Ecology, 2005, Vol. 33(2), p. 199-215, spéc. p. 209.
[487] F. Berkes, op. cit. p. 251.
[488] Par là même, comme l’indique Giulia Sajeva, le mythe rend impossible toute collaboration entre les communautés locales et les peuples concernés et les conservationnistes (G. Sajeva, op. cit., p. 73-75).
[489] D.A. Posey, op. cit., p. 7 ; F. Berkes, op. cit., p. 256.
[490] D.A. Posey, op. cit., loc. cit. ; F. Berkes, op. cit., loc. cit.
[491] K.H. Redford, A.M. Stearman, « Forest-dwelling native Amazonians and the conservation of biodiversity », Conservation Biology, 1993, Vol. 7, p. 248-255, p. 252.
[492] Sur la complexité du concept de diversité et la difficulté de disposer d’indicateurs, cf. V. Maris, Philosophie de la biodiversité, op. cit., p. 54 et s.
[493] J.B. Alcorn, « Indigenous peoples and conservation », Conservation Biology, 1993, Vol. 7, p. 424-426.
[494] Elles sont d’ailleurs tirées d’une controverse entre Redford et Stearman, d’une part, et Alcorn, de l’autre (elle est rappelée par F. Berkes, op. cit., p. 257-258).
[495] Sur la nécessité de disposer d’indicateurs : R. Worrell et M.C. Appleby, op. cit., p. 273.
[496] Cf. G. Sajeva, op. cit., p. 120 : « The same actions and projects may be considered sustainable or unsustainable depending on the concept they are measured against, and, even more debatable, depending on the body entitled to judge them ». Dans un article récent, R. Mathevet, F. Bousquet et « C.M. Raymond (« The concept of stewardship in sustainability science and conservation », Biological Conservation, 2018, Vol. 217, p. 363-370) ont montré, à travers un état de l’art de l’emploi du terme de stewardship en science de la durabilité et en biologie de la conservation, la grande variabilité qui marque l’emploi du concept selon les auteurs. Ils ont dressé, à partir de la classification des discours environnementaux au sens de Dryzek (The politics of the Earth: Environmental Discourses, 3e éd., Oxford University Press, Oxford, 2013), quatre catégories de stewardship extrêmement différents et largement inconciliables : un « reformist stewardship » , un « sustainability stewardship » , un « adaptative stewardship » et un « transformative stewardship ». D’ailleurs, comme on l’a déjà observé, en matière de biodiversité, la caractérisation du vivant est si complexe qu’il n’existe aucune mesure universelle (V. Maris, op. cit., loc. cit.).
[497] M. Goldman, « Introduction: The Political Resurgence of the Commons », in M. Goldman (dir.), Privatizing Nature. Political Struggles for the Global Commons, Rutgers University Press, New Brunswick, NJ, 1998, p. 5.
[498] C’est dans cette optique que sont développées les approches dites « bioculturels » de conservation : M.A. Apgar, Biocultural Approaches: Opportunities for Building More Inclusive Environmental Governance. IDS Working Paper, Vol. 2017, No. 502, 2017 ; Gavin, M.C. et al., « Defining biocultural approaches to conservation », Trends in Ecology & Evolution, 2015, Vol. 30(3), p. 140-145.
[499] K.H. Redford, A.M. Stearman, op. cit. ; T.O. McShane et al., « Hard Choices: making trade-offs between biodiversity conservation and human well-being », Biological Conservation, 2011, Vol. 144, p. 966-972.
[500] L. Maffi, « Introduction », in L. Maffi et E. Woodley (dir.), Biocultural Diversity Conservation: A Global Sourcebook, Earthscan, London, Washington, DC, 2010, p. 5-6. Il ne faut pas oublier que l’agrobiodiversité est le résultat d’interactions complexes entre humains (et leurs savoirs traditionnels) et semences : « [l]es connaissances traditionnelles associées à une plante domestiquée et sélectionnée par les communautés locales s’expriment dans l’existence de l’objet biologique lui-même, la plante. Sans le savoir agronomique des communautés locales, sans leurs techniques et expérimentations dans la sélection et la conservation, ces objets, qu’il s’agisse de plantes alimentaires, médicinales, ornementales ou réservées à d’autres types d’usage, n’existeraient pas. La diversité agricole est, en soi, l’expression et la matérialisation des savoirs traditionnels » (J. Santilli, L. Emperaire, « A agrobiodiversidade e os direitos dos agricultores indígenas e tradicionais », in B. Ricardo, F. Ricardo (dir.), Povos Indígenas no Brasil: 2001–2005, São Paulo, Instituto Socioambiental, 2006, p. 101-103, p. 102).
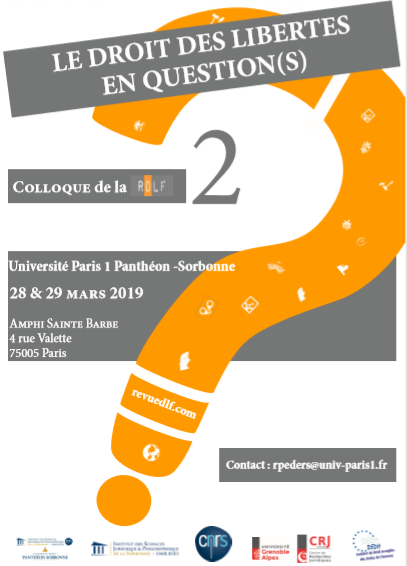
 Décrivant, il y a bientôt trente ans, les mérites respectifs des juges judiciaire et administratif en la matière, le doyen Rivero écrivait qu’au « service des libertés, les deux juridictions, chacune selon sa spécificité, ont mis des moyens différents mais complémentaires : le juge administratif a situé l’essentiel de son action au niveau des normes, le juge judiciaire au niveau des réalités concrètes »
Décrivant, il y a bientôt trente ans, les mérites respectifs des juges judiciaire et administratif en la matière, le doyen Rivero écrivait qu’au « service des libertés, les deux juridictions, chacune selon sa spécificité, ont mis des moyens différents mais complémentaires : le juge administratif a situé l’essentiel de son action au niveau des normes, le juge judiciaire au niveau des réalités concrètes »

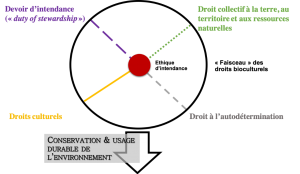


 En 2010, à l’occasion de la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public
En 2010, à l’occasion de la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public  Nouvelle inouïe (et même Inuit), digne du Gorafi ou du JT parodique de la bande à Moustic sur Canal +, mais rapportée par une gazette d’ordinaire moins drôle, le Wall Street Journal : un palmipède yankee qu’on ne présente plus aurait prétendu au cours du dernier été – dont les fraîches températures ont cloué le bec aux crispés du thermomètre, victimes de désinformation (« The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive ») – vouloir acquérir un vaste territoire arctique où il faisait jusqu’ici un froid de canard : le Groenland, l’une des plus grandes îles du monde, qui dépend du petit royaume du Danemark mais bénéficie d’un statut d’autonomie. Parvenu à d’éminentes responsabilités dans des circonstances mal élucidées, cet ancien magnat de l’immobilier a cru devoir ajouter sur les réseaux sociaux qu’il ne comptait pas construire des gratte-ciels sur la banquise (sacré farceur ! Pour l’humour BTP, Donald n’est pas manchot).
Nouvelle inouïe (et même Inuit), digne du Gorafi ou du JT parodique de la bande à Moustic sur Canal +, mais rapportée par une gazette d’ordinaire moins drôle, le Wall Street Journal : un palmipède yankee qu’on ne présente plus aurait prétendu au cours du dernier été – dont les fraîches températures ont cloué le bec aux crispés du thermomètre, victimes de désinformation (« The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive ») – vouloir acquérir un vaste territoire arctique où il faisait jusqu’ici un froid de canard : le Groenland, l’une des plus grandes îles du monde, qui dépend du petit royaume du Danemark mais bénéficie d’un statut d’autonomie. Parvenu à d’éminentes responsabilités dans des circonstances mal élucidées, cet ancien magnat de l’immobilier a cru devoir ajouter sur les réseaux sociaux qu’il ne comptait pas construire des gratte-ciels sur la banquise (sacré farceur ! Pour l’humour BTP, Donald n’est pas manchot).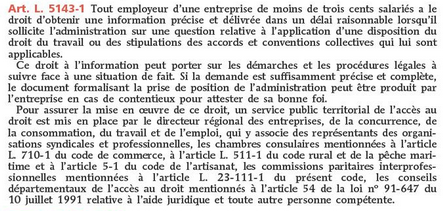 L’accès aux règles de droit et à l’information administrative repose sur divers fondements nationaux et internationaux. Cette mission de service public découle non seulement de l’exigence de transparence administrative consacrée par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
L’accès aux règles de droit et à l’information administrative repose sur divers fondements nationaux et internationaux. Cette mission de service public découle non seulement de l’exigence de transparence administrative consacrée par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
 En raison de la dimension internationale du terrorisme qui a frappé la France dans les années 90 et, plus récemment, depuis 2015, le droit des étrangers et la matière pénale ont connu d’importantes évolutions ces dernières années. Souvent adoptées en réaction à une attaque terroriste, commise sur notre sol ou à l’étranger, les lois ou dispositions particulières relatives à la lutte contre le terrorisme se sont multipliées et le rythme des réformes a été particulièrement soutenu depuis 1996.
En raison de la dimension internationale du terrorisme qui a frappé la France dans les années 90 et, plus récemment, depuis 2015, le droit des étrangers et la matière pénale ont connu d’importantes évolutions ces dernières années. Souvent adoptées en réaction à une attaque terroriste, commise sur notre sol ou à l’étranger, les lois ou dispositions particulières relatives à la lutte contre le terrorisme se sont multipliées et le rythme des réformes a été particulièrement soutenu depuis 1996.